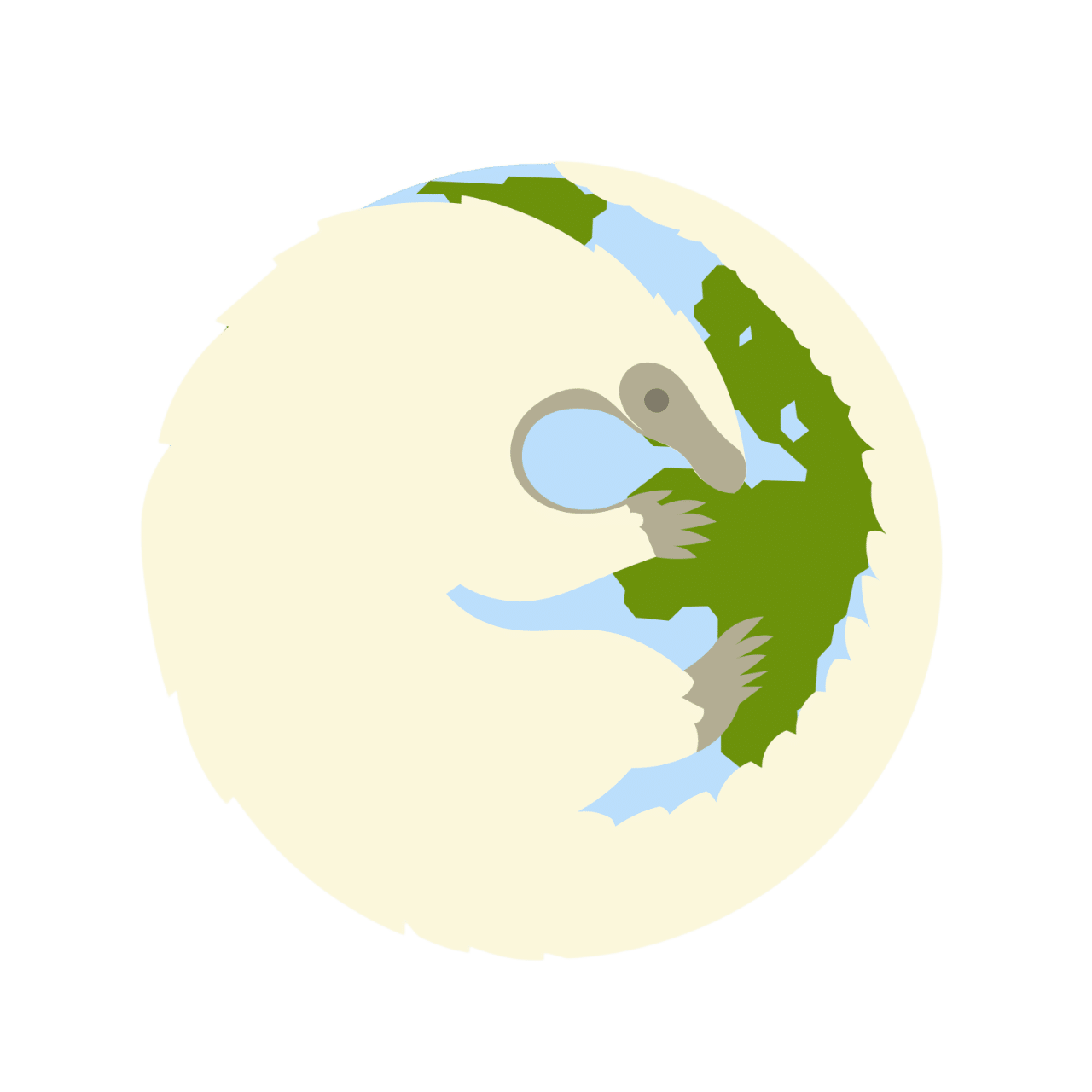Au milieu des débats qui opposent l’agriculture à l’écologie, on perd facilement de vue le but de la pensée écologique. On la tronque et la caricature pour en faire une quête de lunatiques déconnectés des réalités. Toutefois, s'engager pour la biodiversité naît d’une clairvoyance douloureuse de ce que sera notre futur si nous ne nous adaptons pas et ne protégeons pas le monde dont nous faisons partie.
Les philosophes ont longtemps loué la soi-disant supériorité de l’Homme. Au XVIe et XVIIe siècle, on pouvait quand même lire des phrases comme:
“Une seule pensée de l’homme vaut plus que l’univers tout entier.”
Saint Jean de la Croix
“Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui; l’univers n’en sait rien.”
Blaise Pascal
Les mentalités ont bien évolué depuis, notamment grâce aux travaux de Charles Darwin, qui a montré que l’évolution n’est pas une pyramide qui consacre l’espèce humaine en son sommet, mais un réseau mué par les forces adaptatives.
“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements.”
Charles Darwin
Néanmoins, l’idée d’une supériorité de l’espèce humaine sur le reste du vivant est encore vivace, et le droit d’exploiter la nature comme une ressource faite pour les humains, encore ancrée dans de nombreuses cultures à travers le monde.
Les argumentaires en faveur de la protection de la biodiversité s’appuient fortement sur le concept de “services écosystémiques” pour illustrer notre dépendance, notamment économique, vis-à-vis de la nature. Si ce concept est un outil puissant de communication, il consacre encore la nature comme une ressource POUR l’être humain.
S’engager pour la protection de la biodiversité, c’est placer les humains au même niveau que les autres espèces, comme une pièce dans l’échiquier complexe du vivant. Certains croient que cela signifie faire passer les humains après les autres espèces, non ! On cherche l’harmonie, le droit pour tout être vivant de vivre décemment.
Si nous persévérons dans nos modes de vie actuels, ce sont de nombreuses espèces, par ailleurs parfaitement adaptées à leur environnement, qui disparaîtront à cause de nos activités. Ce seront également de nombreuses populations humaines qui seront mises en danger par les agissements inconsidérés et incontrôlés de quelques pays.
S’engager pour la protection de la biodiversité est une démarche profondément humaniste, de préservation du vivant y compris des humains. La lutte écologique va de pair avec la lutte sociale.
En adoptant cette vision pour le vivant, humain et non-humain, nous pouvons adopter les changements transformateurs recommandés par l’IPBES et le GIEC. Des changements qui s’inscrivent directement dans une démarche d’adaptation pour que tous les humains sur Terre aient accès à une qualité de vie décente.
S’engager pour la protection de la biodiversité, c’est donc aussi proposer des solutions pour assurer la pérennité des femmes et des hommes à travers le monde, sur la base de modes de vie construits avec et non pas aux dépens des écosystèmes.
Hubert Reeves, grand vulgarisateur scientifique disait : “L'Homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible ! Sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce dieu invisible qu'il vénère !”
Revenons à la raison, préservons la biodiversité.
Dr Manul
Le mois dernier, le Parlement Européen a adopté la loi européenne de restauration de la nature. Qualifiée d’historique, cette loi interrompt plus de 30 années d’inaction : la dernière directive pour la protection des écosystèmes remonte à 1992, c’était la directive habitats. De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer un texte très affaibli et qui ne serait pas à la hauteur des enjeux. Dans cet article, nous présentons les résultats des négociations et mettons en lumière les modifications du texte initial qui ont considérablement assoupli le règlement.
Les mêmes chiffres, issus du communiqué de presse du parlement européen ont été relayés par les médias. Ainsi, cette mesure phare a fait les titres de la plupart des journaux : les États membres s’engagent à restaurer au moins 30% des zones d’habitat dégradés et donc considérés en mauvaise état écologique d’ici 2030 (en donnant une priorité au zone Natura2000), puis à en avoir restauré 60% d’ici 2040, et enfin 90% d’ici 2050.
Les négociations ont permis des améliorations notables dans le texte, en particulier l’ajout de mesures de restauration des écosystèmes marins qui étaient absents de la version originale. De plus, le renforcement de la sécurité alimentaire et la neutralité en matière de dégradation des sols ont fait leur entrée parmi les objectifs affichés de la loi. Néanmoins, dans l’ensemble, les négociations ont surtout rendu le texte moins ambitieux.
La version initiale du texte mentionnait explicitement un objectif de 10% de couvert arboré urbain dans toutes les agglomérations et villes d’ici à 2050. Un objectif bien plus vague l’a remplacé dans le texte voté puisqu’il vise désormais ‘une tendance à l’augmentation du couvert arboré urbain’.
Selon les prévisions, l'urbanisation devrait continuer à s'accélérer (55,3 % de la population mondiale vivait en zone urbaine en 2018) ainsi que l’augmentation des températures en ville en été. L’adaptation de l’environnement urbain aux nouvelles conditions climatiques est donc cruciale et l'augmentation de la couverture végétale est une solution efficace. Le couvert végétal apporte en effet de nombreux bénéfices en zone urbaine : ralentissement du ruissellement des eaux, maintien des températures à un niveau supportable. Il fournit également des habitats refuges pour que d’autres espèces puissent prospérer.
Dans le texte adopté, les états membres s’engagent à inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030. Cependant, ne sont considérés comme pollinisateurs que les insectes. Si le groupe des pollinisateurs comprend majoritairement des insectes, il inclut également des oiseaux, chauve-souris, primates, marsupiaux, reptiles et des rongeurs. À l’échelle mondiale, 16,5 % des pollinisateurs vertébrés seraient menacés d'extinction avec une tendance à l'augmentation du nombre d'extinctions. Ce chiffre passerait même à 30% pour les espèces insulaires.
Deuxième coup dur, pour les oiseaux en particulier. Une modification subtile du phrasé du texte établit que l’on doit désormais viser à (et non plus, faire en sorte que)[1] l’index des oiseaux communs s’améliore.
[1] Cet objectif indique une intention poursuivie par la loi, mais cela ne garantit pas nécessairement que cet objectif sera atteint ou réalisé. Lorsqu'une disposition légale stipule qu'elle doit "faire en sorte que" quelque chose se produise, cela implique une obligation ou une responsabilité de garantir que cet objectif soit atteint.
De nombreuses additions d’articles et/ou paragraphes introduisent des dérogations et des exceptions, qui permettent de contourner les engagements.
Un exemple parlant est l’article sur la défense nationale qui permet d’exempter des zones utilisées pour des ‘activités répondant uniquement aux besoins de défense nationale’ si les mesures de protection ne sont pas compatibles avec l’utilisation militaire de la zone.
L’article 27 illustre également à merveille l’affaiblissement du texte à coups de dérogations : il permet de suspendre les mesures de protection ‘si un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué, […] a de graves conséquences à l'échelle de l'Union’ sur la capacité à assurer la sécurité alimentaire des États membres.
Enfin, un autre article important porte sur les énergies renouvelables[2]. Cet article établit que la construction de structures de production d'énergie à partir de sources renouvelables ‘relèvent d'un intérêt public majeur’. La mise en place de ces projets serait soumise à des évaluations environnementales moins contraignantes que d’autres projets de construction.
En théorie, faciliter le développement des projets de production d’énergie bas carbone devrait être une absolue priorité dont on devrait se réjouir. Dans les faits, ces mesures sont le résultat de compromis insatisfaisants pour la protection de la biodiversité. Elles servent souvent d'outils de communication pour témoigner du prétendu engagement international dans la réduction des émissions de GES alors que rien n’est concrètement fait pour stopper les entreprises climaticides de continuer d’extraire des énergies fossiles. Une mesure win/win qui fait bonne figure tout en permettant de continuer de détruire des espaces naturels pour des projets immobiliers qui peuvent rapporter gros.
[2] Les énergies renouvelables ne sont pas définies dans le texte mais d’après le site du parlement européen les énergies renouvelables sont l’éolien, le solaire, l’hydroélectrique, la géothermie, la biomasse et les biocombustibles.
Absolument absent de la première proposition de loi, cet article intitulé ‘Plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires’ a fait son apparition triomphante dans le texte. Evidemment, comme il s’agit de planter des arbres, LA passion des politiques qu’on soupçonne de ne pas toujours maîtriser le sujet de la biodiversité, ça a fini dans le communiqué de presse. On vous renvoie à notre article sur la compensation d’émissions de GES pour savoir pourquoi ce type de mesures est problématique.
Le secteur agricole, en tension depuis plusieurs mois avec des manifestations un peu partout en Europe, souhaitait faire pression et obtenir un assouplissement des règles environnementales. La version votée mentionne explicitement la prise en compte du changement climatique, des besoins sociaux et économiques des zones rurales, et de la durabilité de la production agricole. Ce qui semble tendre vers l’agroécologie. Néanmoins, les négociations ont permis de diminuer la fréquence des mesures des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles originellement prévue tous les trois ans, qui passe donc à tous les six ans.
Les tourbières sont des écosystèmes particuliers. Elles sont considérées comme des zones humides et se forment par accumulation de matière organique non décomposée, principalement des débris végétaux, dans un environnement saturé en eau (et pauvre en oxygène). Elles font partie des écosystèmes stockant le plus de carbone au monde. Très fertiles, elles sont trop souvent converties en terrains cultivables par drainage, pour répondre aux besoins croissants en production agricole. La remise en eau des tourbières (processus consistant à transformer le sol drainé d'une tourbière en un sol humide) a pour objectif de rétablir leur rôle de puits de carbone ainsi que de restaurer la biodiversité très riche, typique de ces écosystèmes fragiles.
La dernière version du texte fixe des objectifs spécifiques de remise en eau des tourbières drainées plus bas que le texte original (70% initialement contre 50% voté d’ici à 2050). Il introduit également la possibilité pour les États membres de réduire l'ampleur de la remise en eau sous certaines conditions. Le texte voté souligne aussi que la remise en eau des terres agricoles reste volontaire pour les agriculteurs/agricultrices et les propriétaires privés, sans préjudice des obligations découlant du droit national. Une mesure évidemment décevante au regard du potentiel considérable d’absorptions de gaz à effet de serre que renferme ces tourbières.
Pörtner, H. O., Scholes, R. J., Agard, J., Archer, E., Arneth, A., Bai, X., ... & Ngo, H. (2021). Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change.
IPBES. (2016). Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.2616458
C Qiu, P. Ciais, D. Zhu, B. Guenet, S. Peng, A. M. R. Petrescu, R. Lauerwald, D. Makowski, A. V. Gallego-Sala, D. J. Charman, S. C. Brewer.Large historical carbon emissions from cultivated northern peatlands. Science Advances 04 Jun 2021:Vol. 7, no. 23, eabf1332 - DOI: 10.1126/sciadv.abf1332
Le texte adopté en février 2024
La proposition de loi de juin 2022
Dans cet article on vous rappelle les définitions de ce que sont les empreintes carbone et écologique.
Puis nous vous présenterons différents calculateurs d'« empreinte carbone » et d'« empreinte écologique » ainsi que les résultats d'un membre de notre équipe.
Enfin nous vous proposerons des solutions concrètes et qui font la différence pour réduire votre impact sur l'environnement.
L’empreinte carbone c’est la quantité de GES émise par les activités humaines, exprimée en équivalent carbone (ou « eqCO2 », « CO2e », « CO2-eq »). Elle peut être calculée pour un individu, une entreprise, à l’échelle d’un pays, pour un objet ou un service.
L’empreinte écologique (ou empreinte environnementale) est un indicateur de l’effet des activités humaines sur la nature. Contrairement à l’empreinte carbone, elle n’est pas focalisée sur les GES et considère l’impact environnemental plus global en comparant d’une part “la demande” (les activités humaines) et d’autre part “l’offre” (la capacité de la Terre à produire des ressources, à absorber des déchets et à se régénérer : la biocapacité). Elle est exprimée en hectares.
L’empreinte écologique tient compte de :
Le bilan carbone est une méthodologie de calcul développée par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) en 2004 pour mesurer l’empreinte carbone d’une entité, par exemple, d’un individu (on parle alors de “bilan carbone personnel”) ou d’une entreprise.
En utilisant un calculateur d’empreinte carbone ou de bilan carbone. Il en existe une ribambelle en ligne :
Ces outils sont gratuits, plus ou moins complets et assez longs à remplir. L’objectif est de passer en revue tous les postes de dépenses énergétiques sur une année puis de vous donner une approximation des émissions de gaz à effets de serre en lien avec votre mode de vie.
Par exemple un membre de l’équipe Projet Pangolin (moi…) a utilisé le calculateur de l’ADEME (nos gestes climat).
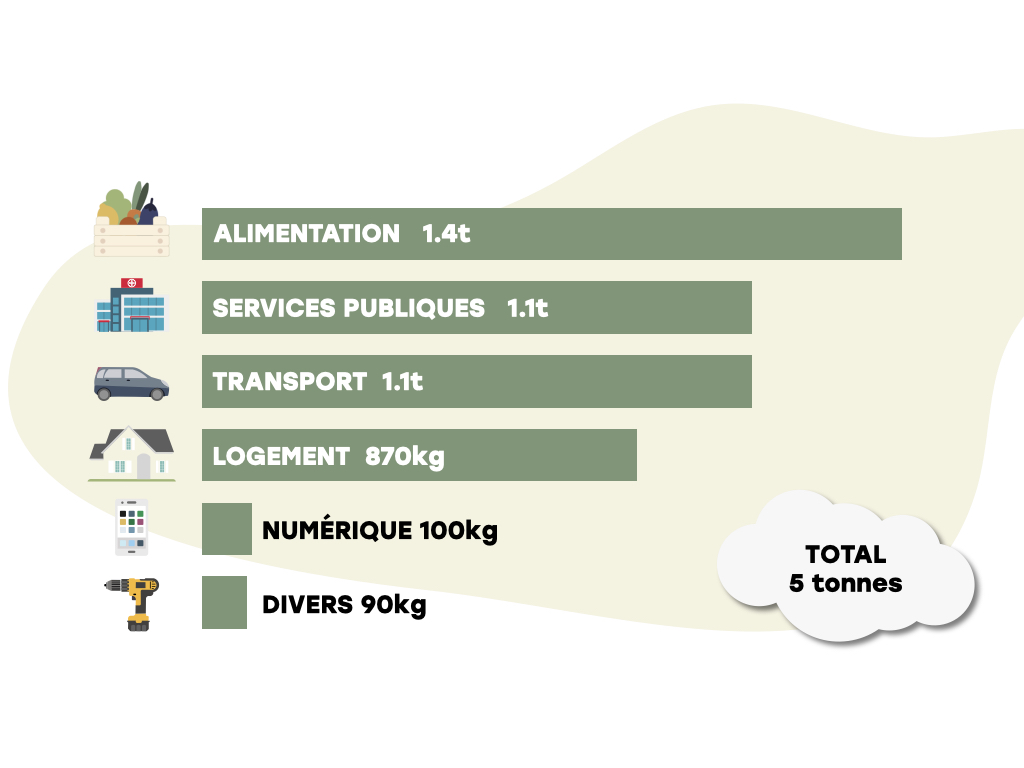
Résultat : Je produirais en moyenne 5 tonnes eqCO2 par an. C’est mieux que la moyenne des français qui se situe à 11 tonnes mais c’est LOIN de l’objectif des 2 tonnes qui doit être atteint si on veut rester sous la barre des 2°C (objectif maximal de réchauffement définit dans les accords de Paris, signés lors de la COP21).
D’après ma simulation, les postes énergétiques les plus couteux sont : l’alimentation, les transports et les services publics.
Pourtant, je n’achète pas de viande et je mange très peu de produits d’origine animale. Je fais tous mes trajets maison-travail à pied et j’achète mes vêtements très majoritairement de seconde main. Mais j’ai encore des progrès à faire, je le reconnais. Néanmoins, il y a un poste sur lequel je n’ai aucune emprise : les services publics. On en discute plus loin.
Avec un autre calculateur dédié, évidemment ! La liste d’options est nettement moins longue :
On trouve beaucoup de calculateurs d'empreinte écologique canadiens et suisses (et donc qui utilisent des valeurs moyennes de consommation propres à leurs pays). Vous pouvez les tester mais ils seront moins précis compte tenu que vous n'habitez pas là-bas.
Comme vu plus haut, l’empreinte écologique tient compte de l’impact des émissions de GES mais aussi de la capacité de la Terre à produire et se régénérer. C’est une autre forme d’approximation et c’est donc intéressant de faire les deux pour avoir une vision plus globale des conséquences de notre mode de vie sur la planète.
Par exemple, j’ai utilisé le calculateur de la fondation WWF qui utilise des moyennes suisses.
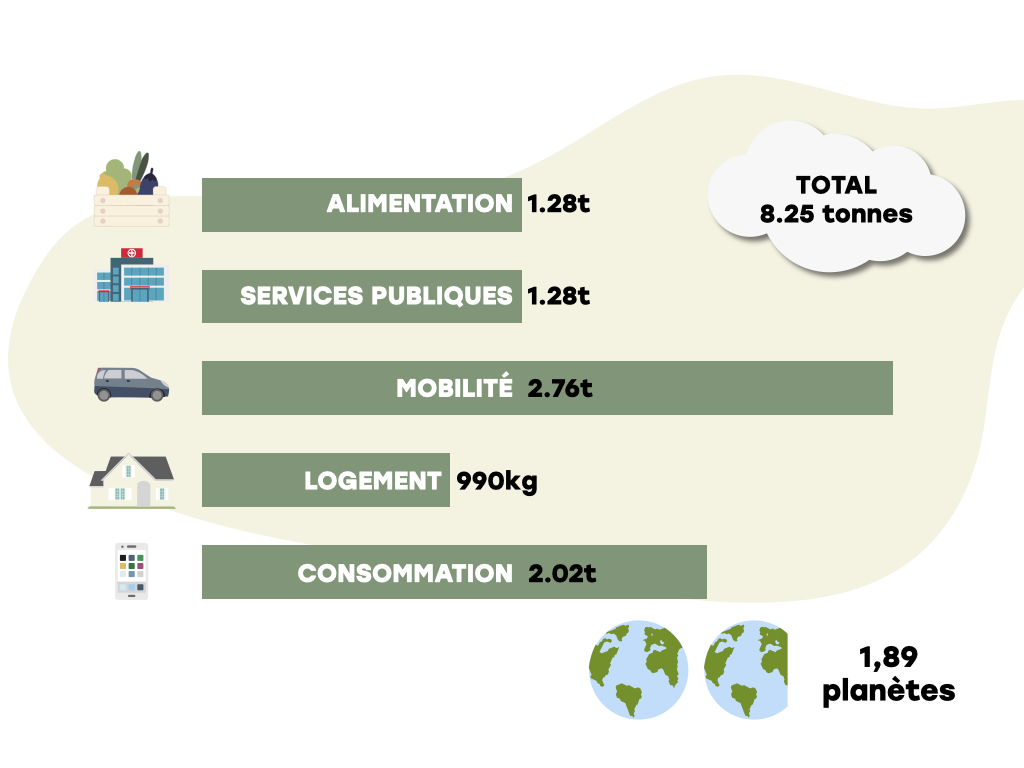
Résultat : avec ce calculateur je produirais en moyenne 8.25 tonnes équivalent CO2 par an. Il me précise que « Si l’ensemble de la population mondiale vivait avec ce même mode de vie, nous aurions besoin de 1.89 planètes. Malheureusement, nous n’avons que celle-ci. »
Tout d’abord le calculateur de la WWF m’a posé des questions sur mes 5 dernières années et ça ne fait pas 5 ans que je fais autant d’efforts pour le climat. De plus, ce calculateur ne se base pas sur les mêmes mesures que les calculateurs d’empreintes carbone puisqu’il intègre en plus l’impact sur les écosystèmes. Il est donc normal d’observer des résultats différents.
Ceci dit, les deux résultats vont dans la même direction : je pollue trop.
On ne vous propose pas un comparatif de ces différents calculateurs pour plusieurs raisons. 1- ca serait un cauchemar de réaliser une telle étude (nous ne sommes que des bénévoles pour cette association). 2- le but de ces calculateurs n'est pas d'avoir une estimation parfaite de notre empreinte carbone mais plutôt d'obtenir un ordre de grandeur. L'idée c'est de nous faire prendre conscience de l'impact de notre consommation et de décider d'agir en conséquence.
À la fin de certains calculateurs, après vous avoir annoncé votre énorme estimation d’émissions d’équivalent CO2 par an, on vous propose ce qui ressemble à une solution miracle : compenser vos émissions carbones. Mais qu’est-ce que cela signifie ?
Si vous nous lisez depuis longtemps, votre esprit critique et votre flair à trucs louches devraient s’agiter. Et vous auriez bien raison.
Lorsque ces fondations vous proposent de « compenser » vos émissions en leur faisant un don proportionnel à votre impact écologique, cela ne vient pas l’annuler comme par enchantement. Si ce geste est une bonne chose puisqu’il participe à financer des projets qui soutiennent la préservation de la biodiversité (en replantant des arbres par exemple), il n’efface en EN AUCUN CAS les conséquences de votre impact de vie sur l’environnement.
Eh oui, compenser en plantant des arbres et continuer à consommer comme nous le faisons (ce pourquoi on a besoin de déforester notamment) est contradictoire… on se doute donc bien que l’on ne pourra pas faire les deux en même temps !
Ces propositions de compensation sont souvent du registre de l’hypothétique. Elles sont basées sur l’idée que ces forêts replantées vont effectivement absorber autant de CO2 que ce qui est émis.
De plus, si l’on déforeste en arrachant des forêts centenaires, on ne replante que des jeunes arbres. Or , une forêt de cent ans n’a pas la même capacité “puit de carbone” qu’une forêt composée d’arbres de 2 ans (et qui seront surement tous de la même essence… un autre point bien négatif).
S’ajoute à cela qu’on suppose que ces forêts puissent vivre assez longtemps (et ne pas bruler, ne pas être impactées par le réchauffement climatique qui abime les forêts que nous avons déjà), qu’il y aura assez de place sur Terre pour planter tous ces arbres (et que l’on n’aura pas besoin de détruire d’autres écosystèmes pour planter ces fameux arbres).
Souvent, ces propositions sont en fait du treewashing, qui fait écho au greenwashing dont on vous parlait ici.
Un autre point important sur la compensation carbone concerne les océans. Ces derniers sont des puits de carbone très importants, comme les forêts. Pourtant, le réchauffement climatique acidifie l’eau et réduit la capacité des océans à stocker du carbone. On pourra planter tous les arbres que l’on voudra, on ne corrigera l’acidité des océans qu’en réduisant nos émissions.
En bref, compenser ses émissions pour atteindre la neutralité carbone n’est pas possible. Planter des arbres et restaurer les écosystèmes (et puits de carbone) est absolument ESSENTIEL, mais la neutralité carbone ne pourra être atteinte que si l’on réduit en parallèle nos émissions.
Un des problèmes principaux ici est le choix du terme « compenser » car il porte à confusion. On peut facilement croire que ce n’est pas grave de prendre l’avion puisque l’on reverse 3,42€ pour « compenser » notre vol. L’utilisation de ce mot peut avoir l’effet pervers de nous déresponsabiliser dans nos choix, de nous faire croire que si l’on se paie des « crédits carbone » alors on n’a pas d’impact environnemental.
Les entreprises s’en servent pour nous faire croire que ce qu’elles nous vendent est « neutre en carbone ». Mais gardez bien en tête que ces options ne viennent pas effacer nos actes, les GES émis sont toujours émis. Si c’était si simple, ça ferait longtemps qu’on aurait résolu le problème du réchauffement climatique, vous vous en doutez bien.
Souvent les résultats de ces calculateurs sont édifiants et on peut se sentir un peu désemparés. On ne se décourage pas pour autant ! On vous présente ici, les gestes les plus efficaces pour réduire son empreinte environnementale.
Pour la rédaction de cette partie nous nous sommes essentiellement basées sur un rapport de Carbone 4. N’hésitez pas à le consulter pour rentrer dans les détails.
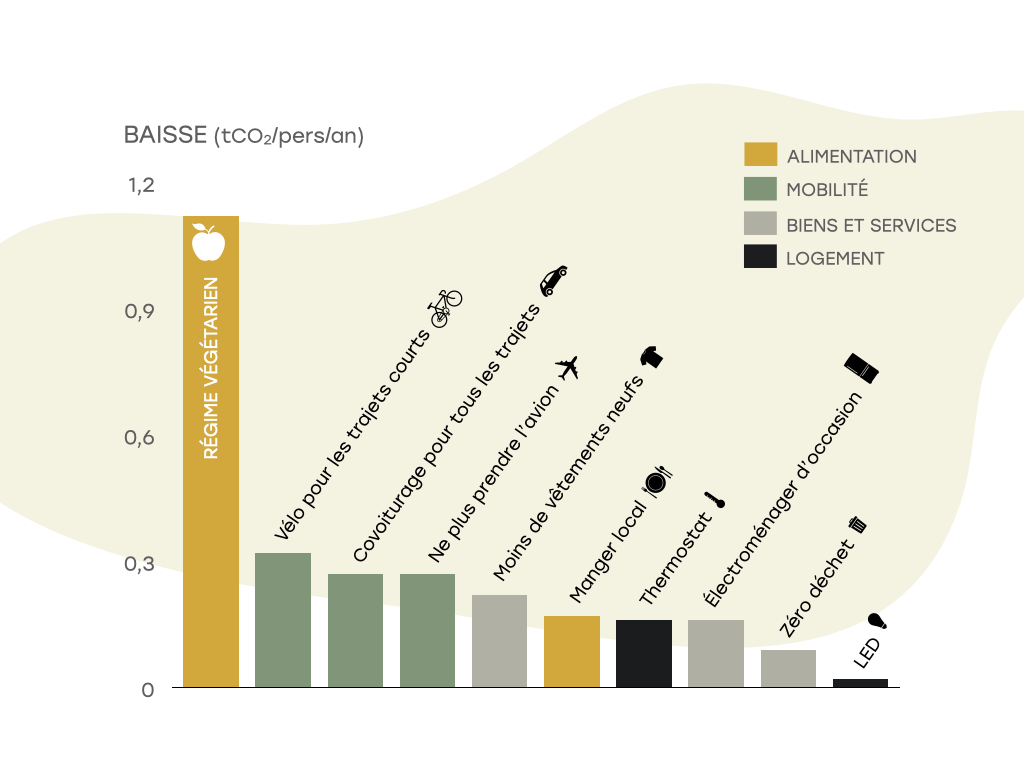
L’illustration juste au-dessus synthétise ce qu’on a appris de ce rapport. L’étude a classé 10 gestes individuels classiques en fonction de leurs impacts sur notre empreinte carbone :
Personne n'est parfait. Si l'on ne parvient pas à être 100% végétarien, on peut réduire sensiblement sa consommation de viande et autre produits animaux. Si l'on ne peut pas toujours covoiturer, on peut essayer de le faire le plus souvent possible. Cela permet de réduire son impact de façon importante, et de découvrir de nouvelles habitudes pour aller vers le mieux.
Ensuite, si vous êtes propriétaires de logements, vous pouvez faire plus : en investissant dans la rénovation de vos propriétés. Rénover le bâti existant représente un des challenges majeurs à relever et permet de réduire fortement notre empreinte carbone. Si vous en avez les moyens, alors :
Des crédits d’impôts sont proposés pour inciter les particuliers à rénover leurs logements (plus d’infos ici).
Enfin, dans le rapport de Carbone 4, un dernier geste est proposé : le passage à la voiture électrique. Notre avis sur la question n’est pas tranché. Comme vous le savez, en prenant en compte toute la chaine de production et en ajoutant le fait que l’électricité n’est pas 100% décarbonée, ça complique le débat (si vous voulez en savoir plus, RDV ici). En ce qui concerne les transports donc, ce qu’on vous conseillera toujours c’est de privilégier le train au maximum.
Le constat de ce rapport est que si on investissait tous pour rénover thermiquement nos logements au maximum, que l’on utilisait des voitures électriques et que l’on cumulait à la perfection tous les autres gestes que l’on vous a cité juste au-dessus, on aurait réduit nos émissions réelles de moitié. QUE DE MOITIÉ.
En effet, pour arriver à réaliser les objectifs de l’Accord de Paris (c’est à dire atteindre 2 tonnes d’émission équivalent CO2/an/personne), il faudrait (en plus de tout ce qu’on vient de citer) décarboner l’agriculture, l’industrie, les services publics, le fret de marchandises et les énergies. Autant de choses sur lesquelles on a, individuellement, qu’un pouvoir limité. Comment s’y prendre alors ? Penser collectif !
Tout ça donne un peu le vertige. Mais on ne se laisse pas abattre et qu’est-ce qu’on retient ?
Nous sommes victimes du système dans lequel nous évoluons. On ne peut pas faire changer le réseau de chauffage de l’immeuble que l’on habite juste parce qu’on l’a décidé, on ne peut pas arrêter de consommer certains outils technologiques car nos métiers en dépendent etc. Néanmoins, on peut choisir de prendre conscience de ses privilèges et essayer de réduire son impact autant que possible.
Les pratiques éco-responsables individuelles ont un impact non-négligeable (n’en déplaise à ceux qui affirment le contraire). L’adoption de ces gestes quotidiens permet de réduire significativement son empreinte carbone (de 10% en adoptant un régime végétarien, on vous le rappelle). Ils sont nécessaires mais malheureusement, ils ne sont pas suffisants.
La pollution liée aux activités humaines est systémique. Sans changement profond, au niveau des entreprises et à l’échelle étatique nous ne pourrons pas limiter nos émissions de GES et rester en dessous du seuil des 2°C.
Pourquoi ? Parce que 10% des citoyens de l'Union Européen (les plus riches, 43,6 millions d'individus) émettent autant de GES que 50% des citoyens les plus pauvres (216 millions d'individus). Il faut donc réduire les émissions des pays les plus riches pour tenir les objectifs des accords de Paris. Et, à moins que vous soyez PDG de multinationale, ce changement ne s'effectuera que grâce à une révolution du système.
Nous appartenons à l’espèce Homo sapiens. En tant que tel, nous sommes des individus sociaux capables de communiquer mais aussi de s’organiser autour d’un récit commun.
Aujourd’hui, au sein des démocraties (ahem des fois on se pose des questions mais bon.. au passage #darmaninDémission #ACAB) que nous habitons, nous avons un rôle à jouer. Pour pousser nos gouvernements à agir il ne suffit pas de râler dans nos salons. Il faut passer à l’action, concrètement. Il y a une infinité de formes de passage à l’action : en parler avec ses ami.e.s/familles, s’inscrire sur les listes électorales de sa municipalité et voter, créer des initiatives locales pour développer des solutions entre citoyens, organiser/participer à des manifestations etc.
Nous devons prendre nos responsabilités individuellement en agissant dans notre quotidien mais aussi de manière collective, main dans la main. Sans cette étroite collaboration, nous ne pourrons pas respecter les objectifs de l’Accord de Paris et notre avenir restera plus qu’incertain.
[1] IPCC Fifth Assessment Report, 2014
[2] https://www.liberation.fr/apps/2018/09/empreinte-carbone/
La viabilité économique des entreprises européennes est-elle plus importante que les vies d’hommes, de femmes, d’enfants dans les pays non européens ? Justifie-t-elle la destruction d’écosystèmes entiers et la mise en péril de la biodiversité ?
Pour moi, la question ne devrait même pas se poser. En effet, on ne peut pas placer la production d’un produit par delà les droits humains. Pas plus que l'on ne peut la placer outre la protection de l’environnement, sans lequel nous n'existons même pas.
Avec une grande tristesse, je constate chaque jour que beaucoup méprisent la nature. Enormément de personnes n’arrivent pas à saisir la folie que représente la transgression des limites planétaires. Il est donc facile d'oublier l'environnement dans les business plan. Mais comment est-ce que l’on peut concevoir de faire du business aux dépens des droits humains ? D'autant plus en France où on se glorifie depuis 200 ans d’être le pays des droits de l’Homme ?
Que je le comprenne ou pas, la question se pose en effet. En conséquence, la France a dû légiférer en 2017 pour créer une obligation légale de vigilance : le Devoir de Vigilance. Les grandes entreprises sont depuis tenues de surveiller les pratiques de leurs fournisseurs et partenaires. Le but : éviter ou atténuer toute transgression des droits humains et/ou environnementaux. Alors, oui, cela entraîne des coûts supplémentaires. Mais ces surcoûts semblent nécessaires pour pouvoir continuer à se regarder dans le miroir tous les matins… C’est le prix de la conscience tranquille, le prix de savoir que l’on œuvre sans faire de mal.
Sur le papier, le Devoir de Vigilance est une avancée fulgurante puisqu’apparemment le proverbe ‘loin des yeux, loin du cœur’ s’appliquait trop souvent aux entreprises qui sous-traitaient sans vérifier les conditions de production. Toutefois en pratique, sa portée semble assez limitée :
Plusieurs entreprises ont été mises en demeure, c’est-à-dire formellement accusées de faillir à leur devoir de vigilance, depuis la publication de la loi. TotalEnergies établit le record à 4 mises en demeure, dont celle en lien avec la mise en danger des communautés locales et de l’environnement en Ouganda. La justice s'est prononcée en décembre 2023 et a jugé l'affaire irrecevable. Fait intéressant, il n’y a pas eu de décision quant à la violation des droits humains rapportée par les associations. La décision a porté sur la forme de la procédure.
La seule entreprise à avoir été condamnée, en décembre 2023, est La Poste. La condamnation a pointé un manque de précision dans la cartographie des risques du groupe. La cartographie ne permettait pas une juste appréciation des risques liés à l'emploi des sans-papiers. La Poste a reçu une injonction pour s'améliorer, ce qu’elle dit avoir déjà fait dans les 3 ans qui ont séparé la mise en demeure et le verdict. On pourrait s’interroger sur la pertinence de prononcer un jugement 3 ans plus tard pour des pratiques en cours.
À noter que les mises en demeure continuent de se multiplier. Parmi les dernières et en lien avec l’environnement, on note Carrefour, pour ses pratiques d’approvisionnement en thon, épinglé notamment par l’association Bloom, et Danone pour son manque de plan pour sortir du plastique.
Après de longs échanges, les députés européens ont validé en décembre 2023 la Corporate Sustainability Due Diligence Directive ou CSDDD. Ce texte a pour objectif d'établir un Devoir de Vigilance au niveau européen. En comparaison du texte français, la vigilance s’appliquerait à davantage d’entreprises, et prévoirait des sanctions monétaires.
Cette directive importante est aujourd’hui bloquée, au point mort, et certains la disent même enterrée. Le problème (principalement cité) ? La lourdeur administrative qu'imposent les contrôles supplémentaires chez les fournisseurs et partenaires, et la possible perte de performance économique associée.
Dans quel monde sommes-nous pour justifier le report d’un texte sur la préservation des droits humains pour cause de surplus de paperasse ? Sommes-nous si profondément embourbé dans un monde où la performance économique est reine que nous n’avons plus aucune honte à dire que générer de l’argent en Europe est plus important que de s’assurer que l’on ne détruit pas des vies ailleurs dans le monde ?
Si notre système économique est incompatible avec la protection sans condition de la justice sociale et de l’environnement, le système doit changer.
Dr Manul
La production de connaissance et sa transmission suivent des règles particulières créées par des humains. Elles sont donc imparfaites, subjectives et sujettes à co-évoluer avec les humains qui les façonnent. Cet article a pour objectif de vous présenter le système de publication scientifique qui représente le médium majeur de transmission de la connaissance entre scientifiques.
Vous trouverez dans les prochaines lignes :
Dans un second article nous reviendrons sur les limites et critiques de ce système. Bonne lecture !
Pour la définir simplement, la recherche scientifique est « un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un•e scientifique, ayant pour objet de vérifier des théories déjà existantes mais également de produire et améliorer la connaissance » [1].
En France, elle est effectuée par des chercheureuses mais aussi des étudiants, des assistants, des techniciens et des ingénieurs. Ils et elles travaillent dans des établissements d'enseignement supérieur (universités), des organismes de recherche (CNRS ou l’institut Pasteur par exemple), ou dans des entreprises (recherche privée) [2, 3].
Différents adjectifs sont souvent accolés au terme de recherche. En général ils désignent le mode de financement ou l’objectif avec lequel la recherche est conduite.
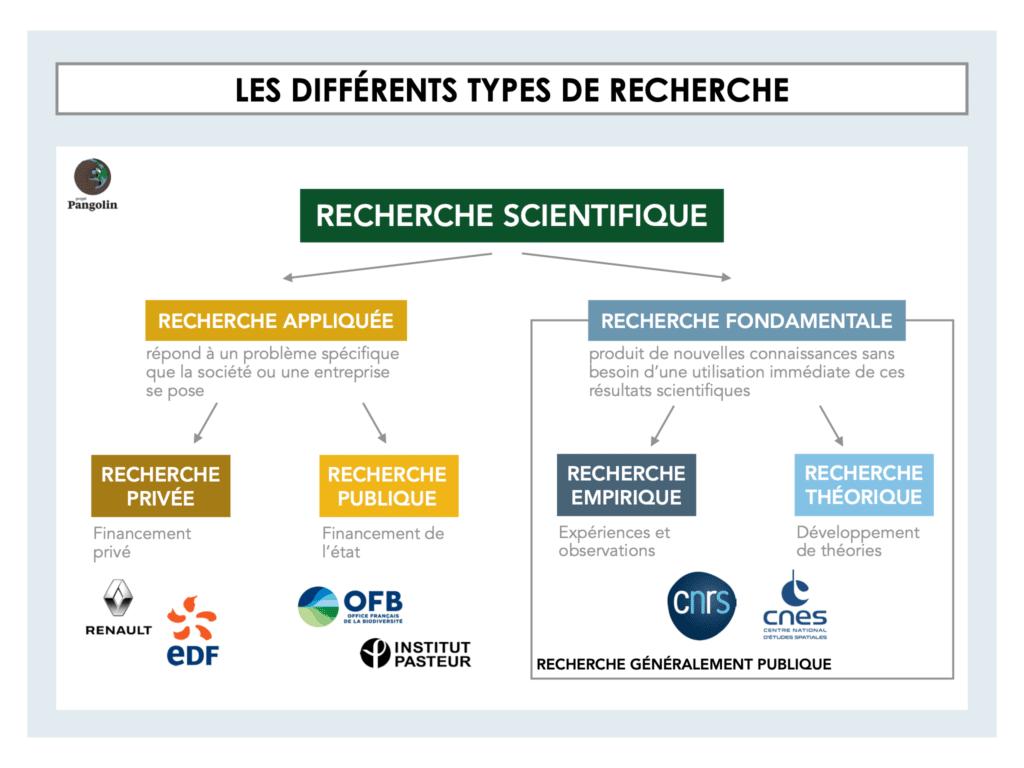
On peut diviser la recherche en deux grandes catégories : la recherche appliquée et la recherche fondamentale [4]. Néanmoins, gardons en tête que beaucoup de projets se retrouvent à la frontière entre ces deux catégories.
La recherche appliquée répond à un problème spécifique que la société se pose à un instant t.
Si cette question intéresse des entreprises, il y a de fortes chances pour que cette recherche trouve des financements dans le secteur privé. Dans ce cas particulier de la recherche appliquée privé, les travaux des scientifiques sont inscrits dans les objectifs de l’entreprise et de la fondation auxquels ils appartiennent. En 2010, dans le secteur privé, les domaines les plus financés étaient : l’industrie (automobile, aéronautique/spatiale, pharmaceutique, chimique), les activités informatiques et services d’information, la production de composants électroniques (ordinateurs, périphériques) [2].
Il se peut que la question n’ait pas de valeur marchande potentielle mais que la société ait quand même besoin d’une réponse. Alors, la recherche appliquée sera financée sur des fonds publics. Comme par exemple l’impact des éoliennes sur la biodiversité locale et les moyens de l’atténuer [5].
La recherche fondamentale produit de nouvelles connaissances sans pour autant nécessiter une utilisation immédiate de ses résultats. Elle regroupe des travaux de recherche empiriques ou théoriques. La recherche fondamentale constitue un véritable socle de connaissance pour la recherche en général, dont la recherche appliquée [6].
Au sein de la recherche fondamentale on distingue la recherche empirique. On la définie comme toute recherche dans laquelle les conclusions de l'étude sont tirées strictement de preuves issues d’expériences ou d’observations. On retrouve des projets comme la communication chimique chez la marmotte alpine [7] ou la description des limites d’un courant méditerranéen en utilisant des données radar [8].
La recherche théorique illustre une dimension encore plus universelle de la connaissance. L’idée est de développer des théories qui expliquent la réalité qui nous entoure. En général, cela revient à représenter un phénomène sous la forme d’équations. On pense par exemple au principe de la relativité ou la théorie de la sélection naturelle.
La récolte de fonds est une partie cruciale de la recherche scientifique, et souvent la bête noire des chercheureuses. En effet, il revient aux chercheureuses de trouver l'argent pour financer leur activité de recherche. Toute leur activité de recherche : matériel, les locaux, les déplacements, les salaires du personnel qui vont participer etc.
La recherche scientifique repose sur le travail assidu de chercheureuses partageant leurs réflexions et découvertes sur une thématique [9,10]. Mais attention, ce travail ne se fait pas en un claquement de doigts. Il peut s’écouler plusieurs années entre l’idée de départ et la publication des résultats.
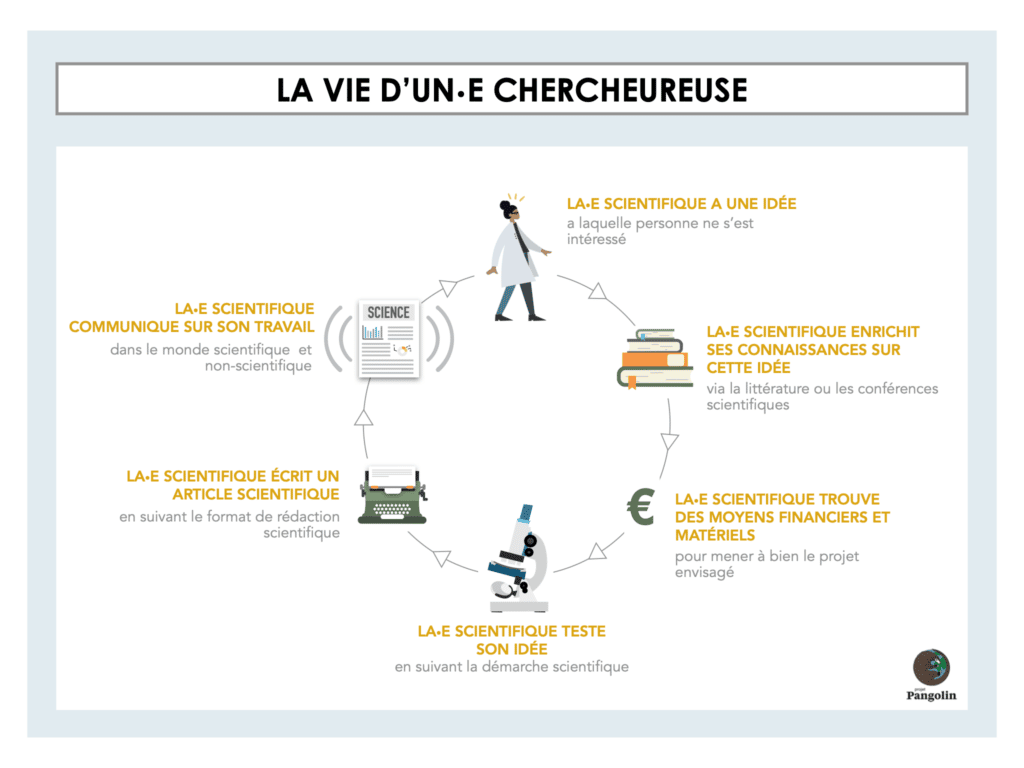
Avant d’avoir un travail abouti, la•e scientifique doit avoir une connaissance approfondie du sujet sur lequel iel travaille, récoltant le maximum d’informations dans la littérature scientifique ou au cours de conférences. Iel va par la suite suivre une démarche bien précise, partant à la base d’une observation qui va l’intriguer et soulever plusieurs questions. Iel pourra ensuite émettre des hypothèses sur la base de ses connaissances et de la littérature pour y répondre. L’objectif de l’étude va être de tester ces hypothèses, puis d’aboutir à une conclusion qui les confirmera ou les infirmera.
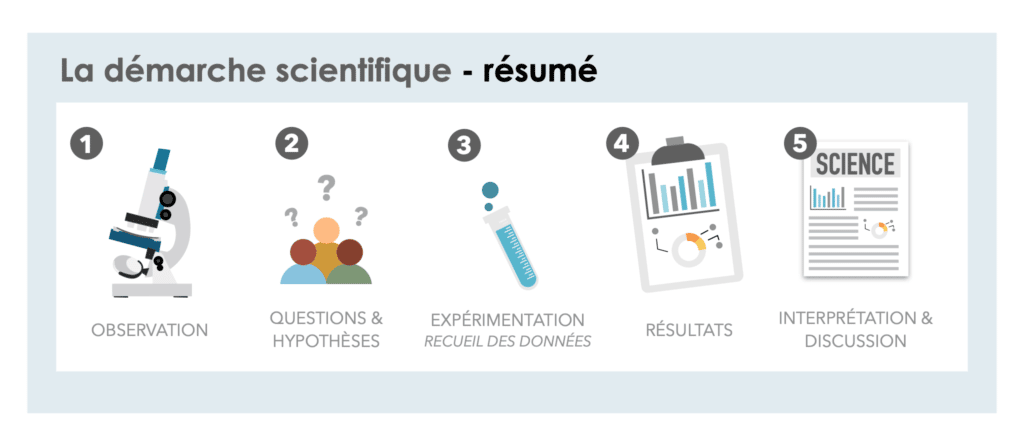
Une fois que les résultats produits sont satisfaisants, la•e scientifique va les communiquer. Au travers de divers supports : rapport technique, article scientifique, présentation lors de congrès scientifiques. Cela permet de valoriser son travail, de combler une partie des lacunes, de le soumettre à la critique et de se faire connaître dans le milieu scientifique, mais aussi non scientifique.
Il existe encore aujourd'hui une rupture entre la communication scientifique auprès du grand public ou de l'audience scientifique. La vulgarisation des travaux de recherche, rendant de concepts complexes compréhensibles pour tout un chacun, a souvent été mise de côté. Or cela devrait faire partie intégrante du métier de chercheureuse.
Pour remplir son rôle principal, la recherche scientifique se doit d’être diffusée auprès d’un large public scientifique. Ainsi, les dernières connaissances peuvent être utilisées par d’autres personnes pour continuer l’infatigable construction du savoir. Il existe plusieurs façons pour un•e chercheureuse de diffuser ses travaux. Nous allons nous concentrer sur son outil fondamental : l’article scientifique.
L’article scientifique est le produit final de tout travail de recherche et sa rédaction constitue une part de travail colossal [11,12]. Il s’agit d’un exercice de rédaction compliqué car l’écriture scientifique a ses propres codes : phrases courtes, directes et utilisant la forme passive. La•e scientifique doit respecter un plan normalisé propre à tout article scientifique, constitué de sept grandes sections :
Le fait que tout article scientifique suive cette structure formatée permet aux lecteurices d'aisément se situer dans l'article et de pouvoir en extraire les informations souhaitées. Grâce à cette organisation, il est facile pour d’autres chercheureuses d’utiliser la nouvelle technologie décrite dans l’article et ainsi d’assurer la reproductibilité de l’étude. Pour être admise par la communauté scientifique, il est nécessaire qu'une mesure ou découverte soit confirmée par plusieurs travaux. Les chercheureuses lisant l’article vont aussi pouvoir tester la nouvelle technologie mais dans un contexte différent qui n’avait pas été envisagé par les auteurices au départ (e.g., développement d’un vaccin, utilisation de CRISPR-Cas9 etc.).
Enfin un autre avantage découlant de cette architecture se trouve dans la bibliographie qui constitue un outil à part entière. En citant les références d’autres articles, les auteurices entretiennent, construisent et partagent leurs connaissances sur le sujet développé.
Chaque année des événements scientifiques ont lieu, en France ou à l’étranger, réunissant les chercheureuses du monde entier pour exposer leurs travaux, rencontrer des confrères et discuter de leurs recherches. Ces congrès sont payants, plus ou moins grands (entre 100 et plusieurs milliers de personnes), et permettent à la communauté scientifique de se rassembler autour d’une thématique. On retrouve deux manières de présenter un travail lors d’une conférence scientifique [13]:
Les laboratoires de recherche, pour promouvoir l’animation scientifique au sein de leur structure organisent des séminaires faisant intervenir divers chercheureuses d’autres établissements. Les bénéfices sont multiples : débat scientifique, partage de résultats récents, mais surtout rencontre entre confrères pouvant déboucher sur de potentielles futures collaborations.
Les outils de transmission ne se limitent pas aux exemples présentés précédemment. Les chercheureuses peuvent communiquer via d’autres types d’articles scientifiques comme les revues de littérature (résumé de l’état de l’art sur un sujet spécifique), les méta-analyses (regroupement de résultats sur un sujet spécifique tentant d’en extraire une interprétation générale), les notes d’opinion etc. Ces formats sont soumis à un comité de lecture. Enfin iels ont aussi l’occasion de produire des livres. Cependant ils ne sont pas nécessairement soumis à la relecture par les paires. Leur fiabilité peut donc être très hétérogène.
Entre la production d’un article scientifique et sa publication il y a de nombreuses étapes.
Dans un premier temps, le•a scientifique va produire de la connaissance en respectant la démarche scientifique et va restituer cette connaissance sous un format très spécifique : un article scientifique. Il sera relu et modifié par les co-auteurices plusieurs fois.
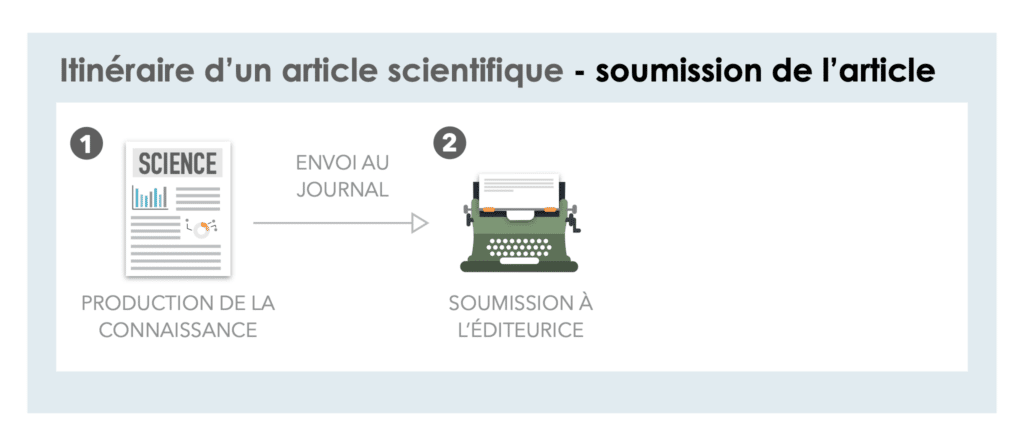
Une fois que cet article est rédigé, il est envoyé à un journal scientifique qui est chargé de le diffuser. L’article arrive tout d’abord dans les mains d’un•e des éditeurices du journal. Son rôle est d’évaluer la correspondance de l’article avec son journal. Chaque journal publie dans un domaine scientifique particulier. En fonction de la réputation de ce dernier il peut se permettre d’être plus ou moins pointilleux. L’éditeurice lit des articles dans des domaines très différents dont iel n’est pas forcément expert •e et doit prendre une décision après une lecture rapide.
À ce stade le destin de l’article peut prendre deux chemins :
1 - l’article est refusé, il sera alors impossible de resoumettre les mêmes résultats à ce journal même s’ils sont retravaillés.
2- l’éditeurice trouve l’article intéressant et souhaite le publier.
Un article peut être refusé pour une variété de raisons. Par exemple, il ne correspond pas au thème du journal, les résultats sont trop préliminaires, la rédaction de l'article est de piètre qualité, la question posée n'est pas assez originale etc.
Si l’article a été apprécié en première lecture par l’éditeurice, iel l’envoie à 2-3 « examinateurices » (la traduction française n’est pas idéale, on parle de reviewers en anglais). Iels sont chercheureuses comme les auteurices et sont vraiment spécialistes du sujet (contrairement à l’éditeurice). Iels vont lire l’article en profondeur et faire des commentaires détaillés sur ce qu’iels estiment devrait être différent.
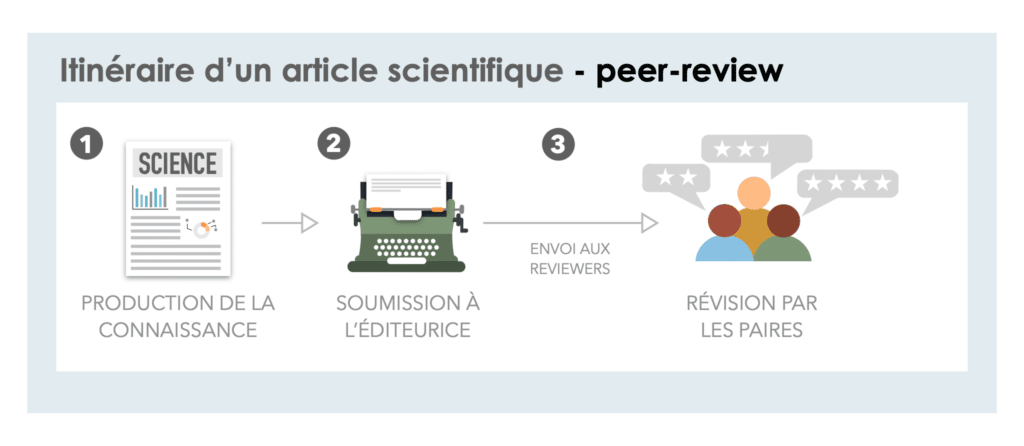
Les chercheureuses assument cette fonction bénévolement en plus de leurs travaux de recherche et leurs charges d’enseignement. En général, les chercheureuses produisent entre 2 et 10 révisions par mois. Cela constitue une partie non-négligeable du métier.
À la fin de leur revue ils et elles communiquent à l’éditeurice l’intégralité de leurs commentaires. Ils et elles précisent aussi si l’article devrait être publié selon elleux.
Il est fréquent que ce processus soit complètement anonyme : l’identité des auteurices et des reviewers n’est connu que de l’éditeurice. Cette pratique est censée garantir un jugement objectif et limiter les règlements de compte entre équipes concurrentes. Les scientifiques restant des humains, ils et elles peuvent avoir des comportements discutables.
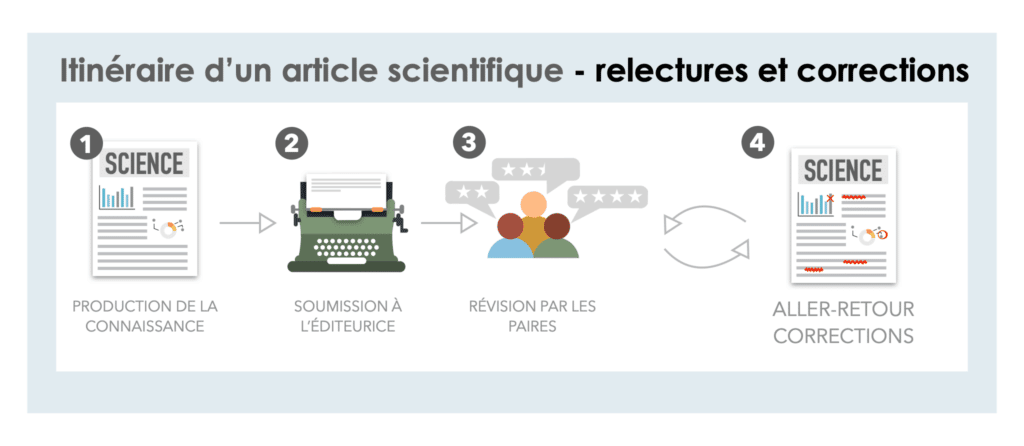
À ce stade l’éditeurice décide si :
1 - l’article est refusé car les remarques des reviewers l’ont convaincues que l’article n’était pas pertinent.
2 - l’article doit être modifié. On parle de révisions majeures ou mineures en accord avec les commentaires des examinateurices.
L’article entre alors dans une boucle d’aller-retour. D'un côté, les auteurices prennent en compte un maximum de modifications proposées puis les examinateurices qui en retour déterminent si les modifications sont satisfaisantes et/ou proposent de nouveaux changements.
Cette étape constitue un élément crucial de la recherche scientifique : c’est ce qu’on appelle la révision par les paires. Si une fraude est suspectée, si la méthode utilisée semble douteuse, si les statistiques présentées ne sont pas adéquates : il y a de fortes chances pour que le problème soit détecté à cette étape. Dans ce cas-là, l’article sera rejeté. Le travail des examinateurices est un des garde-fous de la recherche car il permet de vérifier la fiabilité des résultats avant qu’ils soient rendus disponibles à la lecture. C’est ce qui en fait sa force aussi. Ce système est loin d’être parfait mais il est constitutif de la recherche scientifique et garantit un jugement critique des nouveaux résultats produits.
Il est fréquent d'entendre des médias mainstream reprendre les titres d'articles scientifiques un peu originaux (ou pouvait générer du clic) les présentant comme une actualité ou un fait avéré alors que ces articles n'ont pas été soumis à la révision par les paires. Apprenez à rester critique dans ces cas particuliers. Il se peut que les résultats soient fiables tout comme le contraire !
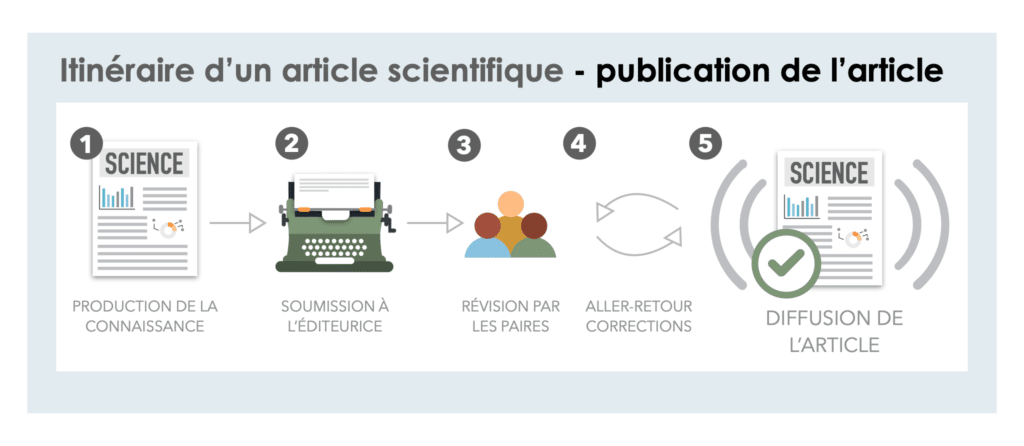
Une fois que les reviewers et l’éditeurice sont satisfaits de l’état de l’article, il est publié ! Comme vous l’aurez deviné, toutes ces étapes signifient que de long mois (parfois années) peuvent s’écouler entre la première soumission de l’article et sa parution. Ces délais, qui peuvent être colossaux, constituent un des défauts majeurs du système.
On se rend compte que la publication de connaissance prend beaucoup de temps dans la vie d’un•e scientifique. Il s’avère que ces publications jouent même un rôle critique dans la carrière des chercheureuses.
Certains journaux ont une meilleure réputation que d’autres et ce pour tout un tas de raison : l’ancienneté du journal, la langue utilisée, l’originalité des résultats publiés etc. Ils sont à la mode et donc naturellement, les chercheureuses vont préférer voir leurs travaux publiés dans ces journaux [15]. De plus en plus de soumissions vont être proposées et les éditeurs peuvent se montrer plus difficiles dans l’acceptation des articles. Par exemple la revue pluridisciplinaire Nature révèle que seules 7,6% des papiers soumis étaient finalement publiés en 2017 [14] alors qu'une revue plus spécialisée comme Methods in Ecology and Evolution a un taux d'acceptation de 20%.
Une publication dans un de ces journaux connus va donc paraître plus intéressante que dans un journal moins côté. Elle peut être la clé pour obtenir un poste que le•a scientifique convoite.
Il ne suffit pas de viser des journaux ‘prestigieux’ pour avoir une carrière réussie, il faut aussi publier en quantité. L’obtention de postes, de bourses et donc les possibilités de continuer à travailler en tant que chercheureuse dépendent de cette performance. Les anglo-saxons ont trouvé un adage très parlant pour résumer cette situation : Publish or perish(publier ou périr).
Dans la suite de cet article nous allons nous intéresser à l’évolution du système de publication depuis les balbutiements de la méthode scientifique jusqu’à nos jours.
Pendant très longtemps en Europe, la pratique des sciences était réservée aux élites. C'était souvent aux hommes de lettres fortunés qui avaient le temps et l’argent suffisants de s’adonner à l’observation du monde et de ses phénomènes. Durant toute la Renaissance, la science était la pratique d’un nombre restreint de lettrés et la transmission des découvertes et des données se faisait au sein de réseaux très fermés. En somme, les plus riches faisaient la science et les plus riches lisaient également cette science.
Au XVIIIème siècle, la philosophie de la science change. Les sciences doivent contribuer au progrès des sociétés et se doivent, de ce fait, d’être transmises au plus grand nombre. Les ouvrages de vulgarisation scientifique se multiplient car la science doit être accessible à « tous ». Ils sont bien souvent les sujets de discussion des salons mondains.
Au XIXème siècle, la science reste encore le domaine des plus riches. Néanmoins sa transmission se fait plus grande, et ce, notamment par la création de grandes institutions telle que le Collège de France ou des Université comme à Bâle ou Göttingen qui vont petit à petit populariser le domaine. De nouvelles disciplines voient le jour comme la paléontologie. De nombreux lieux dédiés à l’apprentissage ou l’expérimentation se créent. C’est le temps des jardins zoologiques et botaniques, des grands laboratoires et des universités. C’est le siècle où l’on commence à vouloir décrire le monde en entier. Les sciences deviennent l’affaire de toutes et de tous.
Au XXème siècle, les grandes découvertes scientifiques et techniques rendent visibles les sciences au grand public et démocratisent leur pratique. Les progrès en médecine, en informatique ou en aérospatial façonnent le quotidien de toustes.
Le XXIème siècle est l’âge du numérique. L’information est partout. La science est faite par de nombreux scientifiques à travers la planète, issus de tous milieux. Elle se transmet partout dans le monde via les journaux scientifiques en ligne.
On peut dater l’apparition des premiers journaux scientifique à 1665. À cette date, le journal français « Journal des savants » et le journal anglais « Philosophical Transactions of the Royal Society » commencent à publier systématiquement les résultats d’études scientifiques [17]. Mais il faudra attendre le XVIIIème siècle pour voir un véritable essor de la publication dans des revues, avec la création de milliers de journaux scientifiques, bien que beaucoup furent éphémères. Dès lors, leur nombre n’a fait que d’augmenter.
À partir du milieu du XXème siècle, cette accélération devient brutale et sera de nouveau accentuée avec l’arrivée du numérique vers le milieu des années 1980 où le million de papiers publiés par an sera dépassé [18].
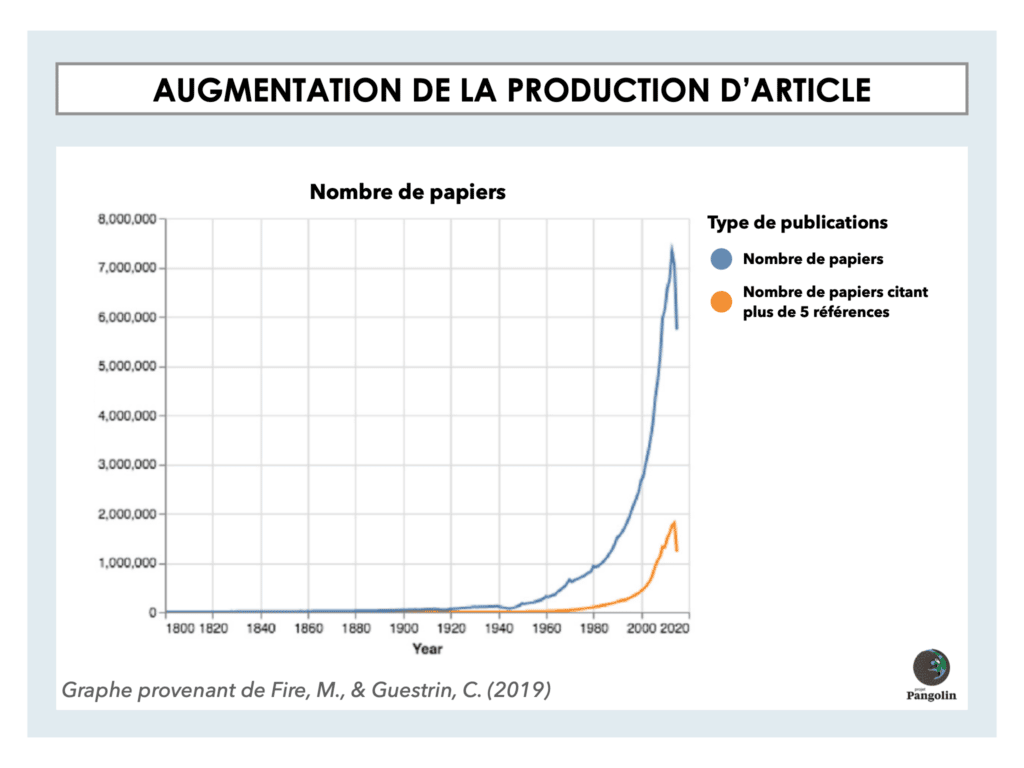
Les publications suivent une même trame méthodologique qui rend la lecture et la recherche de l’information plus rapide et facilite le travail bibliographique. Mais ce principe est relativement récent dans l’histoire de la science.
L’expérimentation a souvent été utilisée par les scientifiques pour émettre des théories et tenter de comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, elle n’était quasiment jamais mise en œuvre de manière systématique pour éprouver les observations et tenter de trouver des moyens de comparaisons pour comprendre les fonctionnements du monde vivant (notamment) comme on pouvait le faire en physique ou en chimie.
Cette révolution arrivera en 1865 avec la parution du livre de Claude Bernard « Introduction à l’étude de la médecine expérimentale » [16]. C’est dans cet ouvrage que le médecin et physiologiste originaire du Rhône instaure les premières bases de la méthode expérimentale. Claude Bernard déplore en effet les conceptions de son époque. Notamment concernant la physiologie, basées essentiellement sur des observations et presque jamais éprouvées de manière expérimentale. Il dénonce « l’esprit de système » dans la science et accuse notamment les scientifiques du Collège de France de conduire des expériences pour démontrer leurs théories plutôt que de les confronter aux faits. Il explique alors qu’en suivant des règles, les scientifiques pourront alors établir les conditions de manifestations des phénomènes et émettre des lois.
Voici les différentes étapes qu’il énumère et qui restent encore à ce jour un plan d’action global utilisé pour les études scientifiques actuelles :
Suite aux Observations d’un phénomène, les scientifiques formulent des Hypothèses. Ils vont ensuite concevoir une Expérience pour tester lesdites hypothèses. Puis, ils mettent en place l’expérience dont ils collectent les résultats. Vient le moment de comparer leurs résultats avec ce qui était attendu. Enfin, ils communiquent leurs résultats et leurs conclusions.
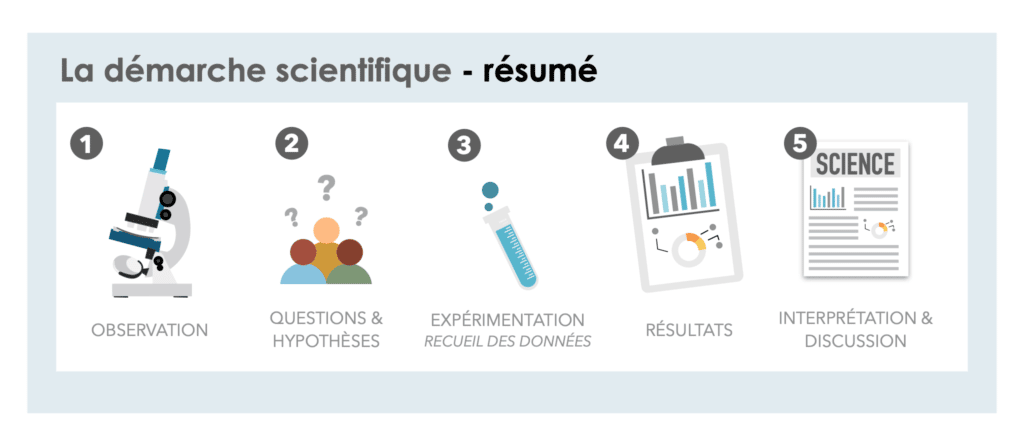
Cette méthode expérimentale, nouvelle pour l’époque, particulièrement pour les domaines de la biologie comme la médecine, va perdurer et devenir la base de la démarche scientifique dans de nombreux domaines. Claude Bernard a en effet posé les premières pierres qui serviront de socle à la publication scientifique moderne telle qu’on la connait !
Il y a 50 ans, dans les années 1970, le monde rentrait graduellement dans l’ère numérique des réseaux informatiques, ce qui débouchera des années plus tard sur la révolution qu’est internet.
Initialement, l’objectif concernant les publications scientifiques ne se limitait qu’à une simple numérisation de toutes études déjà éditées sur papier. Mais avec la popularisation des ordinateurs portables, dans les sphères professionnelle et publique, il est vite apparu que l’information scientifique pourrait être massivement diffusée et facilement accessible à distance.
En 1991, l’éditeur Elsevier lance un programme visant à analyser la possibilité de diffusion de journaux électroniques. Ce programme nommé Tulip (The University Licensing Program), en association avec 9 universités américaines, débouche sur un système opérationnel en 1993 puis plus tard sur la création du site Science Direct en 1997. En parallèle, toujours dans les années 1990, d’autres éditeurs emboîtent le pas tels que Cambridge University Presse, Oxford University Press, American Chemical Society ou National Academy of Sciences.
Le DOI (Digital Object Identifier) voit le jour en 1994. C’est un numéro unique qui est attribué à chaque document et qui permet l’identification stable de toute publication. En 1995 est notamment créé JStor (Journal Storage), une importante plate-forme de stockage électronique de publications. Ainsi, jusqu’au début des années 2000, les acteurs américains et anglais vont majoritairement façonner le paysage de la publication scientifique numérique et assoir le modèle économique qui ne changera que très peu par la suite.
Cette course au numérique a vu émerger des leaders du marché dont les décisions pèsent énormément dans le fonctionnement de la publication. Pour exemple, les grandes maisons d’édition que sont Elsevier, Springer Nature, Wiley,Taylor & Francis ou American Chemical Society publient en 2017 un peu plus de 56 % des articles produits en Europe et concentrent à eux seuls 65 % des dépensent concernant les achats de publications et review [20].
Cet écosystème d’éditeurices, très particulier, avec de très grosses entreprises mais également un nombre de journaux croissant et un nombre de chercheureuse tout aussi en hausse, entraîne malheureusement une grosse compétition qui amène à des prix de publication de plus en plus élevés. La pression du Publish or Perish est alors accrue par la difficulté de publication, essentiellement financière.
Des mouvements émergent alors pour la gratuité de la publication scientifique ou système d’Open Access. De cette logique naîtra notamment Wikipedia en 2000.
En somme, l’ère de la publication scientifique numérique a certes accru le potentiel de transmission des données scientifiques à travers le monde, mais elle a aussi engendré des crispations dans la façon de publier.
Le monde de la publication scientifique est désormais partagé entre les intérêts commerciaux des grands éditeurs et les intérêts scientifiques.
Avec l’augmentation vertigineuse du nombre de publication et celle du nombre de chercheureuse, il est très vite apparu dans le système de publication l’idée (discutable) que l’on pouvait exprimer la qualité des recherches d’un.e chercheureuse par son nombre de publication ainsi que la qualité (aussi évaluée par nombre de publications) de la revue dans laquelle iel publie. Ce concept apporte alors une pression incessante qui pousse tout scientifique à publier régulièrement (Publish or Perish).
Face à une telle pression, de nombreuses dérives ont vu le jour. Malheureusement elles façonnent désormais en partie le format de publications actuelles. Les formats sont par exemple de plus en plus courts. La taille des publications en nombre de pages a fortement diminué ces dernières années. Des papiers plus courts permettent effectivement de publier plus vite et plus souvent.
Un aspect de certaines études scientifiques a également disparu. De moins en moins d’études cherchent à recréer, répéter ou re-tester des expériences dont les résultats ont déjà été publié. Les études de validation n’ont plus le vent en poupe. Une certaine « course à l’originalité » s’est imposée. Elle force à toujours publier de nouveaux résultats, de nouvelles études et sur de nouveaux sujets, dont la valeur est plus forte aux yeux des éditeurs. Pourtant, l’une des forces de la science moderne est cet aspect de validation par la communauté entière. Publier des résultats similaires à une étude antérieure est tout aussi scientifiquement crucial que de publier de nouvelles données.
Plus encore, cette course effrénée du Publish or Perish peut amener à certaines méconduites voire franchir la frontière de la fraude. Publier à tout prix peut pousser à segmenter une publication en plusieurs petites pour augmenter artificiellement le nombre de papier. On parle de saucissonnage. Des données contradictoires peuvent être oubliées voire volontairement omises ; c’est la falsification.
Bien d’autres négligences ou erreurs peuvent arriver, majoritairement de manière non intentionnelle, mais elles font partie intégrante de la publication actuelle. Le nombre de publications retirées pour cause de mauvaises données, fraudes ou erreurs a presque été multiplié par 10 durant la dernière décennie [20].
Cet article est une introduction à un prochain article qui sera disponible courant juillet. Ce dernier portera sur les limites du système de publication scientifique actuelle. Mais pour vous permettre de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette histoire, il était nécessaire de dresser un état des lieux et de faire un historique du fonctionnement de la publication scientifique. On espère vous avoir donnez envie d’en savoir plus sur la production de connaissance. Rendez-vous courant le mois prochain pour découvrir le côté obscur de la force !
Quand on parle de sciences, on s’intéresse plus souvent aux résultats qu’à la façon dont on les a obtenus. Les outils qui font le lien entre les hypothèses de départ et la conclusion restent le plus souvent dans l’ombre. Et pourtant, sans ces outils, les modèles, la connaissance scientifique serait impossible à atteindre ! Alors qu’est-ce qu'un modèle scientifique ? Pourquoi est-ce qu’on a besoin des modèles en sciences, et en particulier en écologie ? Et est-ce que les modèles représentent la réalité ? C’est ce qu’on vous propose de découvrir dans cet article !
C’est difficile de donner une définition générale des modèles, car ils ont été construits dans différentes disciplines pour répondre à des problèmes particuliers [2, 7]. Dans tous les cas, les modèles sont toujours des outils, c’est-à-dire qu’ils servent à atteindre un but extérieur au modèle lui-même, pour obtenir une meilleure représentation du phénomène auquel on s’intéresse [5, 7].
Les modèles peuvent prendre des formes très variées et ont beaucoup d'utilités différentes. Pour avoir une meilleure idée de ce qu’est un modèle, voici trois exemples de modèles et de leurs applications.
Les organismes modèles sont des espèces dont le fonctionnement est bien connu par les biologistes, comme la souris ou la mouche du vinaigre. Ces espèces permettent de mieux comprendre le fonctionnement des organismes vivants. Par exemple, on peut tester l'efficacité d’un médicament sur des souris : comme cette espèce est assez proche de l’humain, les résultats donneront des indices sur ce à quoi on peut s’attendre pour l'humain.
Les objets abstraits sont des modèles qui permettent d’imaginer une représentation fictive d’un objet réel. Par exemple, le modèle de l’atome permet aux physiciens d’imaginer à quoi ressemble un atome, qu’on ne peut pas le voir directement. Il y a eu plusieurs modèles de l’atome dans l’histoire des sciences, parfois en concurrence. Par exemple, le modèle créé par Ernest Rutherford en 1911 imagine un atome composé d’un noyau autour duquel tournent des électrons [10]. Les modèles de l’atome permettent de mieux comprendre ce qu’est la matière, mais ont aussi des applications concrètes. Par exemple, une extension du modèle de l'atome de Rutherford permet de calculer la longueur d'onde d’un rayonnement émis par des atomes. Ce principe est utilisé par exemple pour concevoir des lasers.
Les modèles mathématiques sont des modèles abstraits qui s’écrivent en langage mathématique. Par exemple, le modèle linéaire permet de calculer la valeur d’une variable y en fonction d’une autre variable x : il s’écrit y = ax + b (où a et b ont des valeurs constantes). Les variables y et x peuvent représenter n’importe quelles grandeurs numériques, et le modèle linéaire a donc beaucoup d’applications. Par exemple, ce modèle est utilisé en mécanique pour calculer la déformation initiale d’un matériau en fonction de la force qu’on lui applique [9]. On l'utilise aussi pour étudier la façon dont la taille est corrélée entre des parents et leurs enfants [11], l’évolution de la température de l’atmosphère au cours des années (en complément d’autres techniques) [6]...
Enfin, les modèles sont utilisés dans différents domaines en sciences, mais ils font eux-mêmes l’objet de recherches. Il y a donc des scientifiques qui travaillent à perfectionner des modèles existants ou à en développer de nouveaux. Par exemple, l’intelligence artificielle est un domaine de recherche actif qui développe des modèles pour réaliser des tâches qui essaient d’imiter une intelligence humaine, telles que comprendre des instructions orales (Siri, Alexa, l’assistant Google...)
Dans la vie de tous les jours, on peut se fier à notre intuition ou à une connaissance partielle pour prendre des décisions. Par exemple, lorsque vous descendez les escaliers, vous ne vérifiez pas la hauteur de chaque marche : ça prendrait beaucoup trop de temps, et on se doute que l’architecte ne s’est pas amusé à faire des marches de hauteurs différentes [5] !
Mais en sciences, on ne peut pas se permettre de faire reposer notre analyse sur ce qui nous semble “évident” si on veut atteindre un niveau de connaissance fiable [5]. L’inconvénient, c’est que c’est beaucoup plus lent d’utiliser un raisonnement logique qu’un raisonnement intuitif [3]. Mais pour produire des résultats fiables, les sciences doivent utiliser cette démarche. Les modèles sont donc des outils pour remplacer notre raisonnement intuitif par un raisonnement contrôlé.
Chaque discipline scientifique a des types de modèles préférés, en raison des contraintes propres au domaine et de la culture de la discipline. Cet article va s’intéresser plus particulièrement au domaine dans lequel je réalise ma thèse : l’écologie, qui est l’étude des relations entre les espèces vivantes et avec leur environnement.
En écologie, on utilise beaucoup les modèles mathématiques [8], comme le modèle linéaire décrit plus haut. En effet, ce type de modèles semble adapté pour décrire un certain nombre de phénomènes en écologie [1]. Par exemple, on utilise des équations différentielles pour prédire la croissance des populations, des modèles statistiques pour connaître l’effectif des populations dans leur milieu naturel, des fonctions mathématiques pour prédire la répartition des espèces en fonction de leur environnement...
Bon à savoir : les modèles mathématiques sont très utilisées en écologie et dans certaines disciplines scientifiques (physique, économie, biologie). Mais les correspondance entre le langage dépouillé des mathématiques et la complexité de la réalité n'est pas une évidence. D'ailleurs les mathématiques ne sont pas utilisées aussi couramment dans d'autres domaines (histoire, littérature).
On va détailler un exemple pour avoir une idée de la logique utilisée pour modéliser des systèmes écologiques. Dans cet exemple, on va s’intéresser à la façon dont les zèbres choisissent leur habitat, c’est-à-dire les zones qu’ils préfèrent dans la savane.
On fait l’hypothèse que les zèbres préfèrent les zones proches des points d’eau. En effet, on a observé sur le terrain qu’ils s’éloignaient peu des points d’eau. De plus, on sait que la savane est un écosystème très rude, avec une saison sèche qui dure la moitié de l’année. Or, les zèbres ont besoin de boire régulièrement. On peut donc penser que l’eau sera une ressource très importante pour eux.
Pour tester cette hypothèse, on peut utiliser un modèle mathématique. Il faut donc choisir une fonction qui décrit la variation de probabilité de présence des zèbres avec la distance à l’eau (voir graphique ci-dessous). Pour choisir cette fonction, on peut s'inspirer de ce qu'on observe dans les données. Par exemple, la fréquence des zèbres en fonction de la distance à l'eau peut diminuer de façon constante, suivre un plateau puis chuter brusquement... Selon ce qui est observé, on utilisera des fonctions mathématiques différentes.
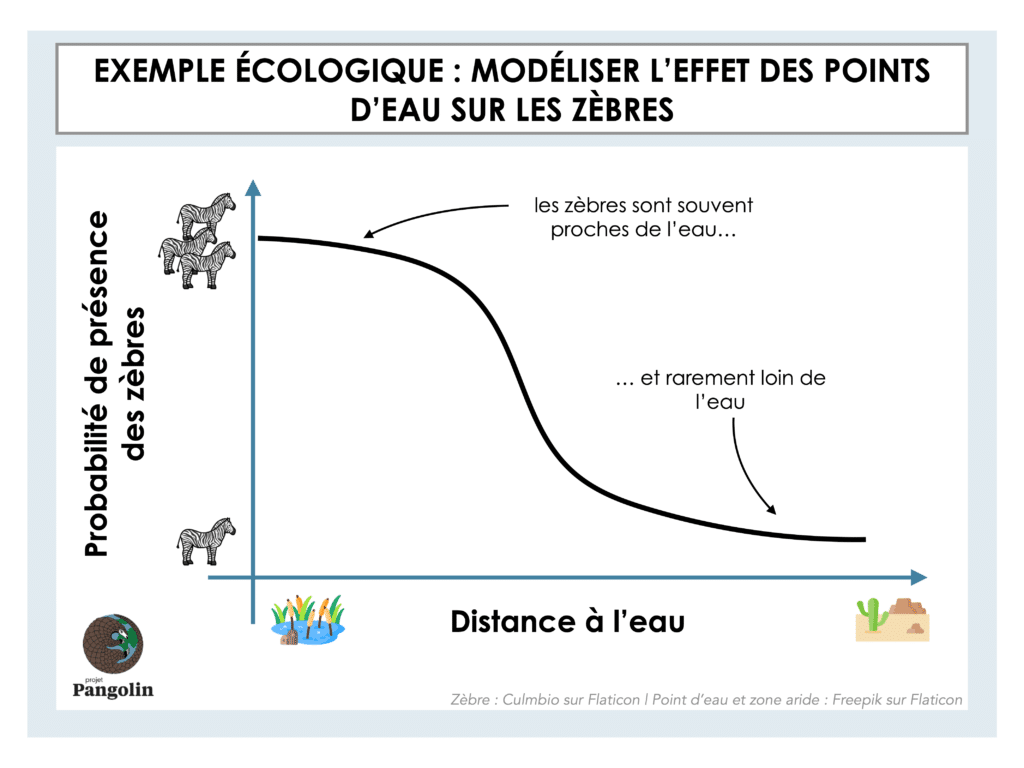
Maintenant qu’on a choisi une fonction pour modéliser notre hypothèse, on doit l’ajuster à notre problème. C’est-à-dire que si notre fonction mathématique s’écrit par exemple probabilité de présence du zèbre = a × exp(-b × distance à l’eau)), on doit déterminer les valeurs des paramètres a et b. L'une des façons de trouver ces paramètres est d'utiliser des programmes informatiques. Par exemple, si on se base sur des données de présence de zèbres à des endroits plus ou moins éloignés des points d’eau, ces programmes vont choisir les paramètres qui réduisent le plus possible l’écart entre la probabilité de présence des zèbres calculée avec le modèle et la fréquence des zèbres observée dans les données.
Pour savoir si le modèle qu’on a finalement choisi décrit bien la réalité, on compare ses prédictions aux données observées. À cette étape, on s’attend à ce que les données soient un peu éloignées des prédictions. En effet, certaines variables ne sont pas prises en compte dans le modèle (comme par exemple la présence des prédateurs). Or, ce qui nous intéresse, c’est de savoir si l’effet de la distance à l’eau est bien décrit : mais comment faire la différence entre un écart au modèle dû à une mauvaise description de l’effet de l’eau ou à d’autres facteurs ? C’est là que les statistiques entrent en jeu : elles permettent de prendre en compte l'écart entre le modèle et les données dû à d’autres facteurs que l'eau. On va donc comparer notre modèle aux données avec une certaine marge d’erreur (c’est le fameux intervalle de confiance statistique) pour prendre en compte ces facteurs non modélisés.
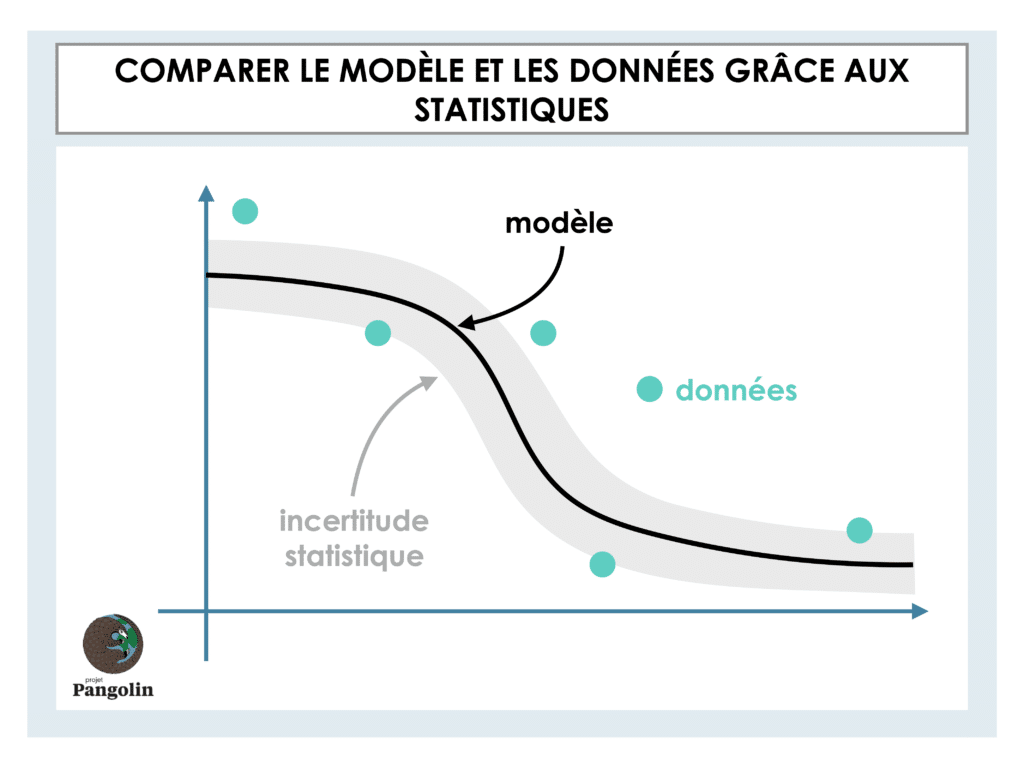
Enfin, malgré tous nos efforts pour construire un bon modèle, on peut parfois se rendre compte qu'il correspond assez mal aux données observées. Dans ce cas, on peut rajouter des variables pour expliquer la présence du zèbre, comme le type de végétation ou encore la présence de prédateurs. En théorie, on peut toujours rajouter autant de variables qu’on veut dans un modèle. Par contre, si on se sert de données réelles pour ajuster notre modèle (comme on l’a fait ici), il faut avoir suffisamment de données pour être sûrs que le modèle s’ajuste bien à la réalité... Et c’est une des limitations majeures en écologie. En effet, il est très coûteux de récolter beaucoup de données sur tout un ensemble de variables différentes.
Cet exemple permet d'entrevoir l'une des difficultés importantes pour étudier des systèmes écologiques : les espèces vivantes sont toutes prises dans un réseau de dépendance complexe. Par exemple, les zèbres dépendent des végétaux pour se nourrir, et les zèbres sont eux-mêmes mangés par les lions (voir l’article du Projet Pangolin sur la biodiversité). Pour bien comprendre les systèmes écologiques, il faudrait donc pouvoir étudier toutes ces relations : mais cela est très difficile, justement parce que tout est lié [5].
Cette complexité rend l’utilisation des statistiques indispensable. En effet, dès qu’on néglige une partie des facteurs, on va avoir des écarts du modèle par rapport à la réalité, et les statistiques sont nécessaires pour les prendre en compte.
Souvent, on se sert de données réelles pour construire un modèle, mais ce n’est pas pour ça que le modèle représente fidèlement la réalité [1]. En effet, les modèles expriment les hypothèses de la personne qui modélise sur le fonctionnement du monde. Cette personne s’intéresse uniquement à une partie d’un système : elle sélectionne donc les facteurs qui pourraient influencer cet aspect particulier du système.
Mais le choix de ces facteurs n'est pas facile. D’abord, il est pratiquement impossible de déterminer l’intégralité des facteurs qui influencent des phénomènes complexes (comme les systèmes écologiques). D'autre part, évaluer l’effet de certains facteurs dans la réalité peut s’avérer très difficile en pratique. Par exemple, pour le modèle de choix d’habitat du zèbre décrit précédemment, on s’intéresse à un écosystème très vaste. C'est donc difficile d’observer la répartition précise de tous les prédateurs, ou encore la végétation en tous points dans la savane... Même si le modèle essaie de décrire la réalité, il ne peut donc pas être considéré comme la réalité.
Une fois le modèle construit, il est donc crucial de le re-comparer à la réalité [5]. Pour des modèles mathématiques par exemple, on peut évaluer leur qualité en calculant la vraisemblance du modèle, c’est-à-dire une mesure de la probabilité d’obtenir les données observées avec un modèle. Plus le modèle donne des valeurs proches des données, plus il est vraisemblable. On peut aussi faire des prédictions grâce au modèle et les comparer ensuite à la réalité. Par exemple, si un modèle indique que les chauves-souris préfèrent survoler les haies pour se déplacer, on peut aller vérifier sur le terrain. Si le modèle est en accord avec la réalité, on peut avoir confiance dans ce modèle (sans oublier qu’il ne représente qu’une hypothèse sur la réalité).
Pour résumer, les modèles sont des outils qui permettent de décrire, comprendre ou prédire un phénomène. Même s’ils ne sont pas parfaits, les modèles sont néanmoins extrêmement utiles et importants en sciences.
En écologie, modéliser les écosystèmes permet de mieux les comprendre ou de mieux prédire leur évolution. Or, cela s’annonce primordial pour les années qui viennent, car les extinctions d’espèces et le changement climatique vont grandement modifier et mettre en danger le fonctionnement des écosystèmes. Pour les protéger, il faut pouvoir les comprendre et prévoir leur évolution, et les modèles sont l’un des outils indispensables pour y arriver.
Temps de travail cumulé : 33 heures
Autrice : Lisa Nicvert
[1] A. Franc, Mathématisation et modélisation, entre histoire et diversité. Editions Matériologiques, 2013, p. 974. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://hal.inrae.fr/hal-02806211
[2] R. Frigg et S. Hartmann, « Models in Science », in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2020., E. N. Zalta, Éd. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2020. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/models-science/
[3] Hygiène Mentale, Ep20 Les deux vitesses de la pensée, et le « Bullshitomètre », (23 octobre 2017). Consulté le : 23 mars 2022. [Vidéo en ligne]. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=eLLIm-GpJh4
[4] J. H. Lawton, « Are There General Laws in Ecology? », Oikos, vol. 84, no 2, p. 177‑192, 1999. https://doi.org/10.2307/3546712.
[5] J.-M. Legay, L’Expérience et le modèle. Paris: INRA, 1997. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : http://www.cairn.info/l-experience-et-le-modele--9782738007780-page-9.htm
[6] A. Muhlbauer, P. Spichtinger, et U. Lohmann, « Application and Comparison of Robust Linear Regression Methods for Trend Estimation », Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol. 48, no 9, p. 1961‑1970, sept. 2009. https://doi.org/10.1175/2009JAMC1851.1.
[7] F. Varenne, Modèles et simulations dans l’enquête scientifique : variétés traditionnelles et mutations contemporaines. Editions Matériologiques, 2013, p. 11. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03080674
[8] L. Viollat et N. Dubois, Quand mathématiques et écosystème se marient: L’ECOLOGIE, (6 avril 2022). Consulté le : 9 avril 2022. [Vidéo en ligne]. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=iayRpCYN7Yc
[9] « Loi de Hooke », Wikipédia. 4 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi_de_Hooke&oldid=191597667
[10] « Modèle atomique de Rutherford », Wikipédia. 20 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le_atomique_de_Rutherford&oldid=192067295
[11] « Héritabilité », Wikipédia. 26 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9ritabilit%C3%A9&oldid=192246474
Difficile aujourd’hui de prétendre que nos activités virtuelles soient sans conséquence sur l’environnement. Encore plus difficile de comprendre comment ces actions qui semblent « immatérielles » polluent. Ce sont ces deux raisons qui nous ont motivé à écrire cet article où nous vous proposons de décortiquer ensemble ce qu’est la pollution numérique.
Dans cet article vous trouverez :
L’empreinte carbone est définie comme la quantité de GES (Gaz à Effet de Serre) émise par les activités humaines. Elle est exprimée en équivalent carbone (ou “eqCO2”, “CO2e”, “CO2-eq”). Elle peut être estimée pour un individu, une entreprise, à l’échelle d’un pays ou pour un objet et sa valeur finale va dépendre de ce que l’on considère dans le calcul. Il est très compliqué de calculer une empreinte carbone car cela dépend de ce que l’on inclut dans ce calcul et c’est pourquoi les chiffres peuvent varier parfois dramatiquement selon la méthode de calcul employée [1]. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le calcul de l’empreinte carbone consultez notre article dédié.
Le terme fait écho à un autre, l’empreinte écologique (ou environnementale). Mais contrairement à l’empreinte carbone, celle-ci ne prend pas en compte que les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Elle considère l’impact environnemental sur un territoire (d’un hectare), c’est à dire à quelle vitesse nous consommons les ressources et produisons des déchets. En la comparant à la biocapacité, qui est la capacité à produire des ressources et se régénérer de ce même territoire, nous pouvons estimer la pression des activités humaines sur celui-ci. Lorsque l’empreinte écologique est supérieure à la biocapacité, le territoire a alors un déficit en biocapacité. Si c’est l’inverse, le territoire a une réserve de biocapacité.
Le Global Footprint Network est un institut de recherche qui calcule chaque année cette pression humaine sur l’environnement en hectare globaux (i.e. à l’échelle de la planète, note). Il faudrait actuellement 1,75 terres pour subvenir aux besoins de l’humanité. Cette mesure est ensuite souvent reprise et transformée en dette annuelle de la planète par de nombreuses ONG, c’est le fameux jour du dépassement.
La pollution numérique fait principalement référence à l’empreinte carbone générée par le secteur du numérique, cela va de la communication, l’information aux technologies. On peut distinguer le secteur du numérique en 3 grandes catégories : les réseaux de télécommunications, les data centers, les terminaux [4,5,6].
On peut compartimenter la pollution numérique en deux catégories : la production et l’utilisation. En effet, avant d’arriver dans nos mains nos objets connectés sont produits, ce qui génère des émissions de GES (entre 45% et 50% de la conso énergétique totale [7]). Ensuite nous les utilisons, et via nos habitudes numériques des GES sont émis (entre 50% et 55% de la conso totale [7]).
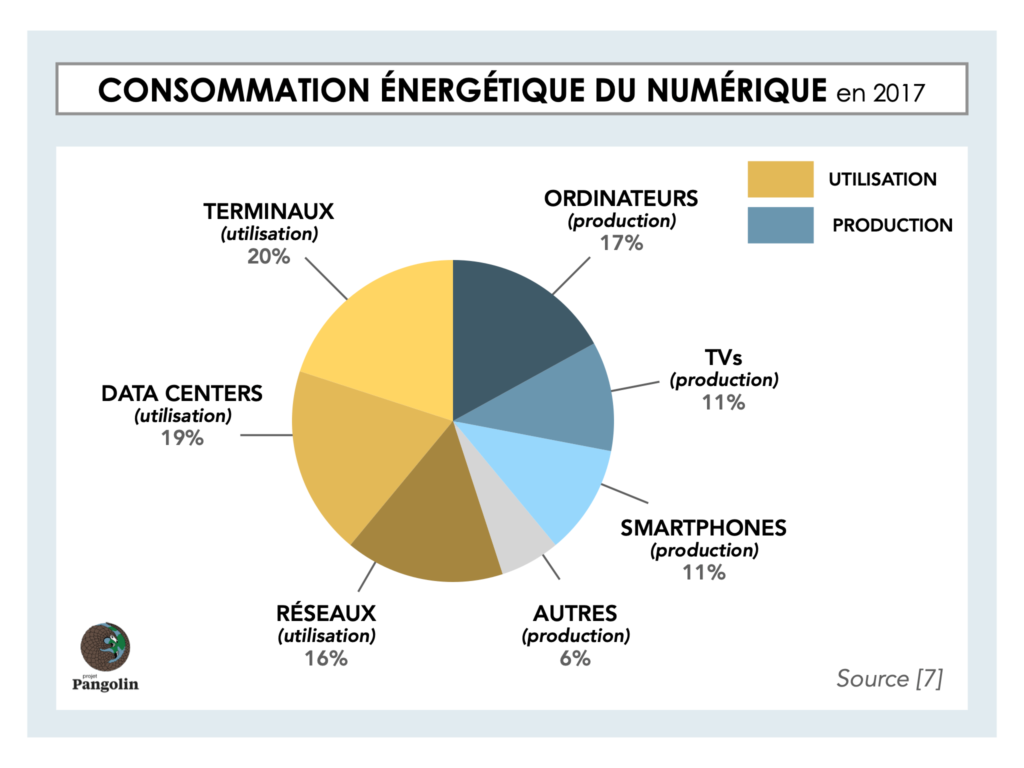
Si on reprend le cycle de vie d’un objet, on voit que dans le cas des objets connectés, la production nécessite l’extraction de minerais, l’acheminement de ces matières dans les usines de production puis le déplacement du produit fini pour qu’il soit vendu. Toutes ces étapes sont consommatrices d’énergies et provoquent des émissions de GES. Elles ont aussi des conséquences écologiques et sociales. En effet, l’extraction des minerais se fait dans des conditions terribles pour les écosystèmes présents autour et pour les humains qui effectuent ce travail [9].
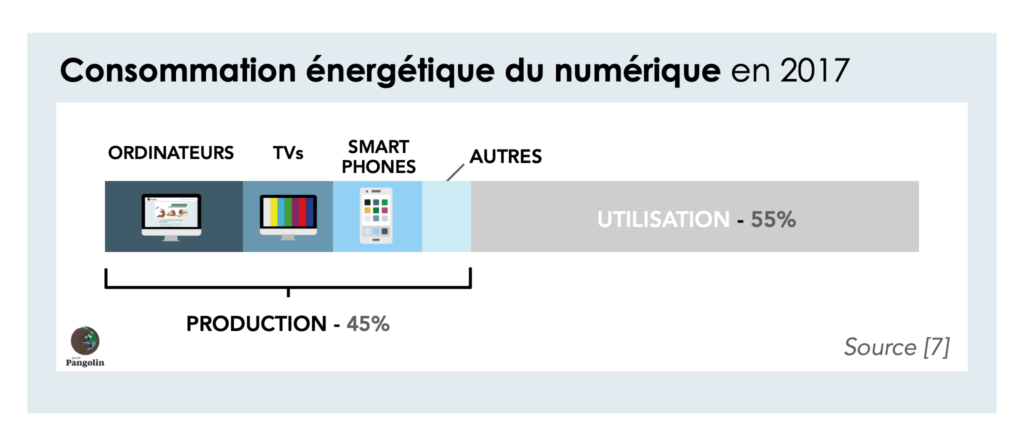
En tant que consommateur nous avons assez peu de pouvoir à ce niveau-là. Nous n’avons pas la capacité de changer les lignes de production. Nos seuls recours possibles sont de :
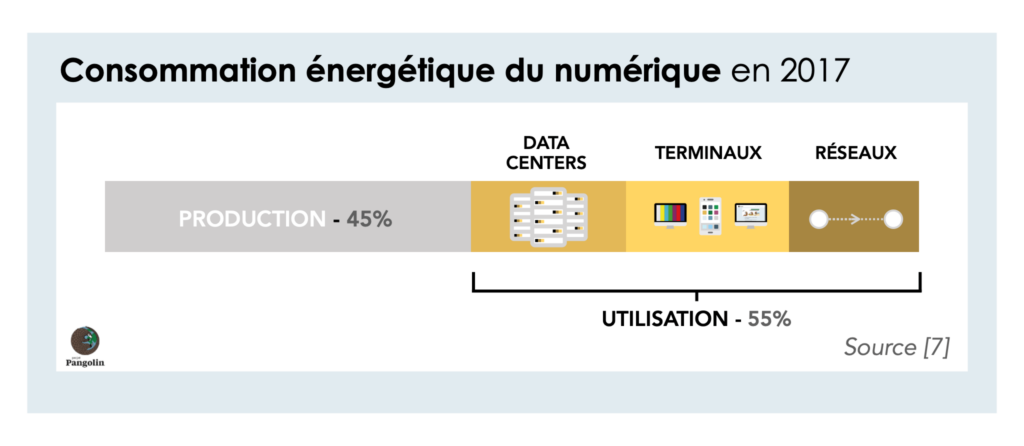
Contre intuitivement, nous ne sommes pas 100% maîtres de ‘nos’ pratiques digitales. En effet, notre utilisation des outils numériques dépend de :
Les data centers désignent les lieux physiques (bâtiments) dans lesquels sont regroupés des milliers de serveurs informatiques. Ces serveurs, ou hébergeurs, qui consistent en une série d’ordinateurs mis en réseau, servent au stockage et au traitement des données numériques.
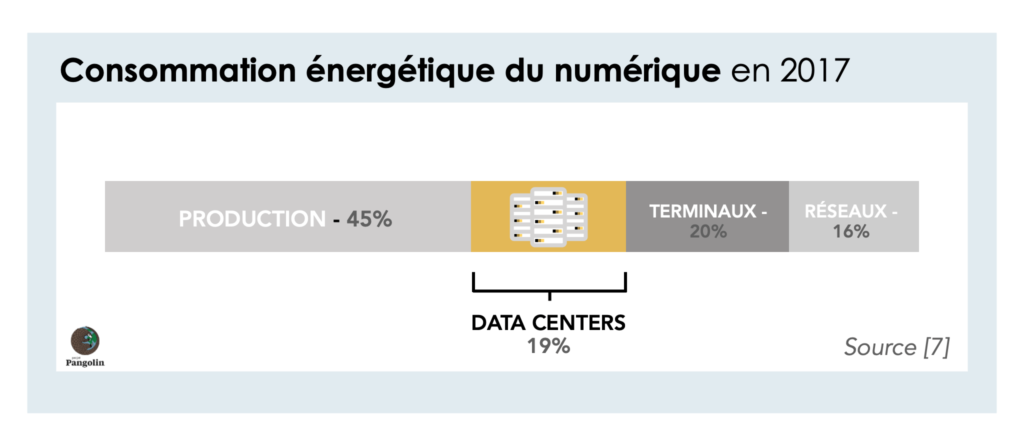
Envoi d’un message sur Whatsapp, réception d’un mail avec ou sans pièce jointe, photos postées sur Facebook/Instagram, utilisation d’un cloud pour stocker vos documents, consultation d’un site web … Toutes ces pratiques digitales quotidiennes reposent sur le stockage et le traitement de données numériques au sein des data centers.
Leur bon fonctionnement requiert une quantité considérable d’électricité : pour les alimenter mais aussi pour les refroidir. En 2015, les spécialistes du sujet prévoyaient une explosion du trafic internet (et par conséquent de la pollution numérique générée par les data center) [11,12] et sommaient de trouver des solutions pour réduire notre impact.
Spoiler alert : les humains ne sont pas arrivés à se calmer sur leur utilisation numérique mais les gros pollueurs que sont les data center ont fait d’énormes progrès. Des hypercentres regroupant de nombreux data center ont été créé, divisant par 10 les estimations de demandes en électricité horizon 2030 [13].
⚠️Attention : en aucun cas nous ne voudrions faire passer le message que l’on peut attendre une solution magico-technologique pour nous sortir de ce pétrin. Ces résultats démontrent simplement que la gestion des data center n’était pas optimisée. Les prédictions prévoient toujours une augmentation des GES avec les années, simplement elle sera probablement moins impressionnante [13].
Encore un exemple de pollution où nous n’avons aucun moyen d’action.
La réponse va vous déplaire… mais évidemment : OUI. Le streaming vidéo est un des facteurs de pollution numérique. Le rapport du Shift Project (2019) [7] est dédié à cette question (si vous avez envie de creuser un peu plus ce sujet).
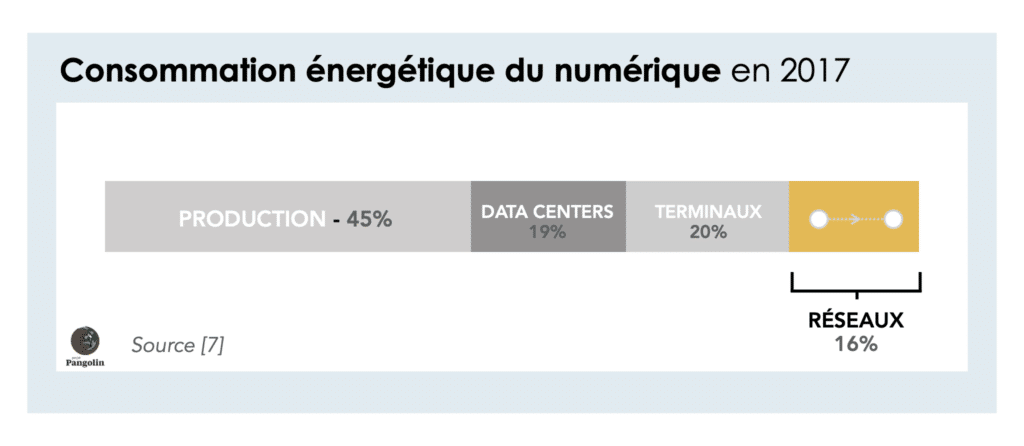
Le streaming vidéo s’inscrit dans la catégorie RÉSEAUX de nos utilisations numériques. Le graphe suivant présente la répartition des flux de données en ligne mondiale de 2018. Ce qu’on qualifie en général de vidéos en ligne correspond à 60% (les catégories en bleu) des flux de données globaux. La presse pointe souvent du doigt l’impact grandissant des plateformes de streaming telles que Netflix [14, 15, 16] mais nous avons été surprises de constater que l’addition de l’impact de la pornographie et des tubes (Youtube, Dailymotion) supplante l’impact des plateformes de vidéos à la demande.
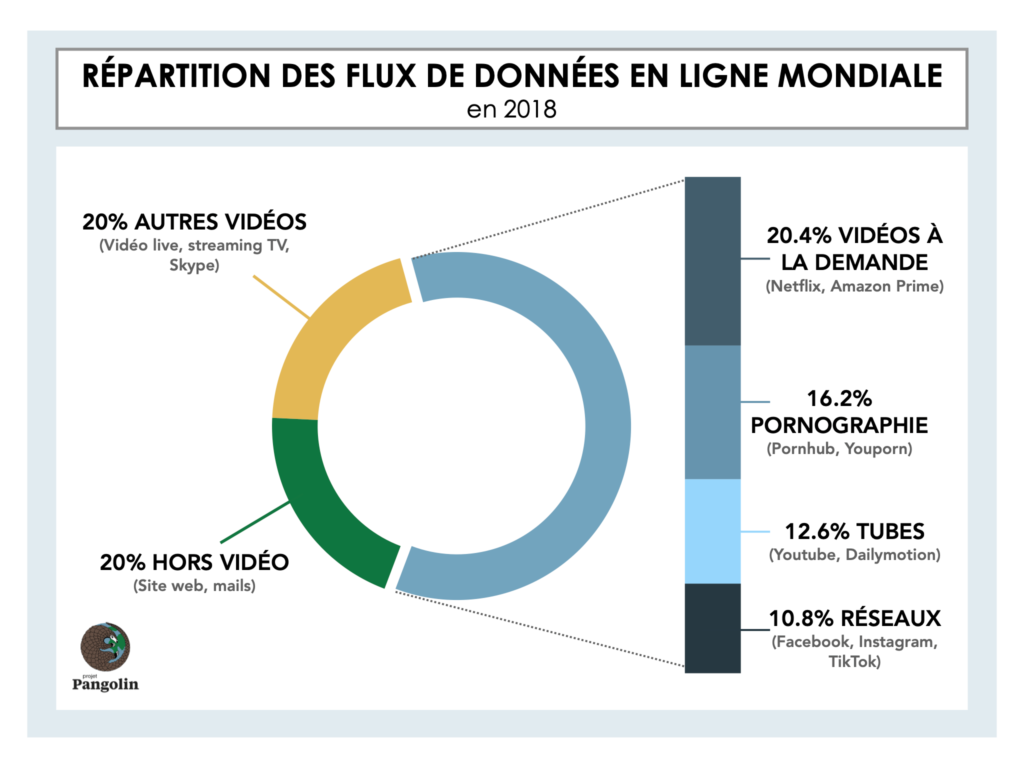
Avant l’avènement des plateformes de streaming, nos consommations d’audiovisuel se limitaient à la télévision et aux vidéo clubs. En 2014, des chercheurs américains ont voulu comparer les émissions de GES générées par le visionnage d’un même film en ligne ou avec location dans un vidéo club (production du DVD, trajet pour récupérer le DVD etc). Leur étude est très claire et démontre que le visionnage en ligne est moins émetteur de GES que la location de DVD TOUTES CHOSES ÉTANT ÉGALES PAR AILLEURS [17]. On souhaite insister très fort sur ces derniers mots car cette étude est souvent utilisée pour dire que «c’est pas si grave» de regarder des vidéos en ligne. Il serait envisageable de tenir ce genre de propos, si et seulement si, notre consommation d’audiovisuel n’avait pas considérablement augmenté depuis ces 10 dernières années [18].
Or l’accessibilité simplifiée à ces contenus ont bouleversé nos habitudes de consommation. Qui parmi nous peut affirmer qu’iel consomme autant de contenu audiovisuel maintenant qu’avant la popularisation de Netflix ? Personne.
Le constat est similaire pour les e-mails. Comme toute pratique digitale, les échanges de mails sont source de pollution numérique (cf graphe précédent catégorie HORS VIDÉO). D’après l’Ademe [9], l’empreinte carbone d’un mail moyen avec pièce jointe est estimé à 0,3g - 50g eqCO2. Est-ce pour ça que l’on continue à faire des réunions de 2h qui auraient pu être résumée par un e-mail ? … le débat est ouvert.
L’avènement du numérique est arrivé avec la promesse de connecter les gens entre eux, de communiquer plus rapidement qu’importe où ils se trouvent. Depuis une trentaine d’années le secteur des ICT connait une croissance importante [19]. Tout le monde (ou presque) possède au moins un terminal que ce soit un téléphone, un ordinateur ou bien une télévision par exemple. Entre 2015 et 2016, la bande passante liée à l’utilisation d’internet dans le monde a augmenté de 32% et si on s’attarde sur le continent africain elle a augmenté de 72%. Et cela n’est pas près de s’arrêter.
Seulement avec cette croissance du secteur, s’accompagne d’une augmentation de la consommation d’énergie. Certains modèles montrent que dans les pays de l’OCDE, une augmentation de 1% d’utilisateurs internet s’accompagne une augmentation de la consommation d’électricité de 0,108% [20]. En 2018 dans le monde, la demande globale en électricité est d’environ 20000 TWh (terawatt heure) on estime qu’elle aura doublé d’ici à 2030 [12], la part des ICT dans cette demande est évaluée à 51% [11]. Cette part tombe à 14% si l’on prend en compte les progrès en efficacité énergétique, notamment pour les data centers [21].
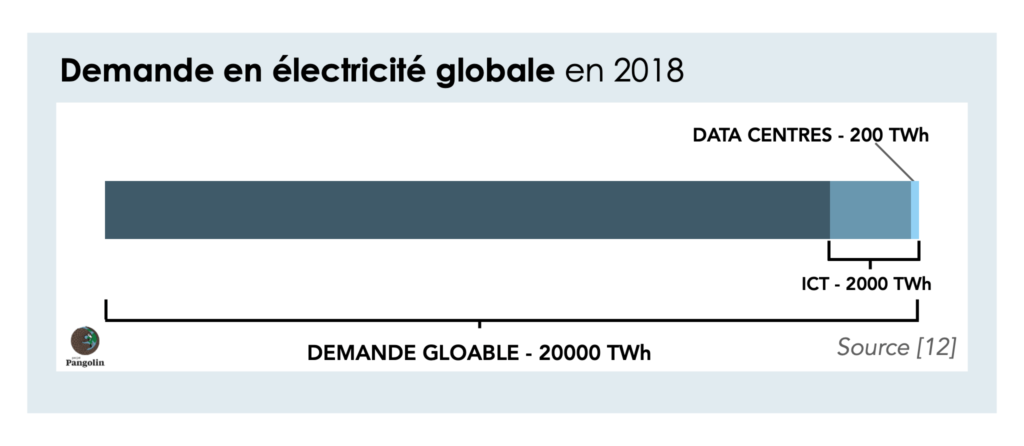
De nombreuses recherches sont faites dans le domaine des ICT pour améliorer leur efficacité en matière de consommation d’énergie. C'est le cas notamment pour les datas centers qui sont responsables d’environ 19% de la consommation énergétique totale des ICT. Des prévisions de la demande en électricité prévoient une augmentation de la part des data centers qui pourrait passer à plus d’un tiers de la demande énergétique totale d’ici 2030 [12]. Ils sont donc une composante à ne pas négliger en terme d’amélioration de la consommation d’énergie.
La majorité de ces data centers fonctionnent en réseaux en étant dispatchés à pleins d’endroits différents, on parle de fonctionnement en “cloud”. De nombreux efforts sont mis en place pour l’optimisation des algorithmes qui permettent aux data centers de fonctionner en cloud. Des algorithmes plus rapides permettent de consommer moins d’électricité [22]. Depuis quelques années, une autre solution a vu le jour, c’est celle des hypercentres. Rassembler des data centers au même endroit a permis de réduire leur consommation en énergie [12].
La digitalisation via l’application des ICT permet de faire des économies d’énergies dans d’autres domaines. Dans les chaines de production on identifie 5 façons d’économiser de l’énergie grâce à la digitalisation : (i) la simulation de procédés de production, (ii) le design intelligent et les opérations de biens et services, (iii) la distribution intelligente et la logistique, (iv) le service client et enfin (v) l’organisation du travail [23].
D’autres études ont évalué le taux d’émissions carbone évitées grâce à la communication mobile, cela correspond à 30% dans le milieu du travail et de la santé, 30% dans les transports, 3% dans l’agriculture ou encore 11% dans la production industrielle [24].Est-ce que ces économies d’énergies faites grâces aux ICT se traduisent par une diminution de la consommation d’énergie ? Pas toujours...
Une meilleure efficacité de la production entraine une réduction des coûts de production ce qui entraine donc une diminution du coût du produit ce qui induit alors une augmentation de la demande donc une augmentation de la production et donc augmentation de la consommation d’énergie [25]. C’est ce qu’on appelle l’effet rebond. Par exemple un effet rebond de 10% indique que les 10% d’énergies économisées grâce au progrès sont compensés par l’augmentation de la consommation de ce bien [26].
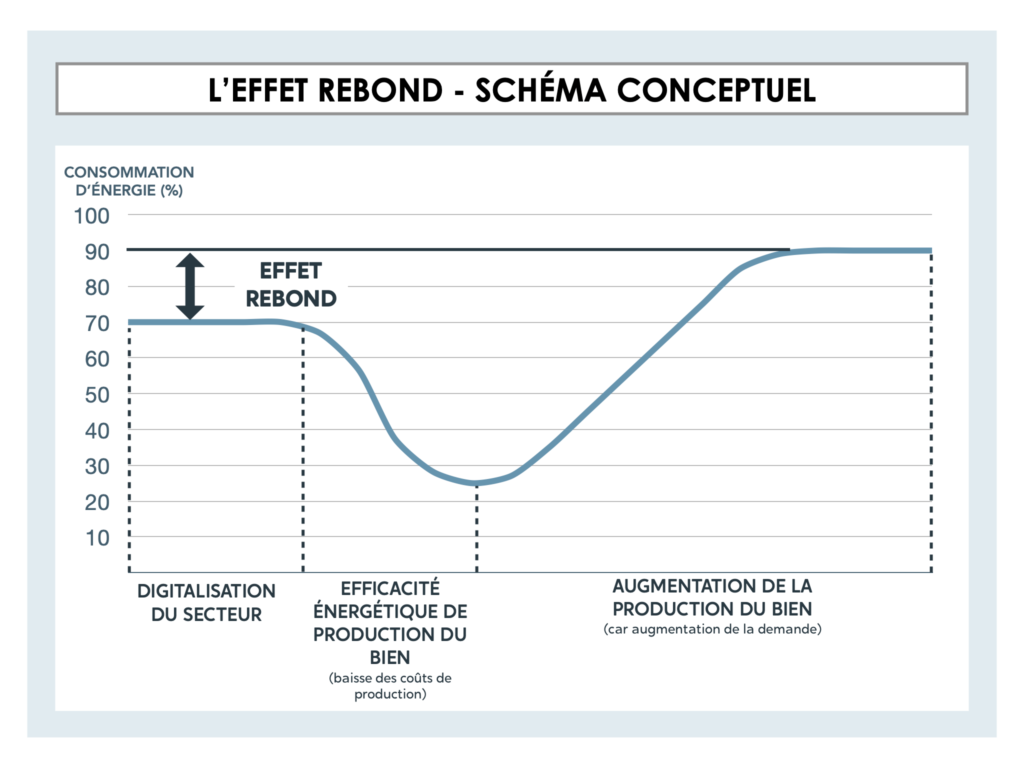
Cet effet rebond touche aussi bien les secteurs rendus efficace énergétiquement par la digitalisation que les ICT eux-mêmes (augmentation de la consommation de datas, arrivée de la 5G par exemple). Une étude a évalué l’effet rebond dans les ICT, et il est énorme, quasi 100% dans chaque catégorie [27]. L’étude s’est attardée à faire des scénarii à partir de données récoltées en 2011 : dans le scénario où les ICT deviennent plus accessibles en terme de prix, l’effet rebond en terme d’énergie utilisée et d’empreinte carbone est supérieur à 100% (141% et 153%). Le seul scénario qui permet de drastiquement réduire les effets rebond est celui où il y a une diminution de la consommation d’électricité (réduction de 10%) et une augmentation du prix des ICT, l’empreinte carbone tombe à 5% et l’énergie totale utilisée à 6%.
Ce que l’étude montre c’est qu’il existe des solutions pour diminuer cet effet rebond mais que celui-ci n’est jamais à 0 : il est toujours présent... donc la sobriété est le maître mot.
On ne le répètera jamais assez mais on ne peut pas espérer atteindre la sobriété (ici numérique mais en général énergétique) sans une action conjointe au niveau individuel et collectif.
On vous dresse ici une liste non exhaustive de petites habitudes qu’il est possible de modifier dans son quotidien :
Comme rappelé par le rapport du Shift Project [7] : « Ni l’auto régulation des plateformes de diffusion ni le volontarisme des usagers ne peut suffire ».
En effet, demander gentiment aux entreprises, dont le business dépend uniquement du numérique (Meta, YouTube, Netflix, Google etc), de trouver des solutions n’est pas raisonnable. Le conflit d’intérêt est bien trop important. De manière similaire, nous l’avons vu tout au long de l’article, les individus ont un pouvoir d’action extrêmement restreint. Le poids du changement doit être partagé.
Une collaboration entre les politiques, les régulateurs, les entreprises et les consommateurs est plus que nécessaire.
Lors de la rédaction de cet article nous nous sommes confrontées à quelques difficultés, notamment celle de trouver une définition claire du terme pollution numérique. C’est un mot parapluie dont on peut trouver autant de définition que d’articles sur le sujet, surtout lorsqu’on lit des articles de presse mainstream, des blogs ou des publications sur les réseaux sociaux. Nous avons vérifié les sources que nous avons utilisé et avons privilégié la littérature scientifique.
De plus, il est utile de garder en tête que tous les chiffres avancés ici sont issus d'articles scientifiques et que ce sont des estimations associées à des méthodes de calculs spécifiques, ces chiffres peuvent varier et il n’est pas impossible de trouver d’autres chiffres venant de sources différentes. Cela étant dit, ça ne dénature pas le message de cet article, il faut simplement garder en tête les ordres de grandeurs plutôt que les chiffres exacts pour saisir les enjeux liés à la pollution numérique.
[1]. Gombiner J. (2011) Carbon Footprinting the Internet.
[4] Belkhir L, Elmeligi A. (2018). Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations. J Clean Prod
[5] Aiouch Y, Chanoine A, Corbet L, Drapeau P, Ollion L, Vigneron V. Évaluation de l’impact Environnemental et Social Du Numérique En France et Analyse Prospective, État Des Lieux et Pistes d’actions. 2022.
[6] Freitag C, et al., (2021). The real climate and transformative impact of ICT:A critique of estimates, trends, and regulations. Patterns.
[7] Rapport The Shift Project 2019, Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne
[9] ADEME – Avis technique : Terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie, Octobre 2020
[11] Andrae A, Edler T. (2015). On Global Electricity Usage of Communication Technology: Trends to 2030. Challenges.
[12] Jones N. (2018). How to stop data centres from gobbling up the world’s electricity. Nature.
[13] Xu, M., & Buyya, R. (2020). Managing renewable energy and carbon footprint in multi-cloud computing environments. Journal of Parallel and Distributed Computing
[17] Shehabi, A., et al., (2014). The energy and greenhouse-gas implications of internet video streaming in the United States. Environmental Research Letters
[18] Marks, L. U. (2020). Let's Deal with the Carbon Footprint of Streaming Media. Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism
[19] Lange S, Pohl J, Santarius T (2020) Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand? Ecol Econ.
[20] Salahuddin M, Alam K. (2015). Information and Communication Technology, electricity consumption and economic growthin OECD countries: A panel data analysis. Int J Electr Power Energy Syst.
[21] Andrae ASG. (2019). Projecting the chiaroscuro of the electricity use of communication and computing from 2018 to 2030. (Preprint).
[22] Khosravi A, Garg SK, Buyya R. (2013). Energy and carbon-efficient placement of virtuals machines distributed cloud data centers. In European Conference on Parallel processing
[23] Berkhout F, Hertin J. Impacts of Information and Communication Technologies on Environmental Sustainability: Speculationsand Evidence. Brighton; 2001.
[24] Williams L, et al., (2022). The energy use implications of 5G: Reviewing whole network operational energy, embodied energy, and indirect effects. Renew Sustain Energy Rev.
[25] Plepys A. (2022). The grey side of ICT. Environ Impact Assess Rev.
[26] Berkhout PHG, et al., (2000). Energy Policy 2000-Defining the rebound effect. Energy Policy.
[27] Joyce PJ, et al., (2019). A multi-impact analysis of changing ICT consumption patterns for Sweden and the EU: Indirect rebound effects and evidence of decoupling. J Clean Prod.
C’est bientôt la rentrée, mais on a encore la tête en vacances. Pour prolonger l’été tout en progressant dans notre démarche écologique, nous vous proposons un article pour apprendre à voyager autrement.
Au sommaire de cet article :
PETIT DISCLAIMER : Attention, nous tenons à avertir nos lecteurices, cet article n’est pas une apologie de l’écotourisme. Il propose un point de vue moins idyllique de la question et propose de vous armer afin de reconnaître les situations de greenwashing qui y sont souvent associés.
Avant de plonger dans les méandres de l’écotourisme, nous nous devons de déconstruire notre vision du voyage. Depuis plusieurs décennies, nous baignons dans une culture de l’image où le voyage tient une place toute particulière. Il est synonyme d’aventure, de liberté, de jeunesse éternelle … de bonheur en quelque sorte. Dans ce conte de fées, l’objectif est d’enchainer sans fin, les paysages à couper le souffle, au rythme effréné des vols longs courriers avec pour seul compagnon notre grande insouciance. Dans nos imaginaires collectifs, ces couchers de soleil sur fond de Petit Biscuit (par pitié arrêtez ça), s’offrant aux plus téméraires ayant dénichés LA crique sauvage, sont sans conséquences, et quelque part nous les avons bien mérités.
Or, TOUT LE MONDE aujourd’hui est conscient que ce mode de voyage est loin d’être écologiquement responsable. Tout comme pour le reste de nos habitudes issues d’un niveau de confort inégalé, nous allons devoir les modifier. Et ça s’annonce dur. En effet, cela revient à renoncer à découvrir des paysages et des cultures incroyables. Au-delà d’une habitude, ce sont des rêves dont il faut se défaire ainsi qu’une vision globale du futur que l’on avait fantasmé. Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous devons remettre au placard toutes nos envies d’ailleurs, bien au contraire.
Dans cet article nous allons voir que l’important est de changer notre point de vue sur notre conception du tourisme. Cela commence en acceptant de ralentir et de payer les acteurs locaux au prix juste. Ces futurs périples probablement plus lents, auront sans doute une autre saveur, un brin plus aventurier !
L’écotourisme (aussi appelé tourisme vert, ou encore tourisme d’aventure) est une forme de tourisme focalisée sur la découverte de la nature locale et se voulant plus respectueux de l’environnement et de ses habitants. Ce concept a émergé il y a une trentaine d’année avec de grandes ambitions et s’est construit en opposition au tourisme de masse. L’objectif initial était triple : éveiller une conscience écologique chez les touristes, préserver les environnements naturels et rémunérer correctement les populations locales.
Pour caricaturer : au lieu de s’entasser par paquet de 600 européens dans un Club Med à Punta Cana où l’on aurait siroté des piña colada à volonté dans une piscine à 28 degrés, l’écotourisme nous propose un charmant séjour dans un petit écolodge (maximum 8 guests) au Costa Rica avec visite d’un parc national et promesse de croiser de la faune sauvage.
Je ne vous apprends rien, les immenses resorts vendant des formules all-inclusive + aquagym le samedi matin ont des effets dévastateurs sur l’environnement. On le sait, le tourisme de masse est une calamité pour la biodiversité [13], une arnaque pour les populations locales [14] et une catastrophe pour les émissions de gaz à effets de serre (GES) qu’il génère [15, 16].
Là où cela se complexifie c’est que la 2ème proposition de séjour est loin d’être parfaitement respectueuse de l’environnement. En effet, l’utilisation du terme écotourisme a légèrement évolué depuis sa définition initiale. Il ne garantit pas du tout le respect des 3 principes précédemment cités.
Tout d’abord, l’écotourisme proposait une refonte du concept en promettant de voyager mieux sans intégrer l’idée qu’il faudrait aussi voyager moins. Ainsi, au lieu de superposer nos 600 européens dans un immeuble à x étages en bord de mer tropicale, il allait falloir les étaler dans x petites structures dont la surface totale prendrait tout autant de place (voire plus). Il faudrait toujours les transporter par avion et les nourrir. Bilan de la révolution touristique : pas de diminution d’émissions de GES, toujours besoin d’autant de ressources alimentaires, toujours autant de déjections produites et à traiter et une augmentation de l’occupation des sols. L’unique point positif potentiel étant que l’on n’aurait pas trop dégradé visuellement le littoral avec une immense construction.
Au-delà de l’aspect « protection de l’environnement », on peut aussi s’interroger sur l’univers promis à travers la vente de voyage d’aventure. On y retrouve tout un champ lexical s’inspirant largement de l’idée d’être le « premier » à explorer un lieu vierge de toute présence humaine (comprendre “humain blanc”) et qui semble être synonyme de dépassement de soi. C’est assez troublant de se rendre compte que le vocabulaire marketing utilisé dans ce contexte, vient s’appuyer sur des réflexes postcoloniaux qu’il serait grand temps d’enterrer définitivement (ou de questionner, à minima) [6].
Bon, maintenant que l’ambiance est bien plombée, qu’est-ce qu’on fait ? On a vu qu’il était important de remettre en question toutes les facettes qui composent notre vision actuelle du tourisme. C’est ce que propose le slow voyage. En considérant le temps comme la première ressource limitante qui vient nous contraindre dans nos choix de voyage et en choisissant de s’en absoudre, il devient possible de continuer d’explorer le globe sans abîmer sa biodiversité [c’est évidemment en faisant l’hypothèse que l’argent n’est pas la première ressource limitante, ce qui est discutable, je vous l’accorde]. Dans la suite de cet article, je vous propose de décrypter ce qui pollue le plus dans un voyage classique et de chercher des solutions slow voyage pour y remédier.
Dans cet article nous allons nous intéresser uniquement aux émissions de GES qui constituent une mesure facilement comparable en termes d’impact global. Néanmoins, gardons en tête que nos actions ont aussi des conséquences sur la biodiversité et les populations humaines locales. L’impact sur la vie qui nous entoure est plus difficilement quantifiable mais reste un paramètre essentiel (on vous en parlait ici).
En se concentrant sur les GES, on distingue 3 postes de dépenses énergétiques majeurs lors d’un voyage : le transport, l’hébergement et l’alimentation.
Peu importe le mode de transport pour lequel vous opterez (sauf si vous vous propulsez à la force de vos mollets, en marchant ou à vélo), le déplacement sera émetteur de GES et donc polluant. L’objectif central est donc de MINIMISER votre impact environnemental, et non pas de l’annuler comme le prétendent tout un tas d’organisme (on vous en parle dans l’article sur l’empreinte carbone et sur le greenwashing).
Si on reste en France (hors outre-mer et corse) le train l’emporte systématiquement sur l’avion en termes d’émission carbone ([3], [4]). Cela est principalement dû au fait que le mix électrique* français provient à 72% du nucléaire et 12% de l’hydraulique (2 modes d’énergie bas carbone) [5]. Donc pas de débat, si on reste en France hexagonale: le train sera toujours plus intéressant que l’avion et la voiture. Il a le mauvais gout d’être souvent plus cher et plus long mais c’est un moindre mal puisqu’il nous permet de continuer à pouvoir voyager sans émettre trop de GES.
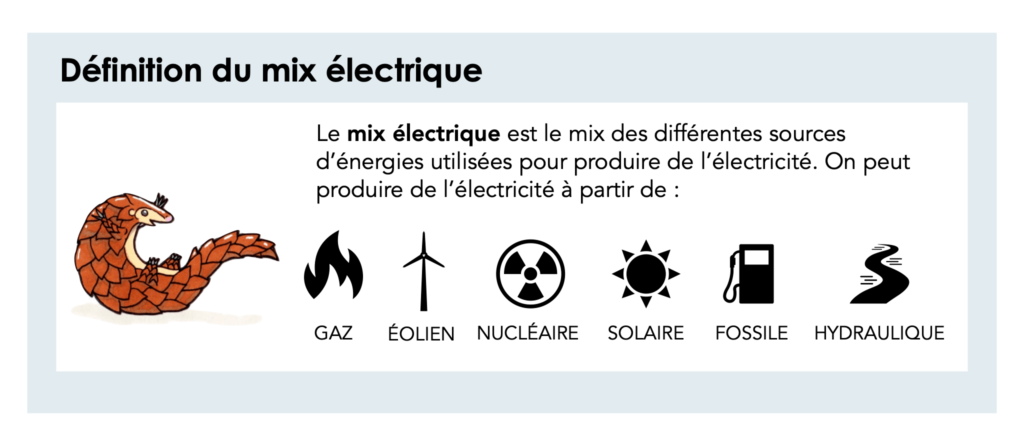
En revanche, ça se complique lorsque l’on franchit nos frontières. Comme on vous le répète trop souvent, il n’y a pas une solution unique et simple qui s’appliquerait internationalement. On vous conseille donc de vous lancer dans des recherches minutieuses concernant les pays que vous souhaitez visiter afin de prendre les meilleures décisions.
On vous glisse ici une liste (non exhaustive) de pays européens où l’on est sûrs que le train est plus écoresponsable que l’avion (ne nous remerciez pas) : Suède, Finlande, Norvège, Suisse, Slovénie, Slovaquie, Lettonie, Autriche [8].
Dans la majorité des cas l’avion semble pire que tout autre moyen de transport. Il est donc préférable de l’éviter au maximum. Mais dans quelle mesure le train est-il vraiment gagnant sur la voiture par exemple ? Doit-on dire adieu aux road trips ?
Pour simplifier, ce qu’on peut se dire c’est que les moyens de transports collectifs terrestres sont toujours une meilleure solution aux déplacements solo. On émettra moins de GES en voyageant en bus ou en train que dans sa voiture (même si on est 4). Il vaudrait donc mieux oublier les road-trips en van…
Bon à savoir : Estimer les émissions de CO2 pour chaque moyen de transport n'est pas une mince affaire. Chaque estimation proposée au lecteur est issue d'une ribambelle d'hypothèses et si on en fait tous les mêmes, on ne retombe pas sur les mêmes chiffres.
Après avoir exploré les options possibles dans les airs et sur la terre, on va s’intéresser aux transports maritimes. Difficile de trouver des chiffres sourcés mais d’après nos petits calculs, il semblerait que les trajets réalisés en ferry ou en paquebot soient pires encore que l’avion. On vous décrit en détails comment nous obtenons notre estimation en fin d’article.
Sur différents sites on retrouve ce même ordre de grandeur (que nous ne sommes pas arrivés à vérifier mais qui tombe dans la fourchette de notre estimation) : 267gr eq CO2/km/passager pour les ferries contre 209 gr eq CO2/km/passager pour un vol long-courrier [9,10]. Les croisières sur paquebots et autres traversées en ferry sont donc très polluantes. De plus, il n’y a pas que le CO2 qui pose problème ici puisque le carburant utilisé rejette de grandes quantités de particules fines.
Un nouveau mode de transport maritime est devenu en vogue ces dernières années : les voyages en cargo. Sur ce sujet, les avis divergent. Certains estiment que c’est un transport zéro émission puisque ces porte-containers feront le trajet avec ou sans vous [9]. D’autres, au contraire, pensent qu’il faut effectuer les mêmes types de calculs que pour les autres déplacements. On vous laisse vous faire votre avis sur la question, n’hésitez pas à lire des sources qui sont en désaccord pour affiner votre point de vue.
Ce paragraphe ne va pas ravir les fainéants mais un moyen sûr pour ne pas émettre de GES lors de nos déplacements c’est en utilisant nos jambes. Il est alors possible d’imaginer un itinéraire comprenant des portions uniquement tractées par nos foulées ou nos coups de pédales. De nombreux aventuriers ont déjà expérimenté et raconté leurs périples en France (ici par exemple) et à l’étranger (ici ou ici). Le site un-monde-a-velo.com présente divers témoignages de cyclotouristes ayant sué à travers l’Europe, si vous cherchez de l’inspiration.
Une option pour les moins sportifs (mais ayant le pied marin), c’est le voilier ! Retrouvez un dossier très complet à ce sujet sur le site tourdumondiste.com. On retrouve aussi de nombreuses comparaisons d’émissions de GES pour une traversée de l’Atlantique s’inspirant du voyage réalisé par Greta Thundberg pour assister au sommet sur le climat de l’ONU en 2019 [7].
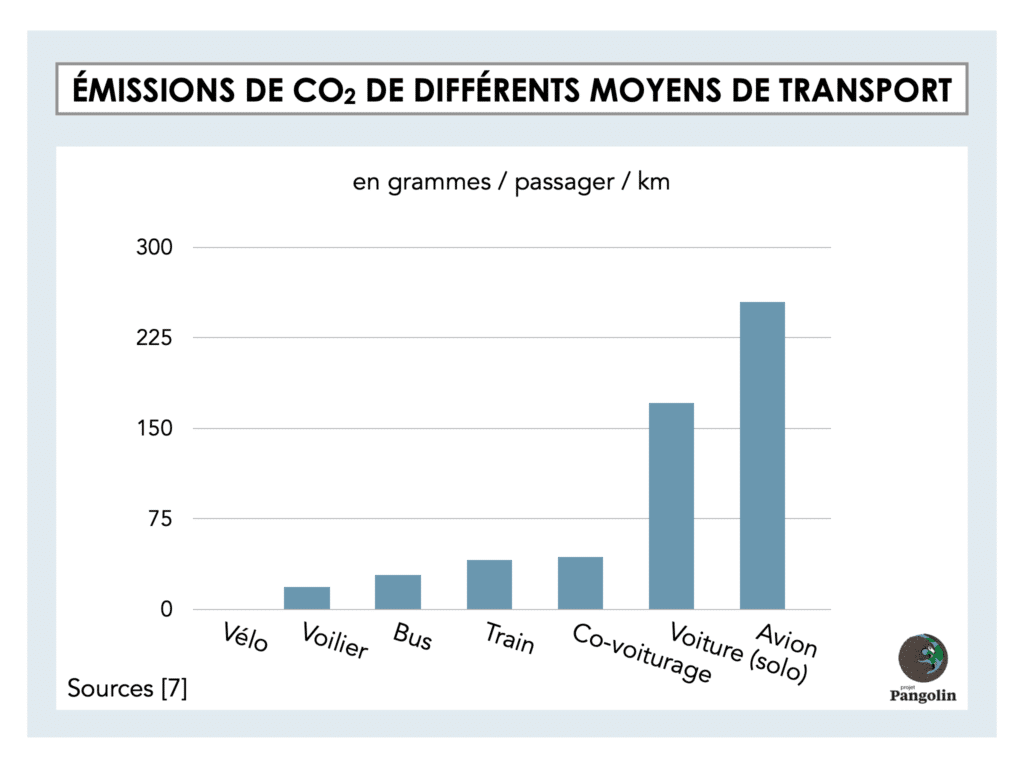
Globalement toutes les options de déplacements non motorisés (mobilité douce) sont à envisager : trek, vélo, roller, canoë-kayak, voilier, cheval, roulotte, randonnée avec ânes/mules etc.
Une fois la question du transport réglée, on peut se concentrer sur l’hébergement. C’est une étape à ne pas négliger. En effet, il existe de grandes différences entre les différents établissements où vous pouvez passer une nuit, notamment en termes de traitement de eaux, d’occupation des sols, de gestion des déchets, etc.
Il est difficile de vérifier les dires des établissements hôteliers en raison du conflit d’intérêt évident qu’ont ces derniers à nous communiquer des chiffres fiables. On peut alors se référer à différents labels tels que l’Ecolabel Européen ou le Green Globe. Retrouvez un guide détaillé de l’ADEME concernant ces labels internationaux et européens [12].
Il est possible de se diriger vers des lieux de vie qui offriront aussi une rencontre avec des locaux en dormant chez l’habitant (et en le rémunérant correctement svp). N’hésitez pas à consulter ces réseaux d’hospitalité pour trouver votre bonheur.
Cela paraît être la solution la plus propre. Si, et seulement si, on est capable de laisser l’endroit où l’on a dormi, vierge de toutes traces de notre nuit. Donc on pense à ramasser tous nos déchets derrière nous (et même ceux des autres si on en aperçoit). En ce qui concerne les déchets que l’on considère biodégradable (comme des épluchures de légumes) on les ramène aussi avec nous, surtout s’ils ne poussent pas naturellement sur le site que vous visitez (en effet, il y a un risque que l’espèce s’implante et devienne invasive). On choisit des produits de douche et de vaisselle biodégradables et respectueux de l’environnement et on ne gaspille pas l’eau !
Il ne faut pas oublier, non plus, que notre simple présence représente un dérangement pour la faune et la flore locale. Cela peut être tentant d’installer son campement à distance des espaces dédiés (l’enfer, c’est les autres…) mais il faut considérer que cela représentera un dérangement imprévu. L’avantage de rester dans des zones avec d’autres humains c’est que celles-ci sont connues de la faune qui les utilise à leur avantage (soit en les évitant soit en y allant pour se protéger d’autres espèces).
Dernier point et non des moindres : MANGER. Ce poste de dépense énergétique est aussi à considérer avec soin.
Vous êtes venus en voyage pour vous ouvrir l’esprit et cela passe par la découverte de nouvelles saveurs. Rien de tel que de visiter des établissements typiques, proposant des plats conçus à partir de produits locaux. On vous le répète ici (et ici aussi), mais si vous souhaitez limiter votre empreinte carbone il faut à tout prix réduire sa consommation de viande (même en vacances). Optez donc pour des plats végétariens !
On pensera aussi à se renseigner sur les « règles » liées aux pourboires relatifs au pays que l’on parcourt. Elles peuvent grandement changer d’un pays à un autre et vous vous devez d’être respectueux des acteurs locaux. Dans certains pays, les serveurs et autres employés de restauration sont rémunérés essentiellement grâce aux pourboires !
Si vous avez la possibilité de faire vos propres repas, on vous conseille de faire vos courses sur les étals des marchés locaux. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux produits, de vivre une expérience au sein de la culture locale mais aussi de choisir des légumes produits localement et de saison. On le sait, limiter le transport de ce qu’on consomme permet de réduire l’empreinte carbone de notre assiette.
Au cours de mes recherches sur ce sujet je suis souvent tombée sur des articles provenant directement d’agences de voyages ou de sites qui regroupent des agences de voyages. Pour vous faire une petite métaphore c’est un peu comme les études sur le réchauffement climatique commanditées par Total, autrement dit : très, très biaisé.
Aujourd’hui c’est terriblement tendance d’être écolo, et donc c’est très rentable de prétendre l’être. En jouant sur la corde sensible des consommateurs, il est assez facile de les convaincre de passer à la caisse en leur faisant croire que c’est pour le bien des [insérer n’importe quelle espèce protégée] sans pour autant agir concrètement pour leur protection.
On se doute bien que les conflits d’intérêts sont importants dans ces entreprises. Entre vous vendre effectivement un séjour écoresponsable qui pollue peu, qui a demandé beaucoup de travail de calcul pour estimer son impact environnemental (et qui a de fortes chances de paraître moins sexy) ou ajouter seulement les quelques mots clés à la mode qui déculpabilisent les voyageurs et les voyagistes, le choix est malheureusement vite fait.
Encore une fois, c’est à la charge du consommateur de s’informer et d’apporter un regard critique sur les offres qui lui sont proposées. On aimerait que ce soit différent, mais c’est comme ça. Il est donc important de vérifier si les voyages écologiques présentés le sont véritablement.
Malheureusement on ne connaît pas de moteur de recherche que vous permettrait de faire aisément le tri. On vous propose donc une petite liste de trucs à vérifier :
Si on vous vend un voyage comme étant éco-responsable et que ne vous donne aucun moyen de le vérifier par vous-même, c’est qu’il y a anguille sous roche. 🚨 Attention, certains apposent des petits logos verts rappelant la nature pour vous faire croire qu’un label a vérifié tout ça. Certains sont vrais et d’autres inventés de toutes pièces. Ils ne seront suffisants que si l’entreprise vous communique sa méthode d’estimation d’impact clairement (en ligne ou par mail).
S’ils communiquent explicitement sur le côté écologique des voyages vendus il y a fort à parier qu’ils sont « engagés » à l’échelle de leur entreprise. Le problème ici c’est que les bons comme les mauvais élèves ont tout intérêt à communiquer là-dessus. À vous de décrypter les engagements qui semblent pertinents de ceux qui sont à côté de la plaque. (par exemple, lisez notre article sur le greenwashing pour aiguiser vos talents de détecteur de gros mensonges).
Si on vous propose des destinations vouées à disparaître (en Antarctique ou ailleurs), FUYEZ. L’argument principal étant que ces endroits n’existeront bientôt plus, n’est pas une raison pour participer à l’extinction précipités de ces derniers. On vous conseille ces deux articles à ce sujet (ici et là).
Éviter les influenceurs qui enchainent les destinations à 100 à l’heure. Optez pour des humains qui voyagent à une allure raisonnée. Vous trouverez pléthores de blog et autres témoignages qui seront bien plus informatifs que des sites de voyages. Il y a des gens qui se lancent dans ce genre d’aventures folles : comme un tour du monde sans avion par exemple (voir le blog et les vidéos de Iznowgood).
Il sera nécessaire de préparer le voyage bien en amont. Adopter une démarche slow voyage n’est pas de tout repos et demande énormément d’anticipation pour ne pas céder à la facilité lorsque vous serez sur place. Au-delà de votre itinéraire, il vous faudra un petit peu de matériel de base pour subvenir à vos besoins essentiels sans venir entacher votre initiative. Voici une liste non exhaustive de choses élémentaires qu’il vous faudrait avoir dans vos valises : gourdes, couverts réutilisables, sacs en tissus … plus d’infos ici.
Particulièrement dans les parcs nationaux, respectez les tracés de circuit, marchez là où les autres ont déjà marché. Les pas des randonneurs ont un impact néfaste sur la flore locale étant trop fréquemment piétinées par des flopées de visiteurs.
Toujours dans l’optique de passer inaperçus et de ne pas impacter l’environnement que l’on visite, on respecte la faune sauvage en l’observant de loin et le plus discrètement possible. De plus, on ne repart avec rien de prélevé sur place. C’est tentant mais on évite à tout prix.
Lorsque vous partez en exploration ou visite de lieux ou de paysages, anticipez la gestion de vos déchets. Vous venez avec de la nourriture emballée, vous rentrez avec vos emballages pour les jeter dans des poubelles adéquates. Le vent, les oiseaux et autres animaux fouillent les poubelles ce qui provoque l’envol des déchets. On emmène donc toujours un sac poubelle avec nous pour éviter de se retrouver embêté. On peut pousser la démarche plus loin, notamment en bivouac et ramenant le papier hygiénique utilisé.
On a tendance à l’oublier mais le bruit est une forme de pollution. Donc on s’astreint à être le plus discret possible, acoustiquement aussi. Ce qui permettra par la même occasion de respecter les autres visiteurs qui sont entrain de suivre un itinéraire semblable au votre mais aussi de respecter les animaux qui vous entourent. La pollution acoustique génère du stress chez de nombreuses espèces et nous ne sommes pas là pour les perturber (sauf dans les cas où il est recommandé d’être bruyant. Par exemple dans certains parcs où vous pourriez vous retrouvez nez à nez avec de grands prédateurs).
Vous êtes venus jusqu’ici pour découvrir une culture et cela passe par la nourriture. En plus de rencontrer de nouveaux plats méconnus et d’éveiller vos papilles, il y a de fortes chances pour que les ingrédients qui constituent ce repas traditionnel soient produits localement et donc avec un impact réduit sur l’environnement. Si vous avez la possibilité de cuisiner vous-même, aller vous approvisionner sur les marchés locaux, en plus d’une immersion totale vous ramènerez dans votre cuisine des produits de la région.
Faites travailler des guides locaux et profitez-en pour en apprendre plus sur l’histoire, la géologie, la biologie des lieux que vous traversez. Choisissez des établissements (hébergements, restaurations, locations de véhicules, excursions, etc) tenus par des habitants de la région que vous visitez, c’est important de rémunérer ces personnes et non des expatriés venus profiter d’un business.
C’est LA ressource limitante et il faut accepter que tout soit plus long et moins immédiat mais c’est ce qui fait la beauté de ce chemin.
Ne divulguez pas les coordonnées d’où vous ne pourrez pas vous empêcher de prendre des photos sublimes et de les poster sur les réseaux. Une initiative sur les réseaux sociaux a émergé, consistant à ne pas localiser les photos que vous postez mais de remplacer la localisation par « I protect Nature ». Ceci préservera l’intégrité du site en évitant d’augmenter sa fréquentation.
Si jamais vous avez la chance de croiser un individu appartement à une espèce menacée, il est recommandé de ne pas poster de photos DU TOUT. Même en désactivant la localisation de vos appareils (qui peuvent être extraites de vos photos pour retrouver l’animal), le décor entourant l’individu peut servir d’indication à des braconniers.
Il y aura des imprévus que vous aurez (quelque part) envisagé et certains qui seront des totales surprises. C’est ce qui fait le sel de ce genre d’aventure. Dans ces situations il faut savoir relativiser et se dire que ça ne remet pas en question l’intégralité de notre démarche. Il y aura aussi probablement des bonnes surprises qui viendront faciliter vos déplacements et peut-être compenser les bêtises que vous n’aviez pas vu venir.
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour envisager d’une nouvelle manière vos prochaines vacances !
[1] Définition Le Robert
[2] Wikipédia – ecotourisme
[3] https://bonpote.com/le-match-co2-train-vs-avion/
[4] https://bonpote.com/train-vs-avion-match-retour/
[5] https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/mix-energetique-de-la-france
[6] Boukhris, L., & Peyvel, E. (2019). Le tourisme à l’épreuve des paradigmes post et décoloniaux. Via. Tourism Review, (16).
[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/Électricité_en_Europe
[9] https://www.tourdumondiste.com/limiter-son-empreinte-ecologique-en-voyage
[10] https://www.greenly.earth/blog/empreinte-carbone-comparatif-transports
[11] GLEC – The global method for calculation and reporting of logistics emissions – Février 2020
[12] https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux#labelsrow-3
[13] Kuvan, Y. (2010). Mass tourism development and deforestation in Turkey. Anatolia, 21(1), 155-168.
[14] Chong, K. L. (2020). The side effects of mass tourism: the voices of Bali islanders. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(2), 157-169.
[15] Terrenoire, E., Hauglustaine, D. A., Gasser, T., & Penanhoat, O. (2019). The contribution of carbon dioxide emissions from the aviation sector to future climate change. Environmental research letters, 14(8), 084019.
[16] Cavallaro, F., Galati, O. I., & Nocera, S. (2017). Policy strategies for the mitigation of GHG emissions caused by the mass-tourism mobility in coastal areas. Transportation Research Procedia, 27, 317-324.
Toutes les sources sur ce sujet pointent vers un rapport (en anglais) [11]. Lorsqu’on consulte ce document on trouve la figure 17 qui présente des estimations d’émissions de GES pour les transports maritimes. Les ferrys servant à transporter des personnes sont de type Ro-Ro et émettent entre {20 ; 120} g CO2 e/tkm. Cette unité est décrite plus haut (dans le document [11]) et donne la quantité de CO2 émise lors du transport d’une tonne de cargo (ou ferry ou paquebot) sur 1 km. Si on prend un ferry de Corsica ferries qui pèse 3 500 tonnes et peut transporter 1756 passagers (d’après wikipedia), qui en moyenne voyage avec un taux de remplissage de 40% (Base carbone de l’ADEME), on tombe sur une fourchette de [99 ; 598] g CO2/km/passager.
Nous continuons notre exploration de la biodiversité ordinaire en allant à la rencontre du végétal et plus précisément des arbres. L’objectif de ce troisième guide naturaliste est de vous familiariser avec cette partie des organismes vivants. On l’oublie trop souvent mais le végétal est bel et bien vivant ! Il ne fait pas uniquement partie du décor !
Vous retrouverez tout d’abord des informations générales sur la biologie des arbres. En effet, ils sont loin de fonctionner comme nous et quelques présentations sont de rigueur.
Ensuite vous découvrirez la présentation de 12 espèces d’arbres fréquemment rencontrées en France afin d’apprécier encore plus vos prochaines balades en forêt. Comme toujours, vous pourrez télécharger les fiches d’identités correspondantes pour vous aider à reconnaître ces espèces sur le terrain.
Puis, nous vous dévoilerons comment une haie dans votre jardin peut représenter un atout pour la biodiversité. Enfin, nous changerons votre vision sur le bois mort. À la fin de cet article vous ne le considérerez plus comme un déchet mais comme une ressource !
Bonne lecture !
Comme tous les organismes, les arbres ont un cycle de vie complexe et pour l’accomplir, l’évolution les a dotés de mécanismes incroyables ! Voyons-en quelques-uns ensemble.
D’abord, les arbres boivent et mangent. Leur nutrition se fait de plusieurs manières : via les racines bien sûr, dont l’allongement et la ramification permettent à l’arbre de prospecter le sol pour en tirer le maximum de ressource. Ainsi, ils sont en capacité d’absorber l’eau et les élément minéraux contenus dans le sol. Ils utilisent aussi leurs feuilles pour se nourrir. Non, ils ne mangent pas de l’air. Mais ils « mangent » du soleil ! Ils utilisent en effet la photosynthèse pour produire des glucides.
Pour réaliser la photosynthèse, il faut de l’énergie solaire, du CO2 et de l’eau. Les arbres synthétisent alors des glucides qu’ils consomment et de l’oxygène qu’ils relâchent dans l’air. C’est pour cela que les arbres et forêts sont des puits de carbone ! Et sont essentiels à la régulation du climat.
La photosynthèse se fait au sein des chloroplastes, des petites entités héritées des cyanobactéries présentes dans les cellules des arbres et qui contiennent de la chlorophylle (un pigment vert, qui rend donc les feuilles vertes). C’est la chlorophylle qui absorbe l’énergie lumineuse et permet la photosynthèse.
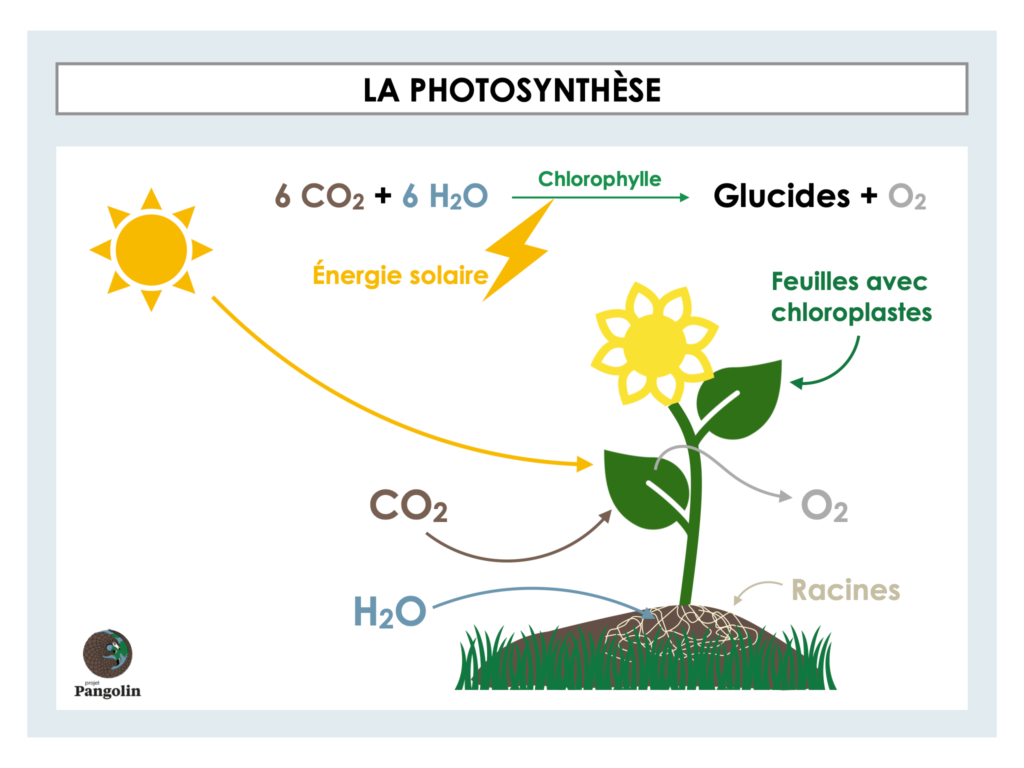
L’eau est absorbée au niveau des racines. L’absorption d’eau et des minéraux compose ce que l’on appelle la sève brute. Cette dernière circule, à la manière du sang chez nous, dans des vaisseaux (le xylème) et irrigue tout l’arbre, depuis les racines jusqu’aux feuilles, en passant par le tronc. Chez nous, c’est le cœur qui sert de pompe et qui fait circuler le sang. Chez les arbres, la sève brute monte des racines aux feuilles grâce à plusieurs mécanismes :
Le CO2 est quant à lui absorbé au niveau des feuilles. En effet, les échanges gazeux chez les arbres (qui n’ont pas de poumons) s'effectuent en grande partie au niveau de ce que l’on appelle les stomates : des pores présents sur les feuilles. Une fois dans la plante, les gaz circulent par diffusion au travers des tissus grâce à des différences de pression. C’est comme ça que le CO2 nécessaire à la photosynthèse arrive jusqu’aux chloroplastes !
Via ces stomates, l’arbre absorbe également du dioxygène (O2) : il respire, comme tous les végétaux. Il consomme alors de l’O2 et rejette du CO2, comme nous. Cette respiration permet à l’arbre d’assurer la création de nouveaux tissus, grandir, se réparer... vivre.
Arrivé à un certain âge, l’arbre va également être en mesure de se reproduire. Pour cela, il va fleurir : les fleurs contiennent les organes reproducteurs. Les pistils sont les organes femelles, ils contiennent les ovules. Les étamines sont les organes mâles et produisent le pollen. Selon les espèces, un même arbre va porter des fleurs mâles et femelles (espèces monoïques, comme le sapin) ou bien les fleurs mâles et femelles seront sur deux individus différents (espèces dioïques, par exemple le ginkgo). Les fleurs peuvent également être hermaphrodites : une seule fleur porte les organes mâles et femelles comme c’est le cas chez le merisier.
Une fois les fleurs sorties, la fécondation peut avoir lieu. Pour cela, le pollen va devoir rencontrer les ovules. Certaines espèces sont autofécondes : le pollen et les ovules d’un même individu se rencontrent. Chez d’autres espèces, le pollen d’un autre arbre vient féconder les ovules d’un autre arbre. Pour faire voyager ce pollen, il y a plusieurs options : le vent (on parle d'anémogamie), les animaux (on parle de zoogamie) ou encore l’eau (hydrogamie).
Les ovules fécondés vont ensuite produire des graines. Selon les espèces, ces graines vont être comprises au sein de fruits, ou non.
Chez les végétaux, la dispersion et les flux de gènes sont assurés à la fois par les mouvements du pollen et des graines. Nous avons vu le cas d'une pollinisation par le vent, les insectes ou l'eau. Il existe des équivalents pour la dispersion des graines : on parle d'anémochorie, zoophobie, ou encore hydrochloride.. Certains arbres peuvent ainsi pitre politisés par les insectes et voir leurs graines dispersées par le vente : ils sont zoogames et anémocores !
Maintenant que l’on sait tout ça, apprenons-en plus sur les espèces que l’on peut observer en France !
Le chêne pédonculé ou Quercus robur L., 1753 (ici, “L., 1753” signifie que cette espèce a été décrite pour la première fois par Carl von Linné en 1753) est un arbre à feuillage caduc (il perd ses feuilles à l’automne) de la famille des Fagacées.
Les chênes sont des arbres très communs en France et en Europe et parmi les différentes espèces, le chêne pédonculé est le plus commun.
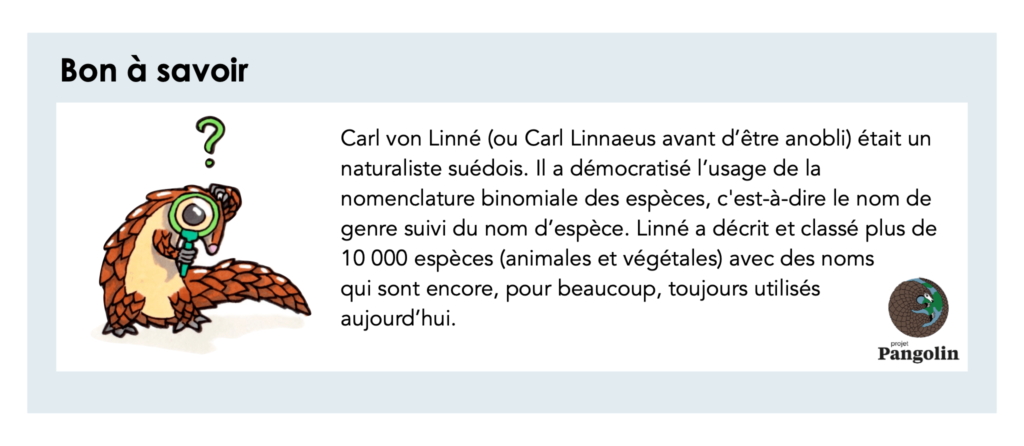
Il est présent globalement partout en France et en Europe mais, sensible aux sécheresses, on ne le retrouve pas sur le pourtour Méditerranéen (Sud de la France et de l’Italie, grande majorité de l’Espagne et du Portugal). À l’Est, sa distribution va jusqu’à la Russie même si elle devient moins homogène dès lors que l’on arrive vers l’Ukraine et la Biélorussie. Il est également représenté uniquement au Sud des pays scandinaves.
Le chêne pédonculé est gourmand en eau, il se plaît donc dans les endroits humides. Cela fait de lui un arbre particulièrement menacé par le réchauffement climatique. Il s'accommode d’une large variété de sols et peut se trouver aussi bien en forêts qu’en prairies. On ne le retrouvera par contre pas en montagne, sa répartition n’allant pas plus haut que 1300 m d’altitude.
C’est un arbre imposant, à l’âge adulte il peut faire jusqu’à 35 m de haut et 25 m de large. Sa silhouette générale présente un houppier (les branches au sommet du tronc) irrégulier et une cime en dôme. Il est facilement reconnaissable avec ses feuilles d’un vert foncé et lobées.
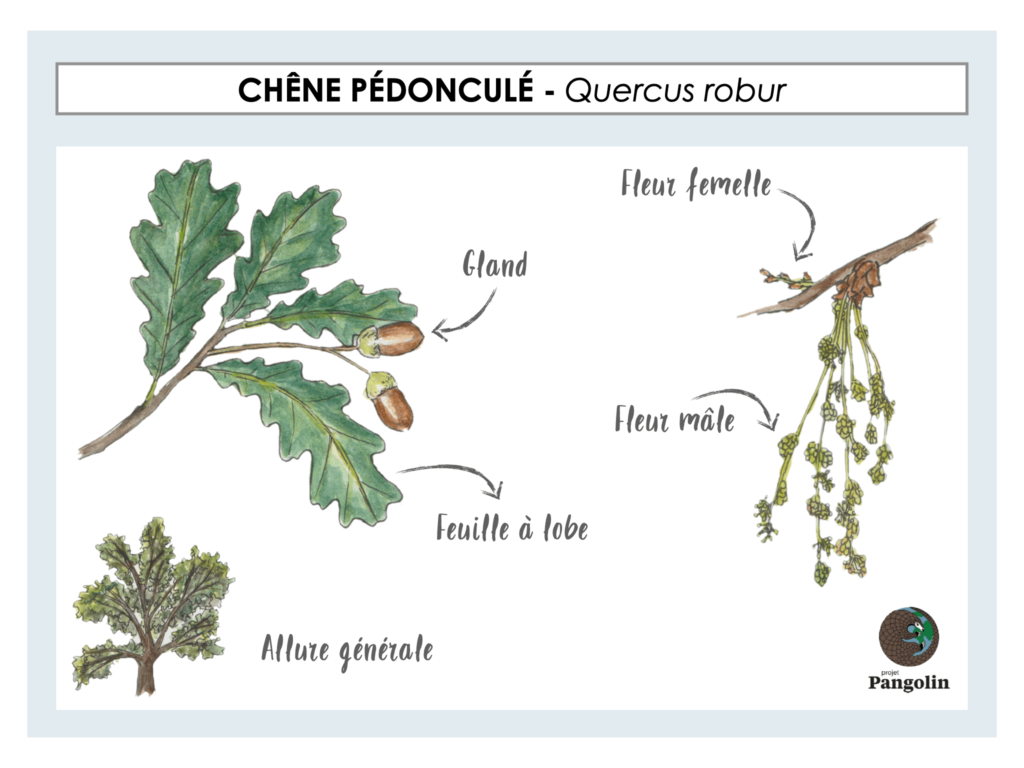
On le distingue du chêne sessile (qui lui ressemble beaucoup et avec lequel il cohabite régulièrement) grâce à plusieurs petites choses. Les lobes des feuilles de chêne pédonculé sont moins réguliers que ceux du chêne sessile, donnant à la feuille un aspect plus “cartoon”. Les feuilles du chêne pédonculé ont aussi des “oreillettes” (des tous petits lobes) à leurs bases, alors que les feuilles du chêne sessile n’en ont pas. Enfin, le pétiole (la tige qui porte la feuille) est long chez le chêne sessile mais très court chez le chêne pédonculé.
La floraison se fait autour d’avril-mai, avant la feuillaison (c’est-à-dire que l’arbre n’a pas encore retrouvé les feuilles perdues à l’automne), et chaque arbre porte à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles (on parle d’espèce monoïque). Les jeunes chênes ne fleurissent pas, il faut attendre que l’arbre ait 50-60 ans pour l’observer en fleur.
Les chênes ne fructifient pas tous les ans, plutôt tous les deux ou trois ans. Les fruits, que sont les glands, arrivent à maturité autour de septembre-octobre. Ils sont ovoïdes et portés par un long pédoncule (d’où le nom de “chêne pédonculé”). Une cupule hémisphérique (ce qui ressemble à un petit chapeau) recouvre le quart supérieur du gland. Le mode de dispersion de ces graines est en partie assuré par les animaux qui s’en nourrissent et déplacent ainsi les glands (geai des chênes, dont on vous parlait ici, mais aussi micromammifères comme les mulots [1], ou encore le sanglier). On parle de dispersion “zoochore”.
La plasticité écologique du chêne pédonculé (c’est-à-dire le fait qu’il s’accommode d’une grande variété d’habitats), particulièrement forte dans ses premières années de vie, en fait une espèce pionnière : c’est l’une des premières espèces d’arbre à s’implanter dans un écosystème “nouveau” (c’est à dire se restaurant après une perturbation ou changeant de caractéristiques, comme une prairie entretenue qui devient finalement abandonnée).
Le chêne joue également un rôle écologique important puisque, qu’il soit vivant ou mort, il sert d’abri et de nourriture à de nombreuses espèces d’insectes (en effet, rappelez-vous dans le guide naturaliste sur les insectes, nous avons évoqué l’importance du bois mort !), d’oiseaux, de mammifères, mais aussi aux lichens, aux champignons et à d’autres végétaux.
Comme les autres espèces de chêne, le chêne pédonculé peut vivre très longtemps, de 600 à 1000 ans.
L'un des plus vieux chênes pédonculés connus en Europe se trouve en Allemagne. On estime qu'il a entre 600 et 1500 ans et il est prénommé Femeiche.
C’est l’une des espèces de chênes que l’on utilise beaucoup pour son bois, qui sert pour tout un tas de choses, comme la construction (charpentes, parquets, ébénisterie, escaliers...), la tonnellerie (tonneaux de vin et de cognac notamment), le chauffage ou encore la fabrication de papier.
Le charme, ou Carpinus betulus, est également l’un des arbres les plus communs en France. Il appartient à la famille des Bétulacées (comme les bouleaux ou encore les noisetiers).
C’est un arbre que l’on retrouve dans toute l’Eurasie, jusqu’à la Russie à l’Est, dans les pays scandinaves au Nord et l’Iran au Sud.
Le charme est souvent retrouvé en forêts avec d’autres essences comme le chêne (chênaie-charmaie) ou dans des forêts mixtes (c'est-à-dire, mélangeant des feuillus et des résineux). Il vit surtout en plaine. Il affectionne les zones de mi-ombre et les climats plutôt frais, c’est pourquoi il n’est pas ou peu présent dans le pourtour Méditerranéen. On ne le trouve pas non plus en montagne car sa distribution ne va pas au-delà de 1100 m d’altitude.
Le charme a un feuillage caduc même si ses feuilles sont marcescentes (c’est à dire qu’une partie d’entre elles restent, sèches, sur l’arbre tout l’hiver). Ces feuilles mortes tombent juste avant l’apparition des nouvelles feuilles.
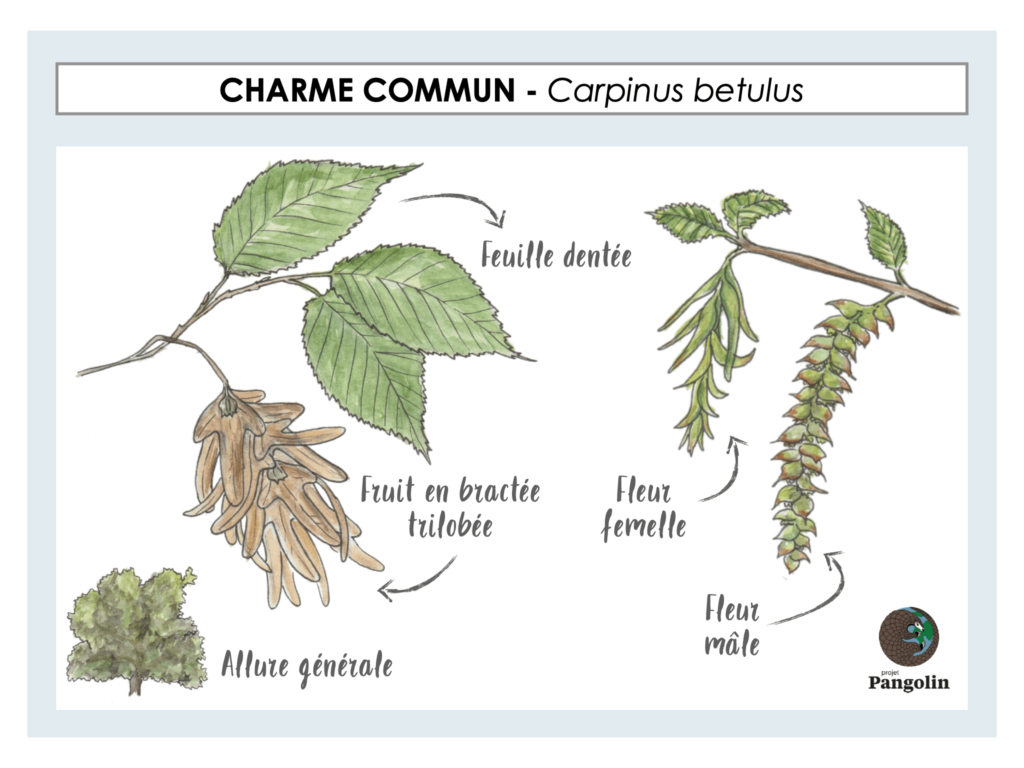
Il est plus petit que le chêne, puisqu’à l’âge adulte, il mesure “seulement” 20 m de haut. Il a une croissance très lente comparée à d’autres arbres.
Le charme a une cime ronde ou ovoïde et des feuilles vertes ovales toutes dentées et gaufrées. C’est une espèce monoïque, on retrouve donc sur le même arbre des inflorescences mâles et femelles. Les fleurs mâles forment des “chatons” (inflorescence souple) qui pendent. Les fleurs femelles sont plus petites.
Il fleurit et fructifie en avril-mai, juste après la feuillaison, tous les deux ans. Les fruits sont des akènes (des fruits secs, ne contenant qu’une seule graine) munis d’une bractée (pièce florale ressemblant à une feuille). Cette bractée trilobée joue le rôle d’ailette pour le fruit, qui est alors beaucoup plus facilement dispersé par le vent : on parle de dispersion anémochore.
Il vit beaucoup moins vieux que le chêne puisque sa longévité n’excède pas 150 ans.
On confond souvent le charme et le hêtre car leurs feuilles se ressemblent. Cependant, les feuilles de charme sont dentées alors que celles du hêtre, non. De plus, les feuilles de hêtre sont poilues. Voici un moyen mnémotechnique de s'en souvenir : "le charme d'Adam c'est d'être à poils".
Son bois est blanc et très dur. Cela en fait un bois difficile à travailler et cassant. On l’utilise ainsi très peu en construction mais c’est un excellent bois de chauffage : il se consume lentement et fournit de bonnes braises. Dans l’ancien temps, on s’en servait beaucoup pour fabriquer les jougs des chars à bœufs (ces pièces de bois qui attèlent la charrue aux bœufs). Il est aussi utile en cuisine pour les planches à découper et billots de bouchers. On s’en sert aussi pour faire de la pâte à papier.
Le pin maritime, ou Pinus pinaster, est un arbre de la famille des Pinacées. C’est un conifère (arbre dont les graines sont portées par une structure en forme de cône). C’est un résineux, il produit donc de la résine.
Le pin maritime est une espèce originaire du bassin Méditerranéen (péninsule ibérique, Sud de la France, zones côtières de l’Europe de l’Est (Slovénie, Croatie, Grèce, Turquie…) et Nord de l’Afrique) et se retrouve aujourd’hui sur quasi tout le territoire Français (sauf dans le Grand-Est).
Étant donné son origine biogéographique, on se doute que c'est un arbre qui aime le soleil et la chaleur. Il supporte bien la sécheresse mais pas les gelées. Il n’aime pas les sols calcaires mais se satisfait des sols pauvres et sablonneux.
Le pin maritime adulte mesure entre 20 et 30 m de haut. Il arrive à maturité à l’âge de 40-50 ans. Les jeunes pins sont de forme conique mais les plus vieux sont plus dégarnis, ils ont un long tronc nu et un houppier dispersé, plutôt plat et étalé.
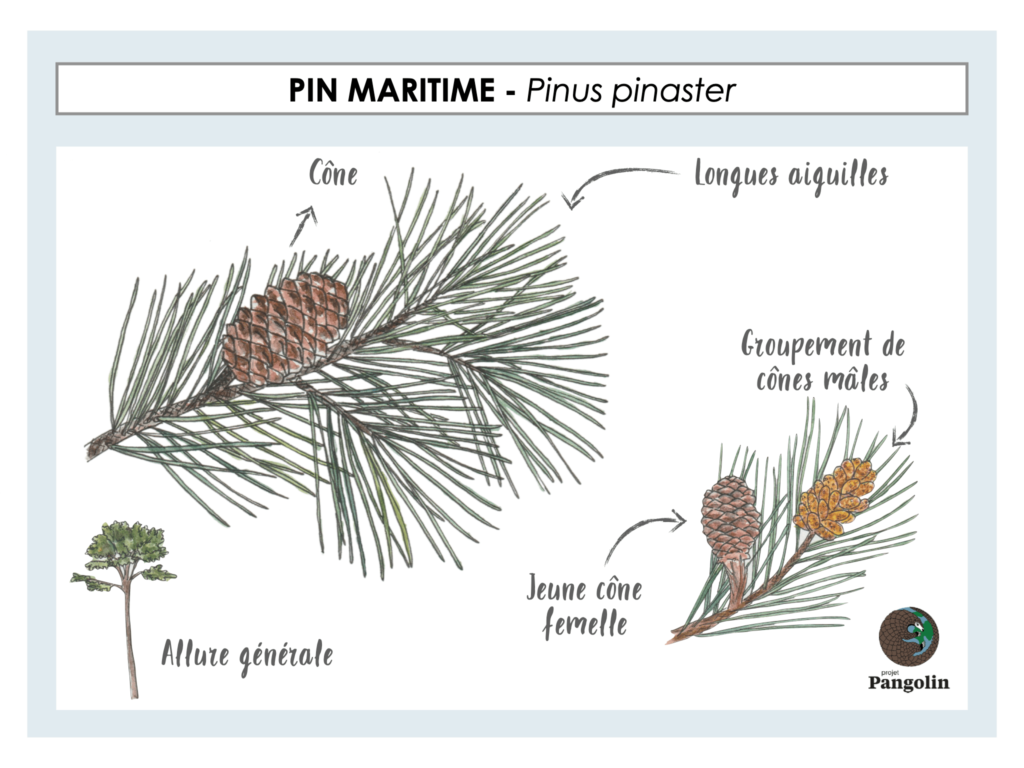
Chez le pin maritime, comme chez les autres conifères, les feuilles sont modifiées en aiguilles qui mesurent 10-20 cm de long. Elles sont épaisses, rigides et groupées par deux. Comme beaucoup d’autres résineux (mais pas tous !), le pin maritime est un arbre à feuillage persistant : ses feuilles ne tombent pas à l’automne.
Le pin maritime, comme de nombreux conifères, ne fait pas partie des plantes à fleurs. Il ne produit donc pas de véritables fleurs. À la place, il produit des cônes mâles qui vont donner le pollen et des cônes femelles qui abriteront les graines. C’est une espèce monoïque, l’arbre porte donc des cônes mâles et femelles. La floraison a lieu en avril-mai. Les cônes mâles sont très petits (2 cm) et produisent énormément de pollen jaune. Les cônes femelles sont quant à eux beaucoup plus grands (10-18 cm de long). Ils sont de forme oblongue et constitués d’écailles.
Les graines se trouvent à la base des écailles et sont libérées lorsque ces dernières s’ouvrent. Elles sont petites (< 1 cm de long pour 3 mm de large) et munies d’une grande ailette (3 cm) qui leur permet d’être disséminées par le vent (anémochorie). Le pin maritime fructifie dès sa deuxième année de vie et vit jusqu’à 100 ans.
Le pin maritime a été introduit dans les landes à la fin du 18ème siècle pour fixer les dunes du golfe de Gascogne. En effet, les racines des végétaux retiennent le sable contrent ainsi l'érosion.
C’est l’une des espèces d'arbres ayant un fort intérêt économique en France, surtout dans le Sud-Ouest (les fameux pins des Landes). Son bois est utilisé en construction (e.g. charpente) et en trituration (panneaux de bois recomposés, pâte à papier), mais son utilisation comme bois de chauffage est déconseillée. En effet, bois peu dense, il brûle très vite et a un faible pouvoir calorifique (peu de chaleur produite au prorata de la quantité de bois brûlé). De plus, il monte très haut en température ce qui peut représenter des risques pour les cheminées et poêles. Ses cônes et ses aiguilles constituent néanmoins de très bons allume-feux. Sa résine est quant à elle utilisée pour la fabrication de sirops, pastilles contre la toux et bonbons.
L’érable plane, ou Acer platanoides L. (pour Linné) est un arbre de la famille des Sapindacées (qui comprend également des espèces très exotiques comme le litchi !). C’est un feuillu au feuillage caduc. À l’automne, ses feuilles se teintent de jaune et rouge avant de tomber.
C’est un arbre originaire d’Europe que l’on retrouve partout en Europe (de la Norvège à l’Espagne et la Russie) et en France sur tout le territoire.
L’érable plane préfère les zones de mi-ombre et un climat assez humide. Dans le Sud de son aire de répartition, il a donc tendance à être retrouvé en basse et moyenne montagne (jusqu’à 1500 m d’altitude) alors qu’au Nord, il s’acclimate également bien en plaine.
C’est un grand arbre pouvant mesurer jusqu’à 30 m de haut. Il a une forme plutôt en boule (houppier ovoïde) et est donc assez large à maturité (autour de 10 m).
Ses feuilles sont grandes (15 cm), plates et palmées, et vertes foncées au-dessus alors que le dessous est plus clair. Elles ont 5 lobes pointus qui les font ressembler aux feuilles du platane, d’où son nom d’érable “plane” ou “platanoides”.
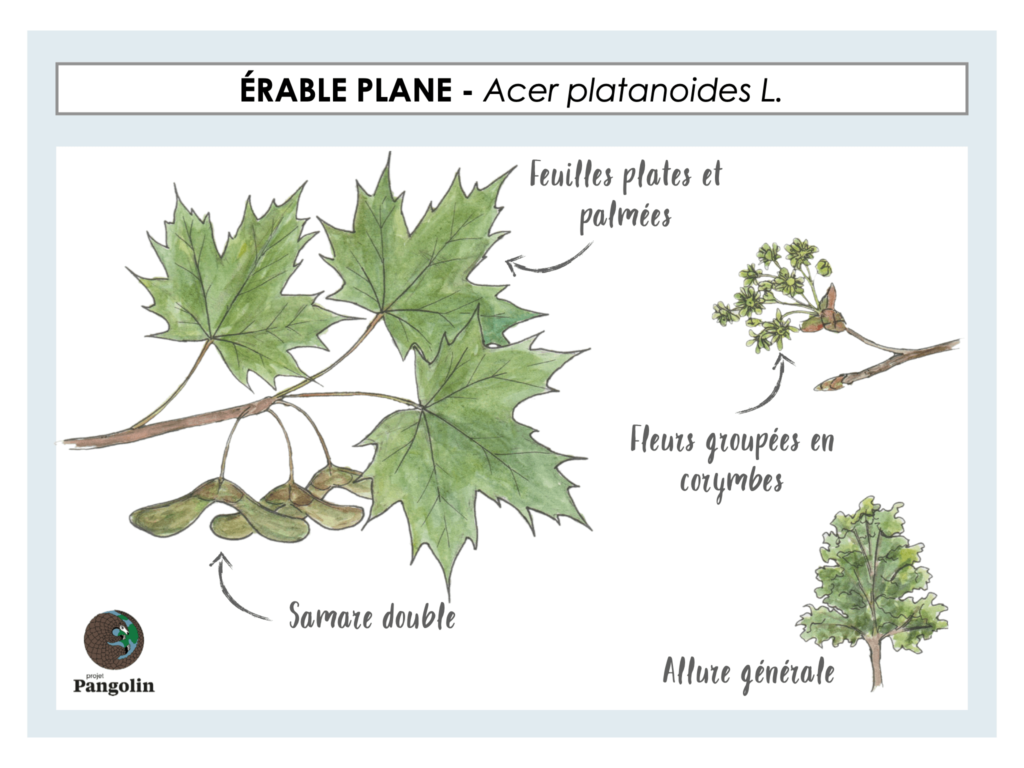
L’érable vit relativement longtemps : jusqu’à 200 ans et présente un bois clair, assez dur, qui est très utilisé en menuiserie et ébénisterie ou comme bois de chauffage.
Ses fleurs, qui apparaissent en avril-mai avant les feuilles, sont vert-jaunes, groupées en corymbes (c’est-à-dire que même si tous les pédoncules ne partent pas du même point, toutes les fleurs sont sur le même plan : les pédoncules ont des longueurs variables). Elles forment un petit bouquet. Ce sont des fleurs mellifères : elles produisent beaucoup de nectar et de pollen. L’arbre est alors tout couvert de jaune.
Les fleurs deviennent ensuite des fruits qui sont des disamares (samare double, un samare étant un akène, c’est à dire un fruit sec ne contenant qu’une seule graine, comme nous l’avons vu plus haut) avec des ailes membraneuses, qui sont grandes, opposées l’une à l’autre et presque horizontales. Elles sont donc dispersées par le vent, c’est l’anémochorie.
L'érable plane n'est pas l'érable qui sert à faire le fameux sirop d'érable. En effet, ce dernier, originaire du Canada, est fabriqué à partir de la sève d'érable à sucre (Acer saccharum). L'érable européen est présent au canada a de rares endroits où il est une espèce invasive qui a des effets néfastes sur les érables à sucre.
Le châtaignier commun ou Castanea sativa appartient à la famille des Fagacées (tout comme le chêne pédonculé et le hêtre). C’est un arbre majestueux possédant un feuillage caduc. À l’âge adulte, son houppier a une forme ronde et large.
On le retrouve dans toute l’Europe méridionale et presque partout en France et en Corse. Il est très probablement originaire d’Europe du Sud et a été dispersé par les humains pour ses nombreux usages.
Le châtaignier apprécie les climats doux que l’on retrouve sur les pourtours méditerranéens. Il ne s'établit pas au-dessus de 1000 m d’altitude car il craint les gelées tardives. Cet arbre peut devenir très grand (25-35m) et se distingue par ses longues feuilles alternes (20 cm) légèrement dentées et se terminant en pointe.
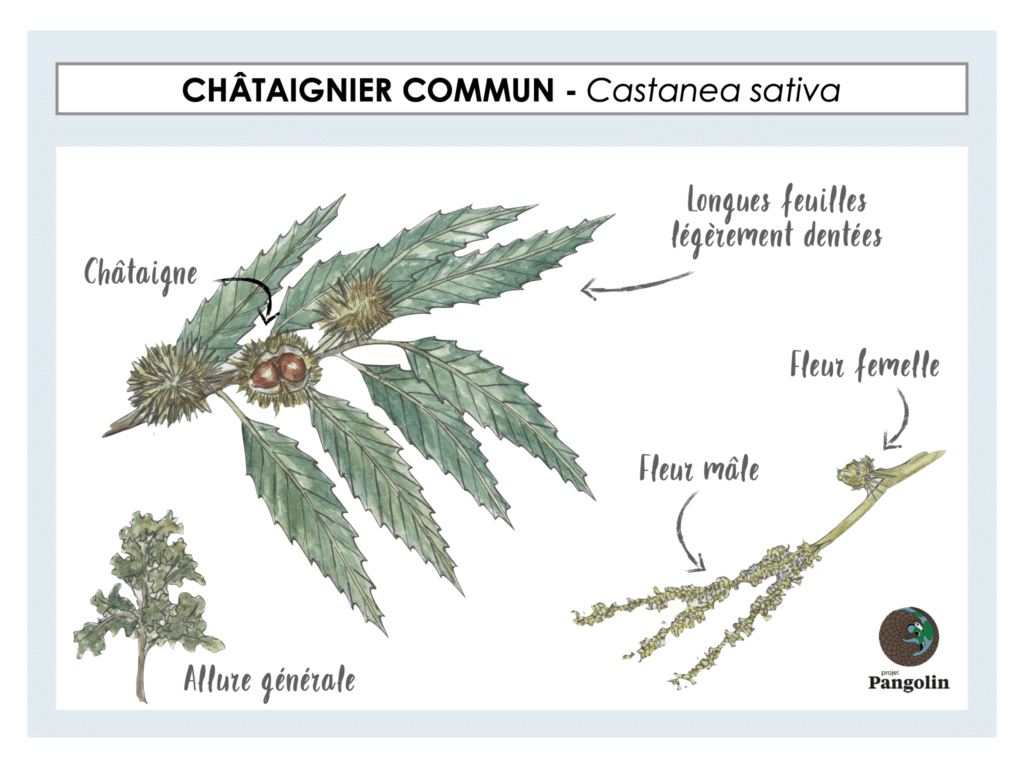
Le châtaignier fleurit entre juin et juillet. Les fleurs mâles et femelles sont présentes sur le même arbre. Pour éviter l'autofécondation, les fleurs mâles et femelles d’un même arbre ne sont pas matures en même temps. Ainsi la fécondation par un autre membre de l’espèce se fait grâce aux insectes et au vent (zoogamie et anémogamie). On peut récolter ses fruits à partir du mois d’octobre. Mais attention, les châtaignes sont dissimulées dans des bogues (enveloppes vertes et épineuses) qui peuvent piquer et dissuader les prédateurs de les consommer.
Cette espèce d’arbre est aussi particulièrement remarquable pour sa longévité. En effet, les châtaigniers peuvent atteindre 500 voire 1000 ans. Un spécimen exceptionnel localisé en Sicile est même âgé d’environ 3000 ans !
Le bois du châtaignier a aussi été très utilisé en tant que vois de charpente. Son odeur prononcée permet de repousser les mouches. Ainsi, les araignées ne viennent pas tisser leurs toiles sur ces poutres qui n'abritent pas de proies intéressantes pour elles.
Au-delà des délicieuses châtaignes que nous mangeons à l’automne, cet arbre à croissance rapide est aussi très apprécié pour son bois (menuiserie et autrefois en tonnellerie). Grâce à ses fleurs mellifères, les abeilles peuvent produire du miel de châtaignier connu pour son goût intense et sa couleur brune.
Le hêtre commun Fagus sylvatica est aussi un membre de la famille des Fagacées. C’est un grand arbre qui peut atteindre les 40 m de hauteur et qui possède un feuillage caduc.
Le hêtre commun est présent dans une grande partie de l’Europe (jusqu’au Sud des pays scandinaves et jusqu’au Nord du Portugal). On le retrouve aussi sur le pourtour méditerranéen mais uniquement dans les hauteurs. Il affectionne particulièrement les climats tempérés humides de plaine et moyenne montagne et préfère les sols frais.
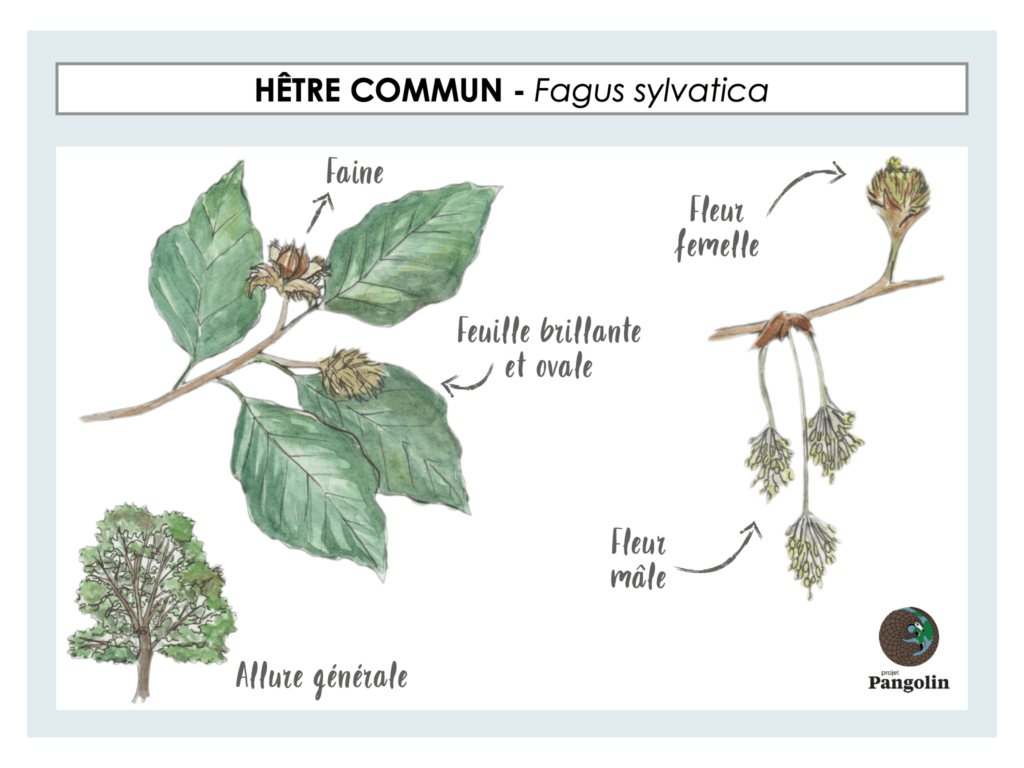
L’allure générale du hêtre commun peut varier en fonction de l’habitat et de l’action humaine. En effet, s’il se développe en forêt il sera élancé avec un houppier fin. Au contraire, s'il s’établit isolément il aura tendance à être plus petit mais le houppier sera large avec des branches très étalées. Ses feuilles sont alternes, brillantes et ovales. Elles mesurent entre 6 et 10 cm de long.
Cet arbre atteint sa maturité sexuelle à 40 ans, ainsi il ne fructifie pas avant. Sa floraison a lieu en avril-mai. Les fleurs mâles et femelles sont présentes sur le même rameau et se développent en même temps que les feuilles. Ces fleurs sont petites, formant des glomérules (amas denses de plusieurs fleurs), et peuvent passer inaperçues.
S’il y a eu fécondation, alors la fructification aura lieu en août et septembre et produira un fruit appelé faine. Elles peuvent être consommées par les humains (en petite quantité) et sont très appréciées par la faune forestière comme les sangliers par exemple.
Le hêtre vit en moyenne 150 ans et exceptionnellement peut atteindre les 400 ans.
Le hêtre, comme de nombreuses plantes, vit en symbiose avec des champignons (on parle de champignon mycorhizien) qui protègent ses racines contre les bactéries et lui permettent d'améliorer sa croissance en lui apportant des éléments minéraux. Sans ces organismes fongiques, les hêtres ne peuvent pas se développer et vivre normalement.
Les humains utilisent le bois de hêtre dans l’ameublement mais surtout pour du bois de chauffage. Les faines ont aussi leur utilité, elles sont riches en matières grasses et donc peuvent être pressées pour en faire de l’huile comestible. Cette huile était aussi utilisée pour l’éclairage.
Le frêne commun ou Fraxinus excelsior est un grand arbre au feuillage caduc appartenant à la famille des Oléacées (comme le jasmin).
Cette espèce est présente dans toute l’Europe jusqu’au Sud des pays scandinaves et au Nord du Portugal et de l’Espagne, ainsi que dans une partie de l’Asie. Il est aussi très présent en Angleterre et sur les pourtours de la mer noire. On ne le retrouve pas dans la région méditerranéenne car cette espèce est sensible à la sécheresse.
Il affectionne les terrains frais et humides comme le fond des vallées et peut vivre en montagne jusqu'à 1500 m d’altitude.
Ce sont en général, de grands arbres pouvant atteindre les 45 m de hauteur. Les frênes sont d’allure élancée (étroits et allongés). Cette espèce est dioïque (un arbre est soit mâle, soit femelle) mais on rencontre parfois des individus monoïques. La floraison se déroule entre mars et avril, les feuilles apparaissent plus tard. Les feuilles de frêne sont grandes (entre 20 et 40 cm), vert foncé et opposées. Le frêne peut produire une grande quantité de pollen et générer des allergies. Après fécondation, les fleurs vont donner des fruits aplatis arborant une aile membraneuse allongée. Ce type de fruit, appelé samare, permet une dissémination efficace par le vent. Le hêtre peut vivre entre 150 et 200 ans.
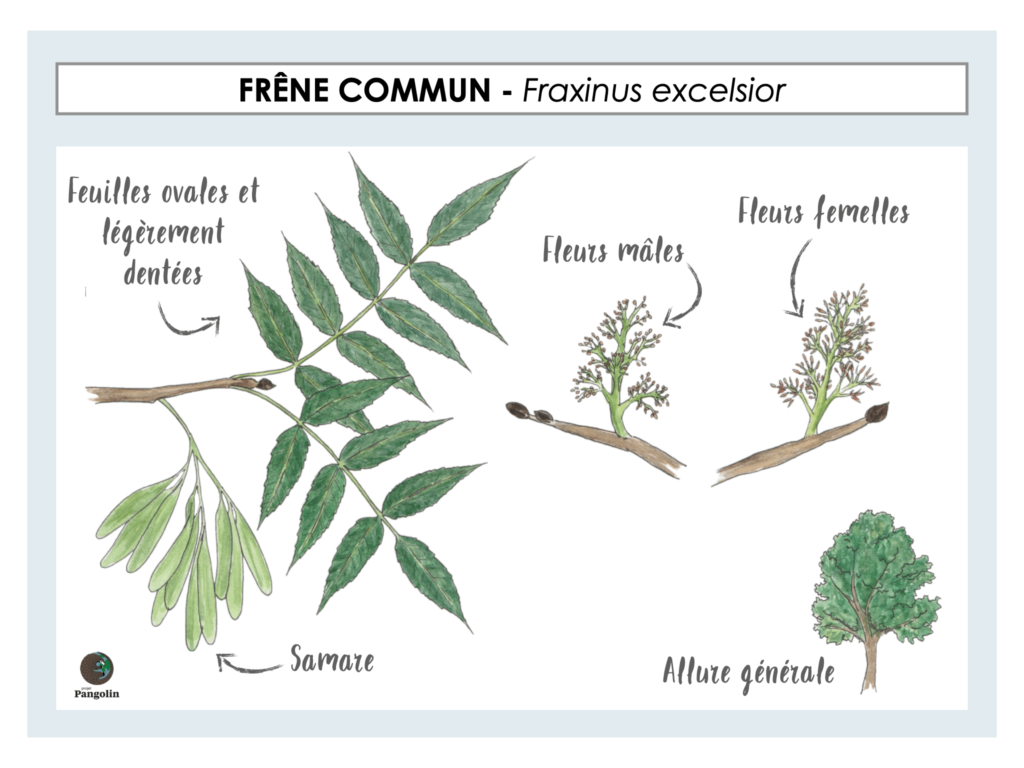
Son bois peut être utilisé comme bois de chauffage mais aussi en tant que manche d’outils, d’armes ou pour des articles de sports (lances, arcs, avirons, skis) car il offre des propriétés mécaniques particulières : une très bonne résistance aux chocs et vibrations et une grande élasticité. Ses feuilles ont des propriétés médicinales reconnues scientifiquement. En effet, elles sont anti-inflammatoires et diurétiques.
Lorsqu'il fait chaud, les feuilles de frêne se retrouvent recouverts de miellat (liquide sucré et épais sécrété par des insectes après ingestion de la sève du frêne). Ce miellat peut être utilisé pour faire une boisson fermentée pétillante et faiblement alcoolisée appelée frênette !
L’épicéa commun ou Picea Abies (ou encore Picea excelsa) est un arbre résineux de grande taille (pouvant dépasser les 50 m).
On le retrouve principalement dans les montagnes de l’Ouest de l’Europe (Alpes, Jura, reliefs allemands, zone septentrionale), il est aussi très présent en Scandinavie. Il semblerait être originaire des Carpates roumaines. Si on le rencontre fréquemment dans le Massif Central, c’est parce qu’il y a été introduit pour des activités forestières.
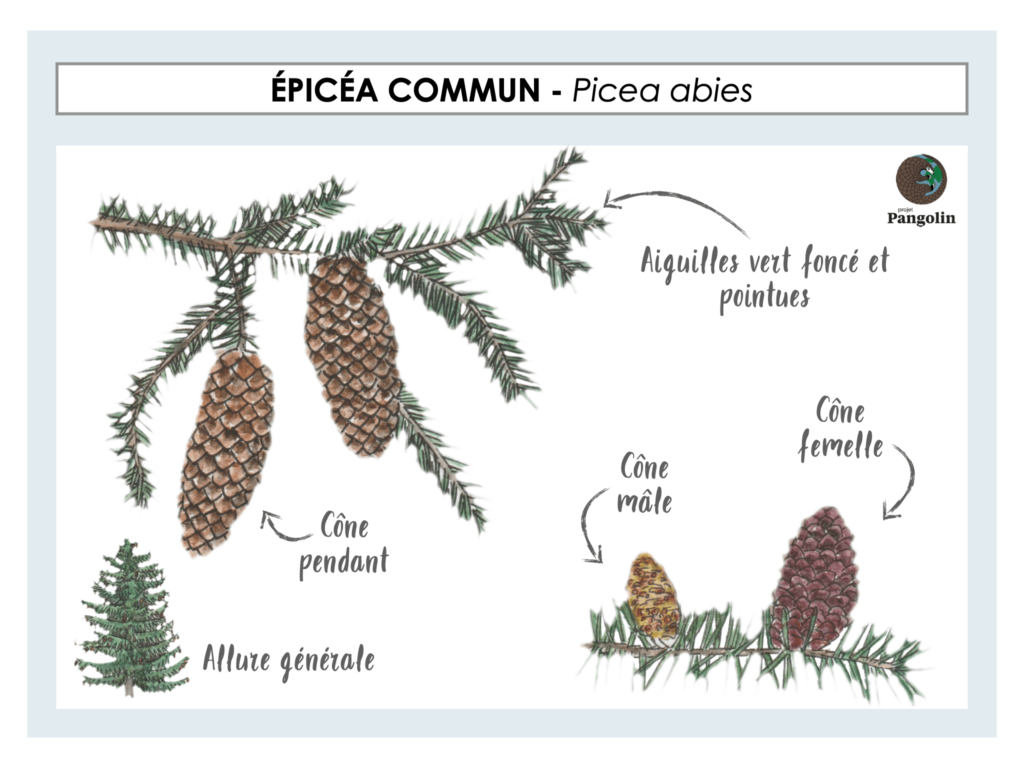
L’épicéa commun apprécie les climats humides et supporte la sécheresse de l’air si le sol est frais. Il est très résistant au froid, on le retrouve même au nord du cercle polaire arctique où les gelées à -40°C ne sont pas rares. Il est présent jusqu’à 2000 m d’altitude.
Ce très grand conifère à l’allure élancée et conique possède des aiguilles pointues et vert foncé mesurant 1-2 cm. Elles vivent 5 à 7 ans et sont remplacées au fur et à mesure, conférant à l’épicéa un feuillage persistant. Il est fréquent de le confondre avec des « vrais » sapins. Un indice pour reconnaître un épicéa se trouve dans la couleur de son écorce rouge riche en résine, ce qui n’est pas le cas chez les sapins. De plus, ses cônes sont pendants contrairement aux sapins qui arborent des cônes dressés et plus arrondis. Cette espèce est monoïque : les cônes mâles et femelles sont présents chez chaque individu. Une fois atteint la maturité sexuelle (à 50 ans !) l’épicéa fructifie tous les deux à huit ans.
Nos sapins de noël ne sont pas de vrais sapins. En réalité, ce sont souvent des épicéas car ils étaient considérés comme des arbres porteurs de vie dans la culture celte. Néanmoins, ils tendent à être remplacés par le sapin de Nordmann car celui-co perd ses aiguilles moins rapidement.
L’épicéa peut vivre entre 300 et 400 ans. Cet arbre est principalement utilisé pour son bois blanc, résistant et facile à manipuler. Pour cette raison, on le retrouve fréquemment dans les charpentes. Il possède aussi des bonnes qualités de résonance et est donc utilisé dans la confection de violons, tables d’harmonies ou encore tuyaux d’orgue.
Abies alba (ou Abies pectinata) est un conifère de la famille des Pinacées. C’est un arbre à feuilles persistantes, elles ne tombent donc pas à l’automne.
Très commun en Europe, il est l’un des principaux résineux dans tout l’étage montagnard. En France, on peut le trouver dans toutes les zones montagneuses telles les Alpes, le Jura, les Pyrénées, le Massif Central mais aussi en Bretagne ou en Normandie.
Le sapin blanc se rencontre très rarement isolé. Il est présent de 400 à 1800 m d’altitude et affectionne particulièrement les environnements où l’humidité de l’air est importante. Classiquement, il peuple l’ubac (versant des montagnes le moins ensoleillé, souvent orienté Nord).
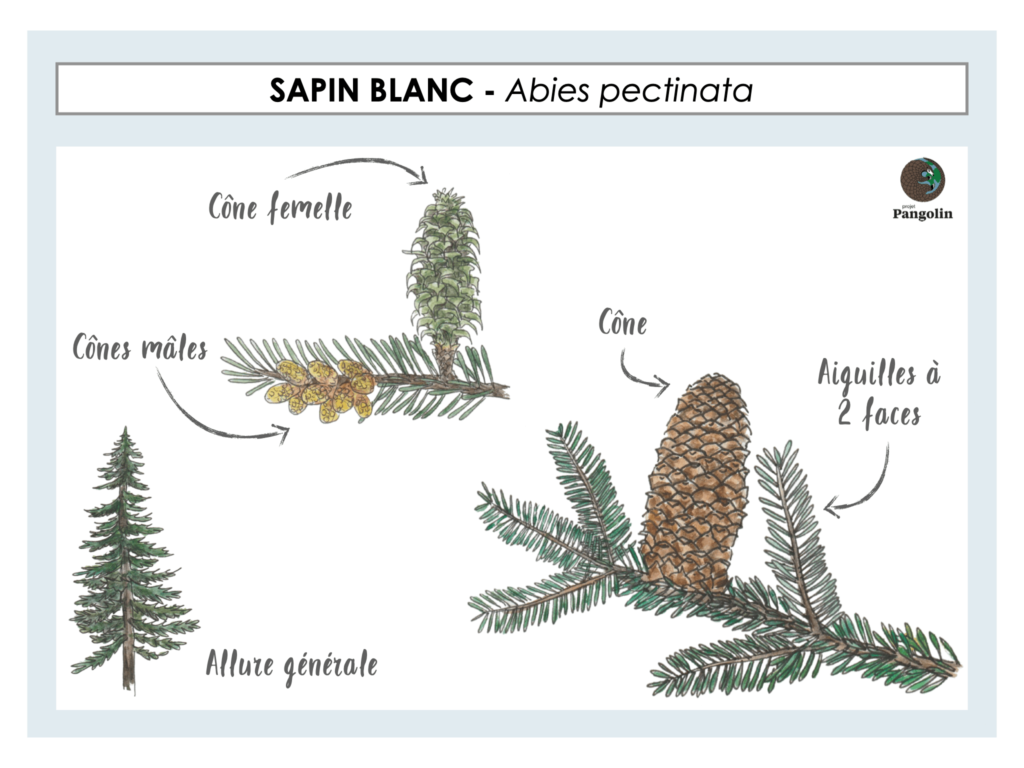
C’est un très grand arbre qui aisément peut atteindre les 60 m. Il est reconnaissable par son port très droit et la couleur argentée de son tronc. La cime est d’abord droite et pointue chez les jeunes arbres puis devient plus arrondie en vieillissant jusqu’à donner une forme dite « en nid de cigogne » c’est-à-dire ovale et très étalée. Le tronc est lisse, gris-argenté et n’est craquelé que chez les vieux arbres.
Les feuilles ou aiguilles sont plates et non piquantes. À la base du rameau, elles sont implantées tout autour de la tige avant de se placer sur deux rangées de part et d’autre comme les dents d’un peigne. Sur les rameaux proches de la cime, les aiguilles sont moins alignées et semblent plus en brosse.
Les branches et les plus petits rameaux sont placés horizontalement.
Les cônes femelles se développent sur les rameaux de l’année, près de la cime puis maturent pendant une année complète. Ils deviennent alors de grands cônes, cylindriques, dressés sur le dessus des rameaux. À l’automne ces cônes se désarticulent et laissent échapper les graines, sortent de grandes écailles ailées, qui tombent alors au sol.
Le sapin blanc ne commence à produire des cônes qu’à partir de 30 ou 40 ans et peut vivre plusieurs centaines d’années (jusqu’à 600 ans selon les hautes estimations).
On confond souvent le sapin blanc et l'épicéa, deux résineux très présents en France. Pour les différencier : le sapin a les cônes qui se dressent à la verticale sur le dessus des rameaux comme des chandelles tandis que les cônes d'épicéa 'tombent' vers le bas. Les aiguilles de sapin sont plates alors que celles des épicéas ont une section plus ronde. Faites le test, si l'aiguille ne roule pas sous vos doigts, c'est un sapin !
Le saule blanc, Salix alba, est un arbre caduc de la famille des Salicacées. Il est le plus grand des saules (arbres du genre Salix) avec une taille maximale de 25 m.
On le trouve partout en France mais son aire de répartition couvre tout le Nord de l’Europe et de l’Asie. C’est une espèce pionnière, comme le chêne vu plus haut, (c’est-à-dire qu’elle est parmi les premières espèces à coloniser un milieu récemment apparu) qui peut vivre une centaine d’années.
Très commun, il peuple les environnements humides et frais et tout particulièrement les bords de rivières en basse altitude. Il est toutefois rare en forêt où la compétition pour la lumière lui est défavorable.
Le saule blanc a un port érigé droit avec des branches dressées. Les feuilles, caduques, font de 5 à 12 cm de long. Elles sont fines, étroites et en forme de lance légèrement dentelées. Elles sont recouvertes d’une fine couche de soies, plus importante sur la face inférieure, qui leur donne cette couleur légèrement blanche à argentée.
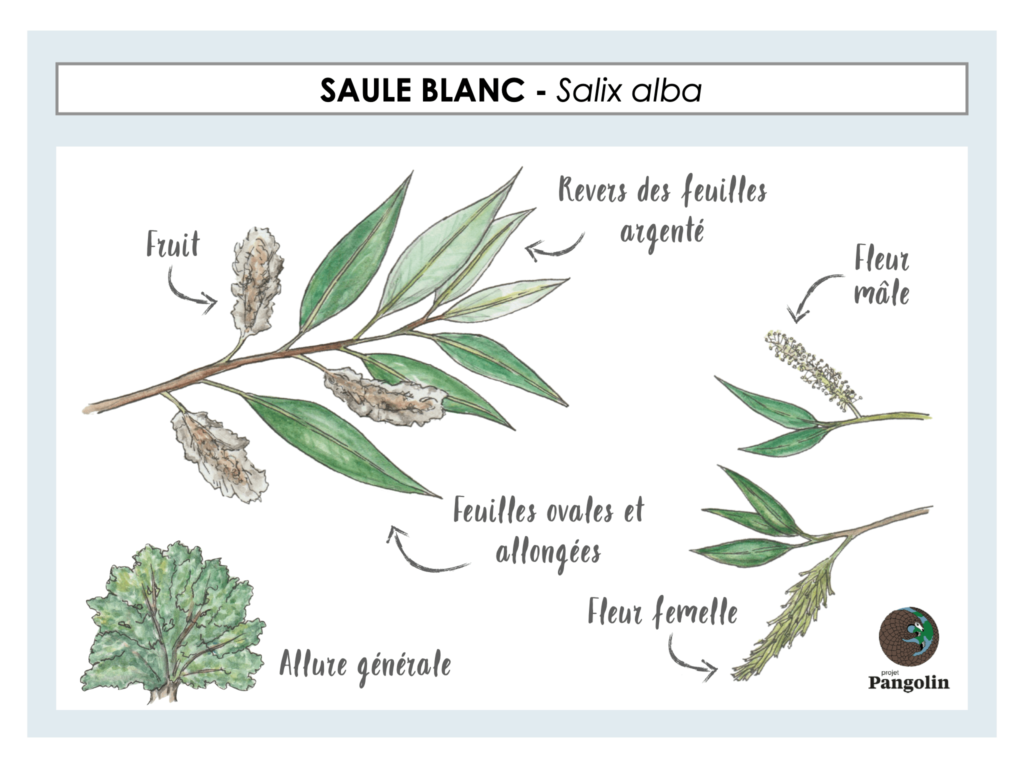
Les fleurs apparaissent d’avril à mai. Le saule blanc est dioïque (les deux sexes sont présents en des organes différents sur le même arbre). Le saule produit ainsi des fleurs femelles et des fleurs mâles, groupées en chatons sur des rameaux aux feuilles courtes et non dentées. Les chatons mâles sont grêles et arqués et présentent de nombreuses petites fleurs. Les fleurs femelles, disposées sur des chatons plus courts, possèdent un seul ovaire qui se transformera, après fécondation, en capsule formée de deux valves qui libéreront les graines. Ces dernières sont dotées de nombreux poils blancs qui leur confèrent un aspect cotonneux.
Son tronc est court et massif. L’écorce du saule, assez claire, prend une teinte vert-grisâtre en vieillissant et des fissures apparaissent également.
L'écorce du saule contient plusieurs composés chimiques d'intérêt pharmaceutique comme la salicyline qui est l'un des principes actifs de l'aspirine. Ainsi l'écorce de saule était utilisée en décoction depuis l'antiquité pour lutter contre la fièvre.
Les saules sont parfois taillés en « têtard », c’est-à-dire qu’ils sont étêtés et taillés régulièrement pour stimuler la pousse de jeunes branches. Ces branches très souples sont alors utilisées pour la vannerie (elles servent à la confection d’objets en osier comme des paniers). Le bois est également utilisé en menuiserie ou pour la sculpture car facile à travailler.
Le merisier, Prunus avium, aussi appelé cerisier sauvage ou cerisier des bois, est un arbre à feuillage caduc de la famille des Rosacées. Avec Prunus cerasus, il est l’un des deux cerisiers sauvages à l’origine des variétés de cerises que l’on cultive actuellement.
Présent partout en France, son aire de distribution s’étend sur toute l’Europe, l’Asie et l’Ouest africain. Il est également cultivé dans toutes les régions tempérées du globe. Le merisier se retrouve en milieu forestier, éparpillé au milieu des autres essences d’arbres. C’est un arbre qui requiert beaucoup de lumière. C’est un grand arbre, pouvant atteindre 25 à 30 m, à fût droit et cylindrique. Il peut vivre jusqu’à 100 ans. Son écorce est assez claire et a tendance à se déchirer en lanières horizontales ce qui lui donne un aspect zébré très caractéristique.
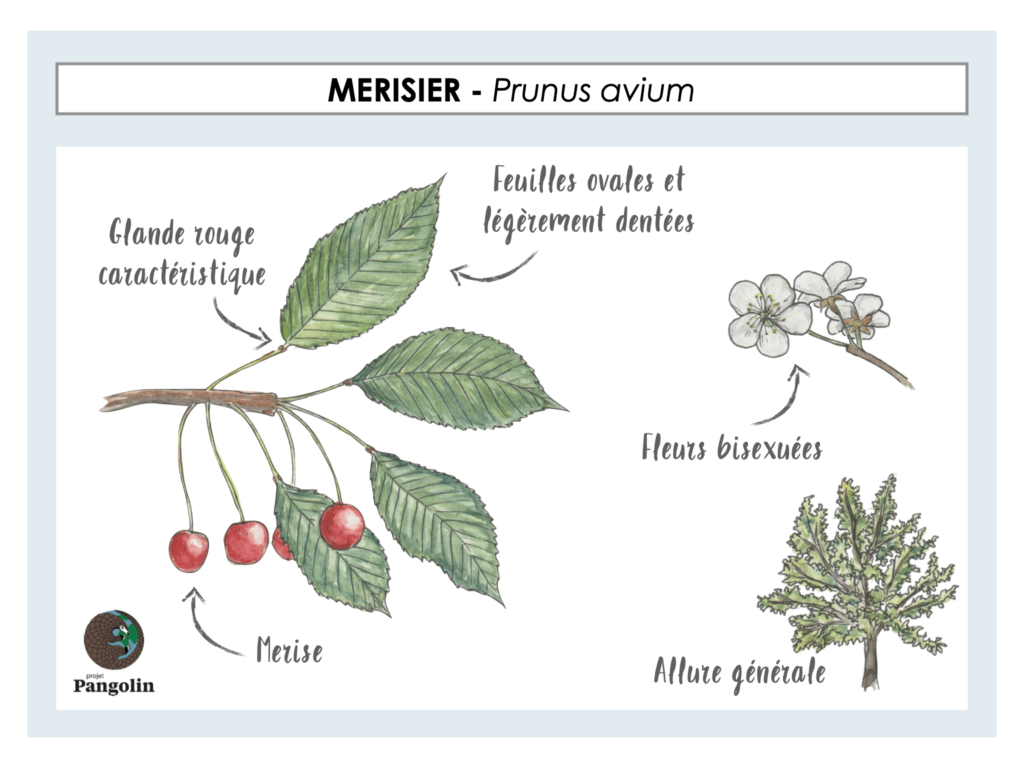
Les feuilles sont grandes, elliptiques et dentées. Elles possèdent des poils fins sous les nervures principales et deux petites glandes rouges à la base du limbe qui sont productrices de nectar. Les fleurs apparaissent d’avril à mai et sont groupées en petits bouquets sur le bord des rameaux. Elles sont blanches, pédonculées et possèdent 5 pétales. La pollinisation est principalement assurée par les insectes qui visitent volontiers les fleurs au printemps.
Après la fécondation les fruits apparaissent au milieu de l’été. Ils ressemblent à des cerises pâles avec un long pédoncule. Ces « merises » sont comestibles mais leur goût est amer.
Le bois de merisier est très apprécié en menuiserie. Il offre une couleur brun rosé assez claire et est un bois solide et recherché pour la confection de meubles.
Le merisier et surtout les merises sont très appréciées des oiseaux. De plus, le merisier est plus précoce que les espèces de cerisiers cultivées. Ainsi des merisiers sont souvent plantés en bordures de vergers de cerisiers pour attirer les oiseaux et protéger les espèces cultivées. C'est pour cela qu'on le surnomme parfois le cerisier des oiseaux. Le merisier, plus robuste que certaines variétés de cerisiers, est aussi utilisé comme porte-greffe.
L’alisier torminal (Sorbus torminalis) est un grand arbre caduc de la famille des Rosacées (comme l’aubépine, les fraises, les mûres, le pommier… ou le merisier, vu plus haut) d’environ 20 à 25 m de haut voire 30 m en forêt. Sa longévité pourrait atteindre les 300 ans d’après les plus grands spécimens répertoriés.
Il est présent dans toute l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Asie mineure.
C’est un arbre qui s’accommode de nombreux sols, même pauvres, tant calcaires qu’argileux, mais pousse lentement. Bien qu’on puisse le trouver en pleine forêt, il pousse volontiers en lisière, en bord de clairière ou dans toute trouée créée par la chute d’un arbre. C’est une espèce peu abondante en forêt. On le retrouve souvent associé à de gros chênes, hêtres ou charmes, en pleine ou basse montagne.
L’alisier possède une écorce gris-brun qui est fortement fissurée et qui s’exfolie.
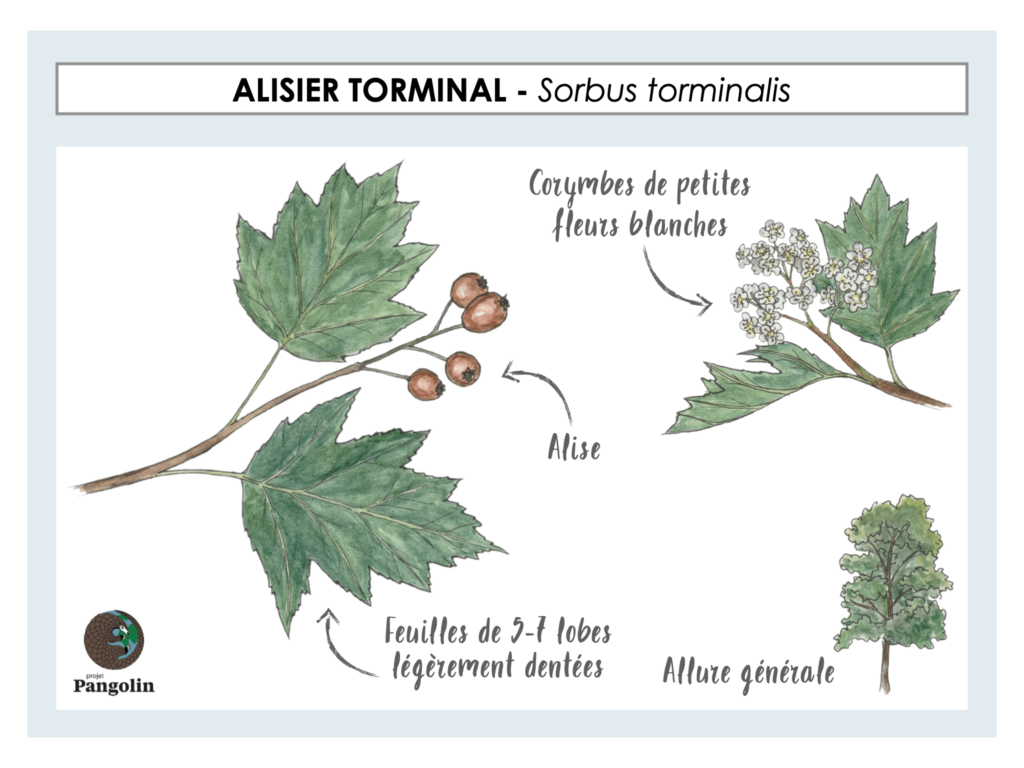
Ses feuilles d’un vert foncé possèdent un long pétiole. Longues d’une dizaine de centimètres et presque aussi larges, elles sont largement ovales, tronquées à la base et ont de 5 à 7 lobes de tailles inégales et dentés. Elles évoquent vaguement les feuilles de l’érable et du platane ou pour les plus imaginatifs, la forme d’une grenouille aplatie !
L’alisier torminal fleurit de mai à juin. Il est hermaphrodite et produit des corymbes de petites fleurs blanches d’un centimètre de diamètre environ, avec de grandes étamines. Ces fleurs sont très appréciées des insectes qui les pollinisent.
Les fruits apparaissent à partir de septembre et sont appelés les alises. Ce sont de petites drupes ovoïdes d’environ 15 mm de diamètre rouges puis brunes à maturité. Il peut être consommé blette (c’est-à-dire après avoir gelé) et sert à la confection d’eau-de-vie. De nombreux animaux apprécient également ses fruits comme les oiseaux ou certains mammifères et participent ainsi à leur dispersion (zoochorie).
Le bois de l’alisier torminal est un bois lourd, dur et très dense. Pourtant, il se travail très bien et est très stable. C’est pourquoi il est assez recherché et s’utilise pour la confection de violons, la marqueterie, la sculpture ou la gravure.
Les fruits de l'alisier torminal sont chargés en tanins et peuvent être utilisés pour soigner les diarrhées. D'ailleurs, son nom latin Sorbus torminalus, nous en apprend beaucoup sur son utilité : Sorbus vient du latin sorbere qui signifie "boire" et décrit le côté astringent des alises de ce genre de plantes. Quant au nom d'espèce torminalis, il vient du mot latin torquere qui veut dire se tordre et se traduit par "qui guérit les coliques".
Vous ne le savez peut-être pas mais une haie ingénieusement plantée peut représenter un atout pour la biodiversité. On vous dévoile les bienfaits des haies pour l’environnement mais aussi quelques astuces pour optimiser leur efficacité.
Avant toute chose, on doit vous dire qu’il existe une ribambelle de types de haie (bocagère, mellifère, champêtre, libre, coupe-feu, vive) et qu’elles ont chacune des fonctions bien spécifiques. Dans cet article, on va s’intéresser essentiellement aux haies qui ont un impact positif très important sur la biodiversité mais gardez en tête qu’il en existe plein d’autres (des détails ici).
Dans l’imaginaire collectif, une haie sert principalement à délimiter une propriété tout en se protégeant du regard de voisins trop curieux. En réalité, elles peuvent faire BEAUCOUP plus que ça.
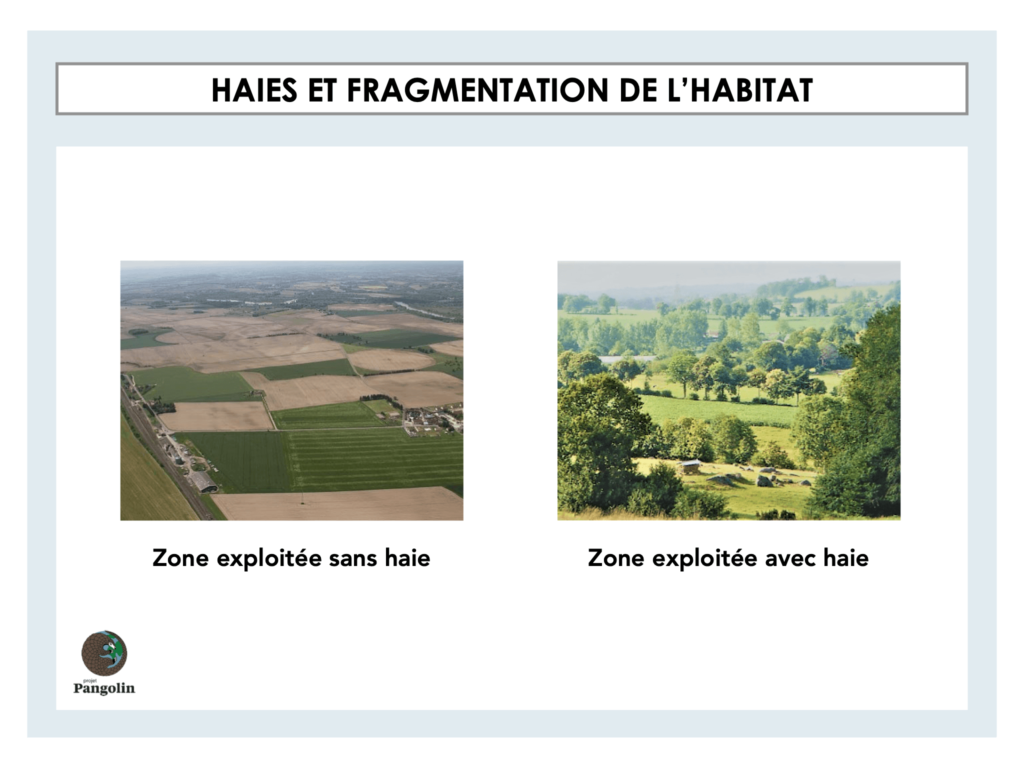
Les haies permettent de limiter la fragmentation de l’habitat en créant des corridors biologiques. Ce sont des petits espaces protégés de l’impact humain où la biodiversité peut s’épanouir, circuler et se réfugier. En effet, de nombreuses espèces faisant partie de la microfaune (renards, petits oiseaux, lézards, grenouilles, limaces, araignées et insectes) ont besoin des haies pour continuer de circuler dans des zones où les humains se sont établis. Faire le choix d’investir dans une haie arborée plutôt qu’un grillage dans son jardin est donc un geste éco-citoyen accessible permettant d’améliorer la vie de la biodiversité locale.
Avant le milieu du 21ème siècle, le paysage agricole français présentait d'importantes zones exploitées composées de haies qui délimitaient alors les champs les uns des autres. Cependant, lorsque l'agriculture s'est modernisée entre 1955 et 1975, les paysages ruraux ont été profondément transformés par les opérations de remembrement. LEs haies et bosquets ont alors été détruits puis gagner du terrain et de la productivité.
Cependant, si l’on veut que cette haie soit bénéfique pour la biodiversité, il y a quelques règles d’or à respecter.
Pour composer une haie agréable pour la microfaune, il est important qu’elle contienne des végétaux de différentes tailles. On parle d’arbres de haut jet (de 10 à 20 m), d’arbres de cépée (de 3 à 8 m) et d’arbustes (plus petits que 3m et avec des branches partant de la base du tronc). Si vous souhaitez créer une haie dans votre jardin vous opterez sans doute pour des arbres de taille raisonnable, donc pour des arbres de cépée et des arbustes.
N’oubliez pas qu’en hiver les espèces caduques se retrouvent nues (par définition), si vous souhaitez garder un effet brise-vue tout au long de l’année il faudra ajouter des espèces à feuillage persistant.
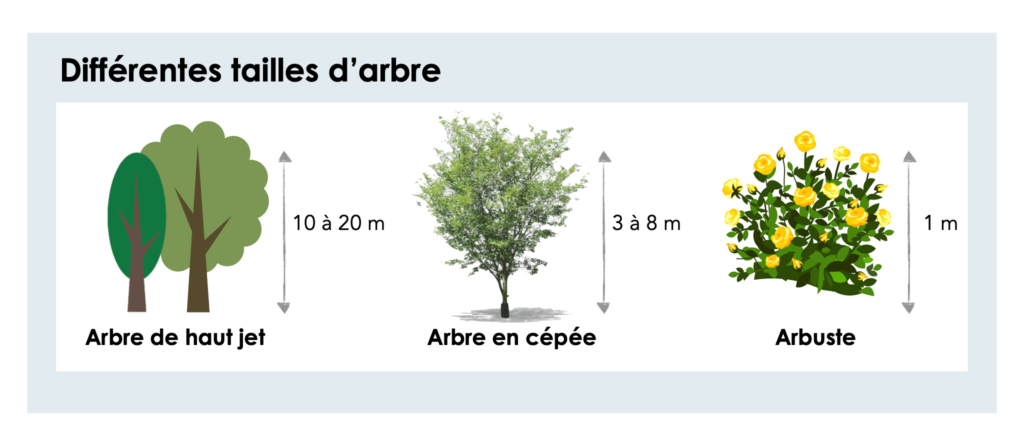
Le choix des espèces présentes dans la haie est crucial et va (en partie) déterminer sa fonction. Néanmoins, il y a deux règles à respecter, peu importe le type de haie que vous souhaitez. Il faudra 1) choisir des espèces locales et 2) favoriser la diversité.
Les espèces naturellement présentes dans votre région sont adaptées aux conditions environnementales de ce lieu, ce qui signifie qu’elles ont plus de chance de s’y épanouir et qu’il y aura moins d’entretien. Elles se fondront dans le paysage.
On ne le répètera jamais assez mais la diversité, c’est la clé (on en parlait ici) ! Alors on essaye au maximum de sélectionner une grande diversité d'espèces, ce qui facilitera la vie d’une plus grande variété d’organismes de la microfaune. Par exemple : des conifères pour les oiseaux granivores, des arbres à fleurs pour les insectes pollinisateurs, des grands fruitiers pour faire de l’ombre et récupérer leurs précieuses productions etc. De plus, en cas de maladie, elle ne pourra pas se propager à l’intégralité de la haie mais sera cantonnée à l’espèce infectée.
Cette étape de visionnage est plus importante que ce qu’on pourrait croire a priori. En dessinant (et en respectant les échelles) sa future haie, on appréhende mieux le nombre d’arbres qui seront nécessaires et on gagne du temps le jour de la plantation.
Il est nécessaire d’alterner les différentes espèces, de planter sur 2 rangs et en quinconce.
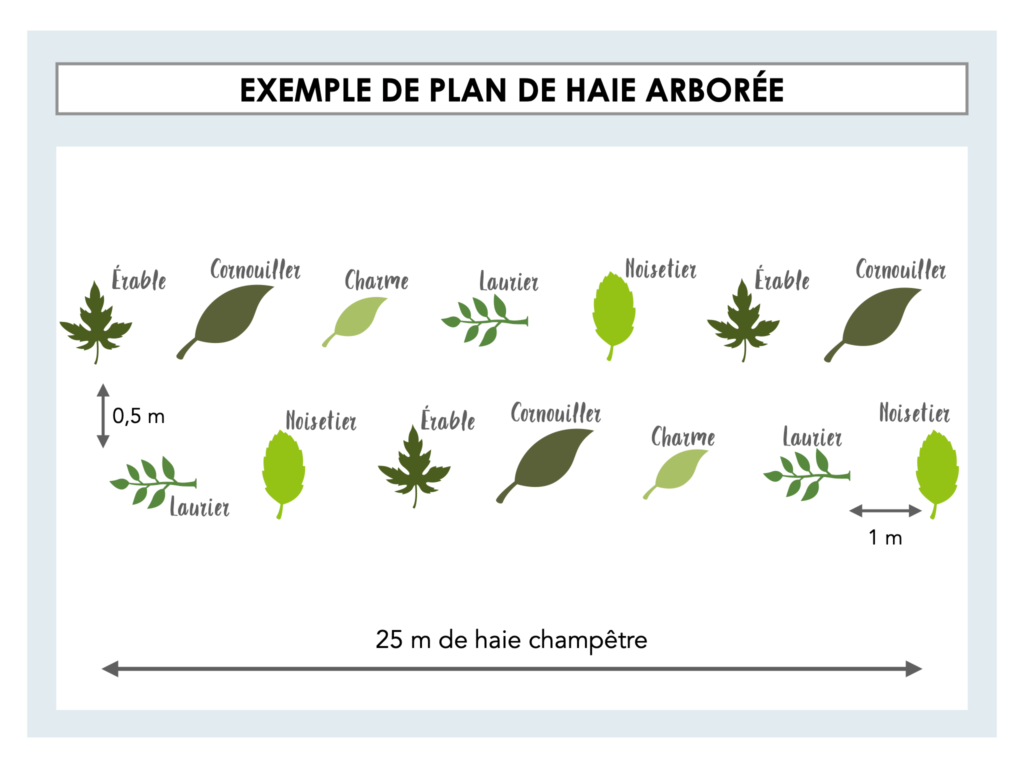
Encore une fois, on essaie de se procurer les végétaux dont on a besoin chez des producteurs locaux. Ce sont des mines d’or d’informations très précieuses. Ils ou elles pourront vous guider dans le choix des espèces pour votre haie et vous donner des conseils précis et spécifiques à votre région pour maximiser vos chances d’avoir une haie en bonne santé.
Après toute cette réflexion, vous pouvez passer à l’action et commencer à planter votre haie. Pour un tutoriel pas à pas et détaillé de la plantation de haie arborée n’hésitez pas à consulter ce guide ooreka.
Après avoir parlé d’arbres bien vivants et de leurs intérêts écologiques, nous pouvons maintenant nous intéresser aux bois morts et à comment les valoriser. Car même morts, les arbres sont des ressources très intéressantes et sont importants pour la nature !
En effet, l’ONF (l’Office National des Forêts) elle-même a une politique de gestion du bois mort en forêt et reconnaît son intérêt écologique. C’est pour cela que lorsque l’on se promène, on peut observer du bois coupé laissé au sol ou des arbres morts laissés sur pieds. La règle prévoit de laisser au moins 1 arbre mort ou sénescent (c’est-à-dire, vieillissant) par hectare. Plein d’informations à ce sujet sont disponibles dans ce guide de l’ONF.
Au sol, le bois mort va se décomposer et enrichir le sol (en formant de l’humus), tout en servant de nourriture et d’abris à tous les décomposeurs du sol. Sur pied, un arbre mort va aussi servir de refuge à des insectes, des champignons, des amphibiens, des oiseaux et d’autres petits mammifères (par exemple, les chats forestiers utilisent les structures en bois mort comme sites de repos, Jerosh et al. 2010, ou encore, certaines chauves-souris utilisent les cavités dans les troncs). Il est estimé que 25% de la biodiversité forestière dépend de la présence de bois mort.
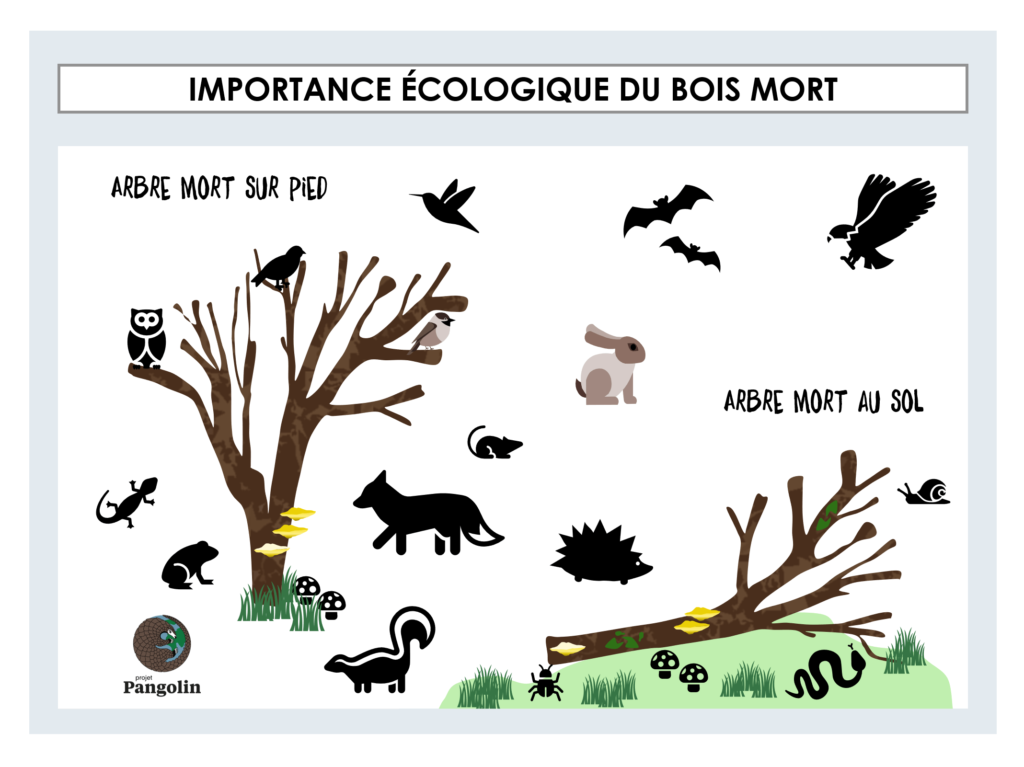
Bon d’accord, mais on ne gère pas tou·te·s des forêts, alors sommes-nous concernés par la gestion du bois mort à notre échelle individuelle ? Bien sûr ! Voyons ensemble ce que nous pouvons en faire.
Tout d’abord, à l’image de l’ONF, nous pouvons laisser des arbres morts sur pieds dans nos jardins. Les oiseaux iront y nicher, la biodiversité sera favorisée et cela nous aidera aussi en permettant l’accueil d’insectes auxiliaires. L’arbre peut être laissé en l’état ou bien on peut s’en servir pour qu’il serve de tuteur à une plante grimpante si l’on souhaite l’habiller.
Il faudra néanmoins veiller à ce que ces arbres ne représentent pas de danger pour nous. Car il est vrai qu’un arbre mort a plus de chances de s’écrouler qu’un arbre vivant. Pour cela, des vérifications simples pourront être faites, notamment après de fortes pluies ou tempêtes.
D’abord, on peut éviter d’aller se balader sous l’arbre en question. Ensuite, on peut le surveiller. On vérifiera notamment s’il est sain : c'est-à-dire, non parasité ou rongé par des insectes xylophages ou des champignons. Il faudra tester sa solidité en le sondant (mécaniquement ou grâce à des ondes sonores, auquel cas on fera appel à des professionnels). On pourra enfin le tailler et enlever ses branches, qui représentent une plus grosse prise au vent et le rendent ainsi plus sensible au déracinage lors de tempêtes ou fortes intempéries.
Si l'on se sert de l'arbre mort pour faire grimper une plante, cette dernière augmentera la prise au vent : il faudra donc faire cela uniquement sur des arbres solides ou qui sont éloignés de toute habitation ou zone de danger !
Si jamais votre arbre mort représente un trop grand risque pour être laissé sur pied, il faudra l’abattre (en étant prudent aussi !). Mais on pourra quand même lui trouver une utilité ! Tout d’abord, bien sûr, comme bois de chauffage ou pour le barbecue.
On pourra aussi faire des tas de bois avec les branches dans le jardin, pour rendre son jardin insecte-friendly (on vous en dit plus à ce sujet ici). Ces tas de bois serviront aussi d’abris à des petits mammifères et autres organismes.
On pourra récupérer le bois pour fabriquer diverses choses, comme des objets de décoration (par exemple, un arbre de noël eco-friendly, un porte bijoux, un porte manteau, une lampe...internet regorge d’idées !), des meubles ou encore un salon de jardin en tronc d’arbre.
Au potager, on pourra enterrer des morceaux de bois pour aider à favoriser la vie dans le sol et/ou à restaurer la qualité du sol. Broyé, il servira de paillage à nos plantations. En permaculture, on pourra l’utiliser au sein d’une butte dans laquelle il servira à retenir l’eau et à enrichir le sol en se décomposant. On pourra aussi utiliser les branches comme tuteurs.
Au compost, ajouté tel quel entre les couches ou bien en copeaux, il permettra d’aérer et de favoriser l’oxygénation.

En conclusion, voyez le bois mort comme une ressource et non un déchet !
Agir pour la nature au jardin. David Melbeck, Sylvain Leparoux. Editions La Salamandre – Les guides pratiques. (ISBN: 9782889584000)
L’Oasis. Simon Hureau. DARGAUD Editions. (ISBN-13 978-2205085808)
[1] den Ouden et al. (2005) Jays, Mice and Oaks: Predation and Dispersal of Quercus robur and Q. petraea in North-western Europe in Seed fate: predation, dispersal and seedling establishment. Forget, Lambert Hulme & Vander Wall (Eds.). pp. 223-239.
Ressources communes pour les différentes espèces d'arbres : Tela Botanica , aujardin.info , Wikipedia , ONF , IUCN red list of species , Inventaire national du patrimoine naturel - Muséum d’Histoire Naturelle, Bmédia, Biologie et Multimédia - Sorbonne Université - UFR des Sciences de la Vie, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, Institut National de l’information géographique et forestière
http://nature.jardin.free.fr/arbre/ft_carpinus_be.html
De prime abord, les sciences paraissent compliquées à aborder (même pour les initié·e·s [1]). Il faut maîtriser un jargon bien particulier, connaître des méthodes de recherche spécifiques et utiliser des outils mathématiques pour analyser les résultats d’expérience.
Mais au fond, le but de la science, c’est de comprendre le monde dans lequel on vit. Et vouloir comprendre, ce n’est pas seulement “un truc de scientifique” ! Par ailleurs, les citoyens et les décideurs politiques ont besoin d’être informés des résultats scientifiques récents pour décider des politiques publiques. Comme par exemple, pour la mise en place ou non d’une aire protégée. Une solution pour mieux comprendre comment fonctionne la science, c’est par exemple de s’impliquer dans un projet de recherche en tant que citoyen grâce aux sciences participatives.
Dans cet article, nous vous proposons d’abord une petite définition de ce que sont les sciences participatives. Puis nous verrons ce que cette démarche apporte à la science et aux participants à travers la présentation de 3 projets de sciences participatives. Nous vous donnerons aussi une sélection de projets pour vous aider à vous impliquer. Enfin, nous ferons le bilan des sciences participatives et nous reviendrons sur quelques critiques qui leurs sont faites.
L’expression “sciences participatives” (ou “recherche participative”) comprend deux notions. D’abord, il y a l’idée de “science”, et ensuite il y a l’idée de “participer”. Pour définir les sciences participatives, il faut d’abord comprendre ce que sont les sciences et comment on peut y participer.
Les sciences, dans ce cadre, désignent plus précisément la recherche scientifique, c’est-à-dire l’activité de production des connaissances scientifiques. D’après cet article [2], on définit les connaissances comme scientifiques quand elles sont produites avec une méthode rationnelle (par exemple avec une expérimentation et une analyse statistique) et revues par les pairs (c’est-à-dire que d’autres scientifiques spécialistes du sujet vérifient la démarche et les conclusions de la recherche).
La participation sous-entend que plusieurs acteurs, pas seulement des scientifiques de métier, vont prendre part à la recherche. Il y a plusieurs formes de participation, plus ou moins impliquées. Les citoyens peuvent participer à la collecte des données de façon passive, ou bien à l’analyse, ou encore à la co-construction du thème de recherche [3].
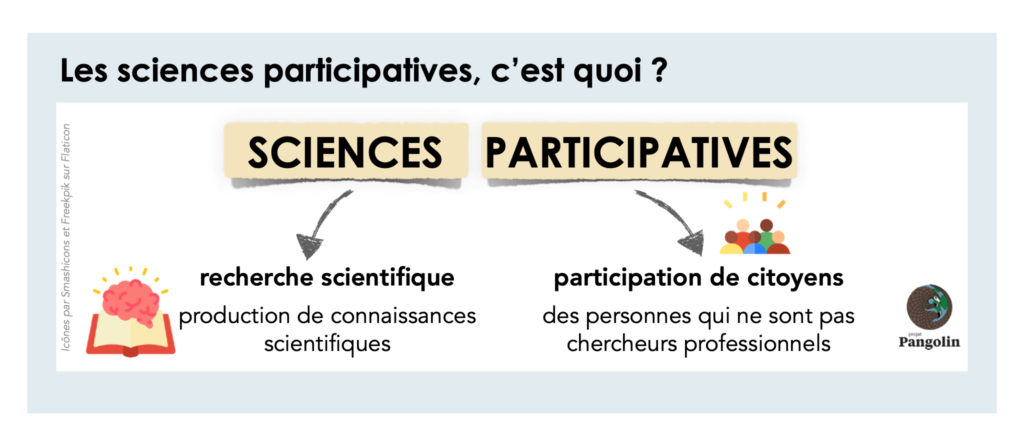
Ces deux dimensions de recherche et d’implication des citoyens sont essentielles pour définir une recherche participative. Ainsi, la démocratie participative ne constitue pas une démarche de science participative, car elle ne produit pas de connaissances scientifiques. Par ailleurs, un projet de recherche participative nécessite la participation active des citoyens. Une étude de médecine où des personnes se portent volontaires pour tester un médicament n’est pas de la recherche participative.
Bon, maintenant qu’on a une définition, il est temps de donner quelques exemples de recherches participatives pour se faire une meilleure idée de ce que c’est concrètement.
Les sciences participatives permettent de répondre à des questions auxquelles les scientifiques ne pourraient pas répondre seuls. En effet, la participation des citoyens peut permettre de récolter des données en plus grand nombre ou encore aider à l’analyse de données.
Les sciences participatives peuvent prendre des formes extrêmement différentes. Pour vous donner une idée de leur diversité, nous allons vous présenter 3 exemples.
Nestwatch [4] est un projet de science participative initié par le Cornell Lab of Ornithology aux États-Unis. Le but est de mesurer le succès des nichées d’oiseaux pour plusieurs espèces d’Amérique du Nord.
Pour cela, les observateurs bénévoles doivent repérer un nid et le suivre de la ponte à l’envol des petits. Ils doivent faire des relevés réguliers pour documenter l’état du nid (œufs pondus, nichée éclose, nid abandonné...). Ce type de projet, dans lequel les volontaires récoltent des données qui vont ensuite être analysées par les chercheur·euses, est appelé crowdsourcing.
Le crowdsourcing est particulièrement utile pour récolter une grande quantité de données grâce aux volontaires. Pour le projet Nestwatch, les organisateurs affirment que “sans l’aide des volontaires, il serait impossible de récolter assez d’informations pour surveiller les oiseaux nicheurs dans tout le pays [les États-Unis]” [4].
Pour les observateurs, Nestwatch permet de valoriser des observations personnelles et de les inscrire dans le cadre de la recherche scientifique. De plus, Le Cornell Lab met à disposition des bénévoles des guides d’identification des nids et des oiseaux ou encore des informations sur la biologie des oiseaux. Cela permet aux novices d’acquérir de nouvelles connaissances.
Nestwatch a été initié dans les années 1960 et continue encore aujourd’hui. Les données ainsi récoltées sur plus de 50 ans permettent d’obtenir un suivi temporel du succès reproducteur des oiseaux nicheurs. Ces informations sont très précieuses pour mesurer, par exemple, l’impact du changement climatique.
Aujourd'hui pour partager des observations sur Nestwatch, tout se fait en ligne. Mais dans les années 60, les observateurs envoyaient les formulaires au laboratoire par courrier ! Cela a donné naissance à un 2ème promet de sciences participatives : Nest Quest Go! Le but est de retranscrire ces données écrites à la main.
Foldit [5, 6] est un programme développé en 2010 par un ensemble de chercheurs·euses qui permet aux citoyens de prévoir la structure selon laquelle une protéine se replie dans l’espace. C’est un jeu sérieux ou serious game. Un logiciel présente une protéine aux joueurs, et le but est de gagner des points en bougeant la protéine pour obtenir la structure la plus stable possible.
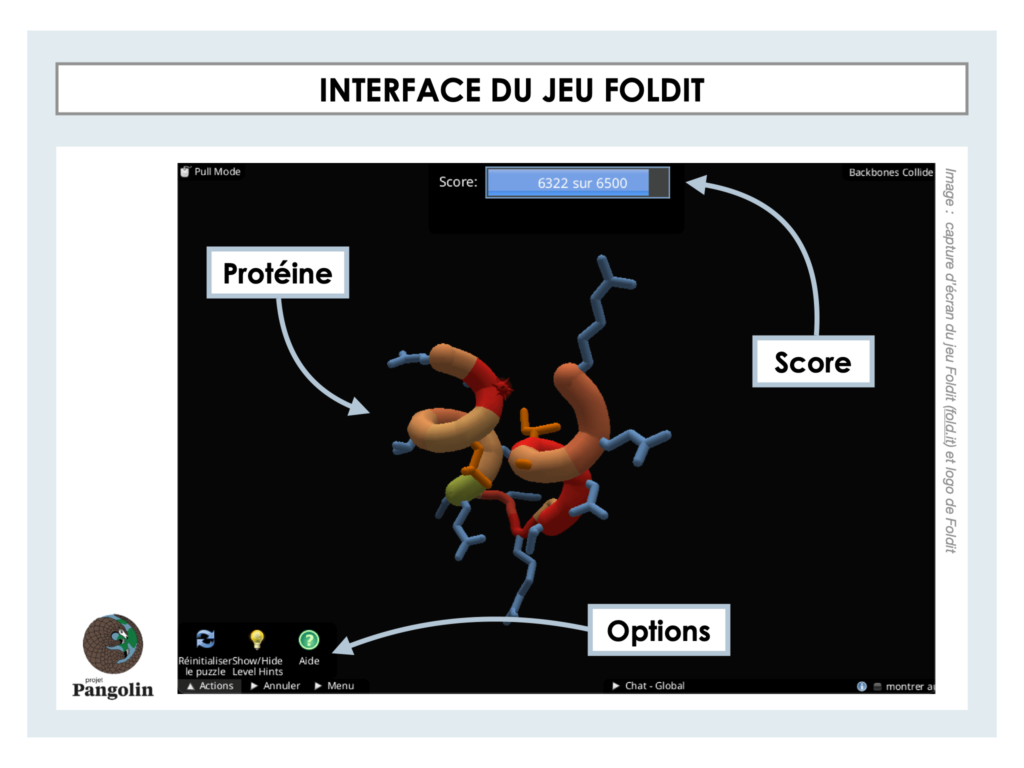
La théorie de la chimie devrait permettre de trouver la structure la plus stable (certains atomes doivent être loin ou proches les uns des autres). Il existe d’ailleurs des algorithmes basés sur cette théorie pour déterminer la structure des protéines. Cependant, ce problème est impossible à résoudre de façon exacte. En effet, cela prendrait beaucoup trop de temps de tester toutes les structures possibles, même pour un ordinateur ! On estime que cela prendrait plus de temps que l’âge de l’Univers pour énumérer toutes les structures possibles pour une protéine de taille classique [7] ! Les algorithmes classiques ne testent donc pas toutes les structures, mais cherchent les structures les plus stables à partir de structures de départ choisies au hasard. Dans Foldit, le rôle des joueurs est de bouger les différentes parties de la protéine manuellement, remplaçant ainsi les algorithmes.
Alors, comment des citoyens peuvent-ils résoudre un problème que les algorithmes peinent à résoudre ? Et bien les algorithmes classiques se “découragent” trop vite. C’est-à-dire que s’ils tombent sur une configuration trop instable pour la protéine, ils ne continuent pas dans cette voie et ils abandonnent [6].
Les humains, eux, à force d’entraînement, sont capables de voir plus loin que l’état présent de la protéine. En persévérant dans une voie qu’auraient abandonné les algorithmes, les participants dénichent des structures plus optimales que celles prédites par ordinateur ! De plus, en faisant collaborer des milliers de joueurs entre eux, ceux-ci s’échangent des astuces et collaborent pour obtenir la meilleure structure.
Le type de recherche participative utilisé dans Foldit est appelée intelligence distribuée. Cela consiste à engager les capacités de réflexion des participants pour répondre à un problème (ici, prévoir la façon dont une protéine se replie dans l’espace).
Mais qu’est-ce qui motive les joueurs à participer ? Deux raisons majeures : d’une part, le fait de contribuer à la science, et d’autre part, le jeu en lui-même, à travers l’intérêt propre de la tâche mais aussi la motivation d’obtenir le meilleur score [6].
Le Groupe Alcool de l’INSERM [8], fondé en 2006, est composé de chercheur·euses en addictologie et d’associations de soutien aux personnes en difficulté avec l’alcool.
Un des projets concrets menés par ce groupe est une étude sur le maintien de l’abstinence de 145 personnes participant à des groupes de parole sur l’alcool [9]. Pour cette étude, la consommation d’alcool des participants a été suivie pendant un an grâce à des questionnaires. L’influence de plusieurs facteurs sur la consommation d’alcool a été testée, comme leur sexe ou le fait d’avoir une aide médicale.
Cette étude a été pensée par les chercheur·euses et 6 associations qui ont participé ensemble à la définition des questionnaires et à leur recueil. Ce projet constitue un exemple de recherche communautaire. Les scientifiques et les groupes directement concernés par la recherche ont participé ensemble à la conception de l’étude.
La recherche communautaire a pour but de produire de la connaissance scientifique, mais aussi d’apporter des réponses ou des solutions à la communauté en question. Elle est particulièrement développée en médecine. De nombreux autres projets communautaires impliquent des associations de malades et chercheurs·euses (par exemple dans le domaine du SIDA et des maladies rares), dans l’espoir d’apporter des solutions aux malades.
Dans ce projet, l’aide des associations a permis aux chercheurs·euses de recruter les participant·e·s, mais aussi de bénéficier des connaissances de terrain des associations pour orienter leurs questions de recherche. Pour les associations, collaborer avec la recherche leur permet d’évaluer l’aide apportée aux participants avec une rigueur scientifique, pour pouvoir valider ou améliorer leur soutien [10]. Dans une société où l’addiction à l’alcool est stigmatisée et vue comme une faiblesse de volonté (alors que les recherches récentes montrent que l’addiction est une véritable maladie [11]), il est d’autant plus important d'aborder la question avec une démarche scientifique et sans jugement moral.
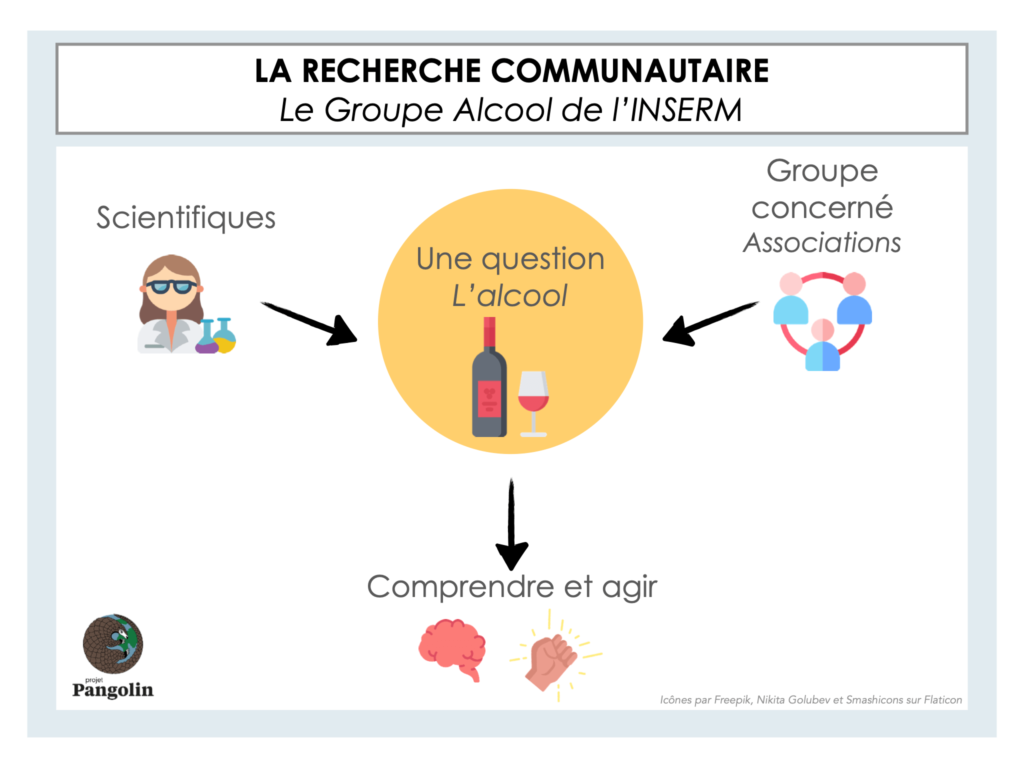
À travers ces 3 exemples, nous avons un aperçu de la diversité des projets de sciences participatives : Nestwatch engage les participant·e·s dans la récolte de données, tandis que Foldit leur permet de participer à l’analyse de données. Enfin, le Groupe Alcool permet de participer à la définition même de la question et des méthodes de recherche.
Ces 3 projets utilisent également une diversité de moyens pour engager les participants (observation naturaliste, jeu ou co-construction de la recherche). Enfin, ils concernent des champs disciplinaires variés : l'écologie, la chimie et les sciences sociales.
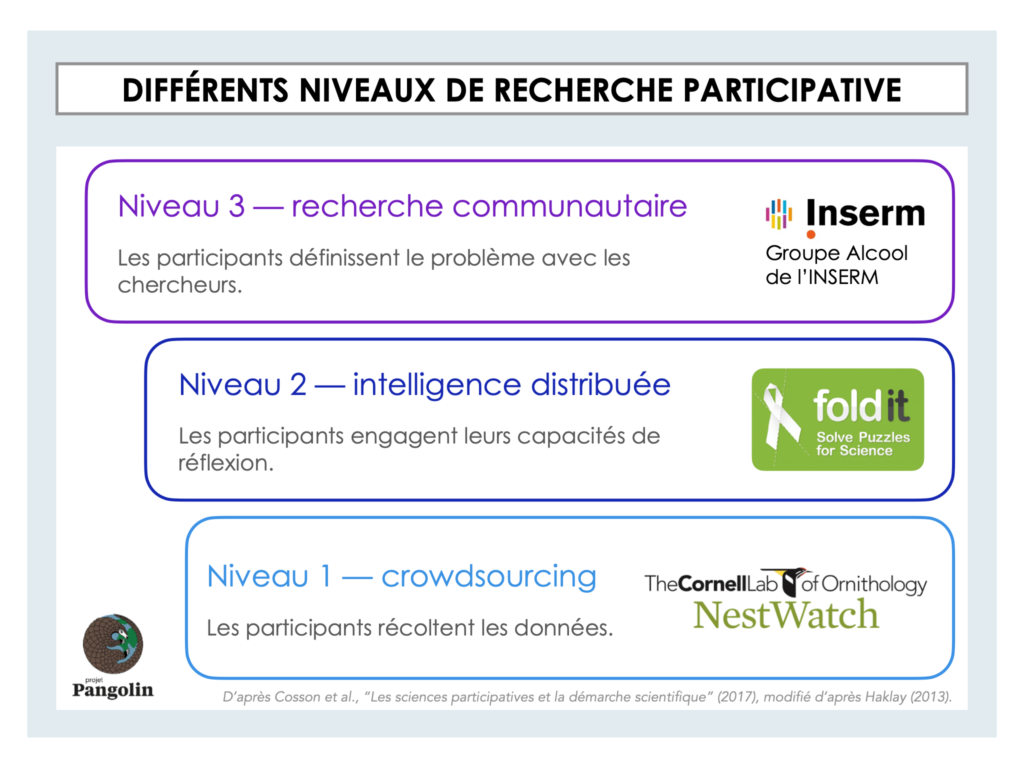
Alors peut-être que ces 3 exemples vous donnent envie de vous lancer dans un projet de recherche participative ? Ça tombe bien, on vous propose plusieurs projets à tester juste après !
Comme on vient de le voir, les projets de recherche participative sont extrêmement variés . Ils concernent de nombreuses disciplines, et il y a plein de façons de participer. Il y en a donc pour tous les goûts ! Voici une liste non-exhaustive de projets auxquels vous pouvez participer.
On part d’abord en immersion dans votre jardin (ou sur votre balcon pour les citadins !) avec l’observatoire de la biodiversité des jardins et leur programme “Opération Papillons”. Le programme est mené en collaboration avec les scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. C’est l’un des premiers organismes scientifiques à avoir lancé un projet de sciences participatives en France, c’était en 2006. “Opération Papillons” a pour objectif d’évaluer sur le long terme l’impact des activités humaines (agriculture, urbanisation) sur les espèces de papillons présentes en France.
Le programme vous propose à n’importe quel moment de l’année de compter les papillons que vous observez dans votre jardin ou sur votre balcon. Il vous faudra identifier les espèces et reporter à la fin de la semaine vos observations sur leur page dédiée. Des fiches d’identification sont à disposition
🚨 Spoiler alert : l’observatoire des jardins a mis en place un protocole similaire avec les espèces de pollinisateurs !
Pour vous donner une idée, l’opération papillons compte depuis son lancement 12 000 jardins participants et plus de 1 500 000 papillons y ont été comptés ! Les chercheur·euses du Muséum National d’Histoire Naturelle ont produit pas moins de 7 publications scientifiques grâce aux données récoltées ! Ils ont pu, par exemple, évaluer les impacts des pesticides et de l’urbanisation sur la biodiversité des jardins.

Envie de de participer ? Retrouvez toutes les informations sur l’opération papillons ici. Et si vous cherchez d'autres projets de sciences participatives en lien avec la biodiversité et l’environnement, beaucoup sont répertoriés sur le portail OPEN.
Les sciences participatives peuvent s'appliquer à tous les domaines de recherche scientifique et l'étude du français ne fait pas exception ! En effet, voici un exemple en linguistique cette fois-ci. Le projet “Français de nos régions” a pour objectif de “documenter la variation du français que l’on parle dans le monde sous l’angle de la géographie linguistique”. Les seules conditions pour participer à ce projet sont de parler français et d’avoir 10 minutes de temps libre. Il faudra répondre à un questionnaire sur les expressions/mots que vous utilisez dans votre langage courant et qui peuvent varier selon les régions. On peut vous demander par exemple, comment vous appelez une certaine viennoiserie au chocolat...
Les questions sont adaptées à la région du monde où vous avez passé la plus grande partie de votre jeunesse. Les questionnaires sont renouvelés tous les ans et sont analysés par des chercheur·euses en linguistique belges, français et suisses. Il est fort probable que vous ayez vu les résultats de certaines enquêtes passer sur les réseaux sociaux !
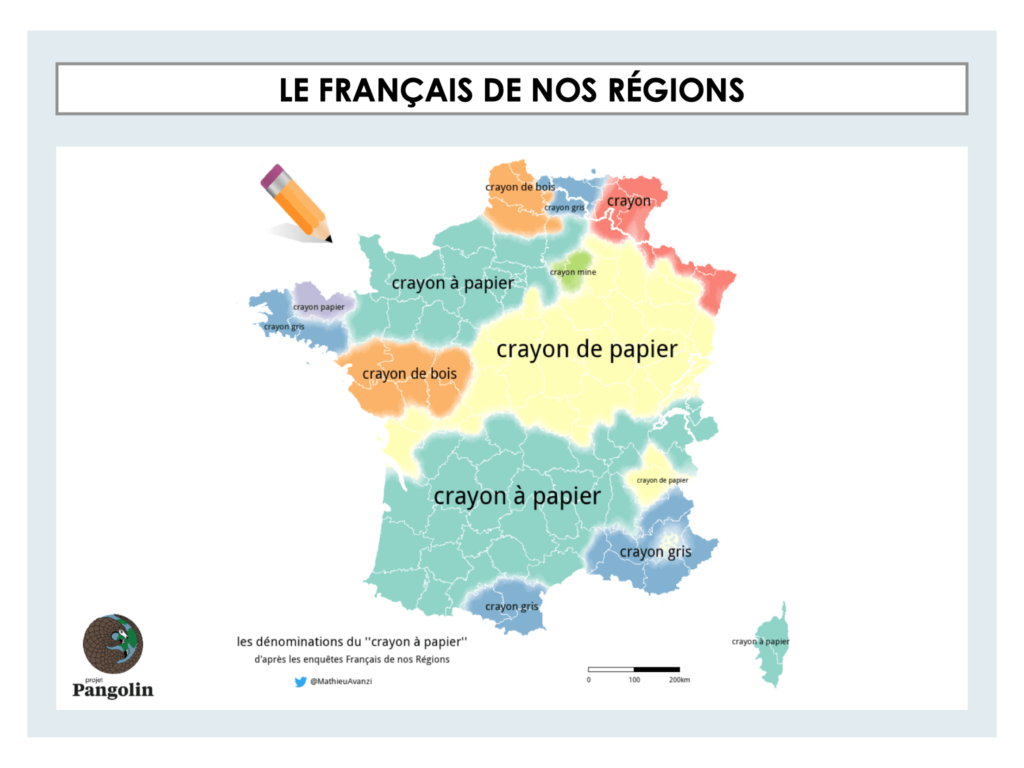
Maintenant vous savez d’où elles viennent ! Pour participez aux enquêtes, c'est par ici.
Encore un autre exemple qui implique la langue française. ZombiLUDik et Zombilinguo sont des jeux en ligne créés par des scientifiques de l’université de la Sorbonne afin d’améliorer les outils de traitement automatique des langues. Mais qu’est-ce que le traitement automatique des langues (TAL) ? Et bien c’est très simple Jamy ! Le TAL est un domaine multidisciplinaire de la recherche scientifique regroupant la linguistique, l’informatique et l’intelligence artificielle. Parmi les applications les plus récentes du TAL, on retrouve les intelligences artificielles utilisées dans nos smartphones, comme Siri par exemple. Ainsi, le but du jeu en ligne est d’améliorer le langage naturel de ces intelligences artificielles afin que leurs réponses semblent moins robotiques et qu’elles comprennent plus efficacement nos requêtes.
Si vous souhaitez tester vos connaissances en grammaire, ce jeu est fait pour vous ! Vous pouvez participer n’importe quand et pour la durée que vous souhaitez. Retrouvez toutes les informations ici.
Il existe énormément d’autres projets de sciences participatives et une grande majorité sont référencés sur les sites Science Ensemble pour les projets francophones et Zooniverse pour les projets internationaux.
Comme on l’a vu avec les nombreux exemples ci-dessus, les sciences participatives apportent de vrais avantages dans certains domaines de recherche. C’est le cas avec l’écologie et la biologie de la conservation, où la récolte d’aussi grands jeux de données aurait été bien plus longue, difficile et couteuse à mettre en place sans les sciences participatives. Cela permet aussi de démystifier la recherche scientifique, et surtout d’impliquer les citoyens dans la protection de la biodiversité. C’est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène médiatique. Les sciences participatives sont une solution concrète pour les citoyens qui souhaitent œuvrer à la protection de la biodiversité sans dépenser leur argent, mais en offrant un peu de leur temps. Et oui, tout le monde ne peut malheureusement pas créer une fondation comme celle de Leonardo DiCaprio !
On l’a vu, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les sciences participatives peuvent intervenir (médecine, linguistique, astronomie, chimie, écologie...), mais est-ce généralisable à tous les champs de la recherche scientifique ? Cela dépend en fait des recherches menées et de la question posée plus que du champ disciplinaire. Parfois, il n’est possible de produire des résultats qu’en passant par des expérimentations, observations et/ou calculs pour lesquels impliquer des citoyens ne serait pas possible ni vraiment utile. C’est le cas avec l’accélérateur de particule du CERN par exemple : l'implication des citoyens dans la production de données et de résultats n’apporterait pas de plus-value dans la recherche sur le Boson de Higgs. Mais il est tout à fait possible d’impliquer les non-scientifiques dans des domaines qui semblent à première vue très complexes, comme l’astronomie. Le programme Galaxy Zoo a carrément permis de découvrir des galaxies grâce à l’aide des citoyens !

Une partie de la communauté scientifique pointe souvent du doigt le manque d’expertise des citoyens pouvant générer des biais importants dans les résultats obtenus. En effet, lorsque que la collecte de données est réalisée par le grand public, on s’attend à retrouver plus d’erreurs dues à leur manque d’expérience (se tromper dans l’identification d’une espèce par exemple). Certaines de ces erreurs sont aisément détectables et sont directement corrigées par les scientifiques. Les autres, ont représenté un challenge pour les chercheur·euses pendant de nombreuses années. Mais la science évolue et s’adapte pour tirer avantage des nouvelles opportunités ! Ainsi, de nouveaux outils mathématiques ont été développé pour répondre à ces questions spécifiques et prendre en compte les biais associés à la participation citoyenne.
Ainsi, grâce à une méthodologie rigoureuse de la collecte de données et des analyses statistiques adaptées, les projets ne sont plus réservés aux ultra-connaisseurs mais accessibles à tous !
Un rapport sur les sciences participatives en France publié en 2016 [2] met en garde sur les dérives qu’elles peuvent impliquer. Comme par exemple la mauvaise reconnaissance de tous les acteurs impliqués dans les travaux de science participatives et leur intégration dans les processus de décision. Même si aujourd’hui une forme d’élitisme entoure la profession de scientifique, qui semble être inaccessible, il est bon de garder à l’esprit que cet élitisme ne remonte à pas si longtemps.
En effet, la professionnalisation de la recherche date du 19e siècle. Des grands noms des sciences comme Darwin ou Newton n’étaient pas des scientifiques de métier, mais simplement des “amateurs éclairés”. La science a bien changé entre hier et aujourd’hui. L’accumulation des connaissances scientifiques au cours du temps a notamment rendu des études poussées nécessaires pour maîtriser ces connaissances. Cela a creusé un fossé entre les scientifiques et le reste de la société [12].
Cependant, comme on l’a vu tout au long de cet article, cela ne veut pas dire que des citoyens qui en ont envie ne peuvent pas s’impliquer dans la recherche, bien au contraire ! Par ailleurs, même si les sciences participatives sont par définition ouvertes à tous, dans les faits, la population qui participe est majoritairement constituée “d’hommes, bien éduqués et situés dans les classes de revenus les plus élevées” [3]. Pourtant tout le monde peut participer : alors n’hésitez plus et lancez-vous !
Pour conclure, les sciences participatives nécessitent de nombreuses précautions pour délivrer des résultats fiables et respecter tous les acteurs. Mais elles présentent de très nombreux bénéfices, ont permis de belles avancées et promettent encore de très beaux résultats ! Alors quel que soit votre niveau d’éducation, âge, genre n’hésitez pas à vous lancer : les scientifiques n’attendent que vous !
[1] Langin, K. (2021, April 6). Want other scientists to cite you? Drop the jargon. Science. https://www.sciencemag.org/careers/2021/04/want-other-scientists-cite-you-drop-jargon
[2] Houllier, F., & Merilhou-Goudard, J.-B. (2016). Les sciences participatives en France (p. 63 p.) [Autre]. https://doi.org/10.15454/1.4606201248693647E12
[3] Haklay, M. (2013). Citizen Science and Volunteered Geographic Information: Overview and Typology of Participation. In D. Sui, S. Elwood, & M. Goodchild (Eds.), Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice (pp. 105–122). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4587-2_7
[4] Cornell University. (2021). Overview. NestWatch. https://nestwatch.org/about/overview/
[5] University of Washington Center for Game Science, University of Washington Institute for Protein Design, Northeastern University, Vanderbilt University Meiler Lab, & University of California, Davis. (n.d.). Solve Puzzles for Science | Foldit. Foldit. Consulté le 16 juin 2021. Accessible sur : http://fold.it/
[6] Cooper, S., Khatib, F., Treuille, A., Barbero, J., Lee, J., Beenen, M., Leaver-Fay, A., Baker, D., Popović, Z., & Players, F. (2010). Predicting protein structures with a multiplayer online game. Nature, 466(7307), 756–760. https://doi.org/10.1038/nature09304
[7] Levinthal, C. (1969). How to Fold Graciously. Mossbauer Spectroscopy in Biological Systems, Monticello, Illinois. https://web.archive.org/web/20110523080407/http://www-miller.ch.cam.ac.uk/levinthal/levinthal.html
[8] INSERM. (n.d.). Groupe de travail Alcool. Inserm - La science pour la santé. Consulté le 16 juin 2021. Accessible sur : https://www.inserm.fr/associations-malades/participer-groupe-travail/groupe-travail-alcool
[9] Nalpas, B., Boulze-Launay, I., & the Inserm Alcohol Group. (2018). Maintenance of Abstinence in Self-Help Groups. Alcohol and Alcoholism, 53(1), 89–94. https://doi.org/10.1093/alcalc/agx085
[10] Canal Academies. (2018, February 7). Malades, usagers et acteurs de la recherche participative. https://www.youtube.com/watch?v=xbTIAeHXuhw&t=1769s
[11] Scilabus. (2021). Pourquoi “demain, j’arrête” ne marche pas ? #addiction. https://www.youtube.com/watch?v=kRc45ySGUaE
[12] Cosson, J.-F., Roturier, C., Desclaux, D., & Frey-Klett, P. (2017). Les sciences participatives et la démarche scientifique. The Conversation. http://theconversation.com/les-sciences-participatives-et-la-demarche-scientifique-85198
[13] Giarraffa, Y., Dozières, A., & Daubercies, A. (n.d.). Sciences participatives au jardin. Consulté le 27 juin 2021. Accessible sur : https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/edito/papillons
Au visionnage d’un documentaire animalier ou tout simplement au détour d’une promenade en forêt, vous avez sûrement déjà rencontré un animal aux caractéristiques extravagantes. Tellement extravagantes que c’est à se demander si cela ne va pas à l’encontre de la sélection naturelle. Prenez par exemple l’encombrante queue du paon, les immenses voiles des combattants ou bien les impressionnants bois des cerfs. Ce sont de belles ornementations, effectivement, mais aussi très embarrassantes pour se déplacer et très visibles par les prédateurs ! Une question se pose alors : comment de telles caractéristiques peuvent-elles être sélectionnées alors qu'elles semblent impacter négativement la survie des individus qui les portent ?
La réponse se cache dans un concept que je m’apprête à vous présenter : la sélection sexuelle. Dans la suite de cet article, nous nous demanderons pour quelles raisons dans la grande majorité des espèces, ce sont les femelles qui choisissent les mâles et comment elles les choisissent.
Puis, nous entrerons dans l’intimité d’autres animaux non-humains pour comprendre quelques stratégies sont sélectionnées au cours de l’évolution pour persuader les femelles de s’accoupler. Nous verrons ainsi que dans le monde animal il existe des tricheurs et que parfois la force et la beauté ne font pas le poids face à certains petits malins !
Ce qu’on retient du concept de sélection naturelle élaboré par Darwin et Wallace (plus de détails dans notre article à ce sujet), est que les individus possédant les caractéristiques les plus adaptatives, survivent mieux, se reproduisent mieux et donc sont sélectionnés de générations en générations. Seulement, si vous êtes un.e observateur.ice de la nature, vous devriez détecter une incohérence dans toutes ces histoires… En effet, lorsque l’on regarde attentivement le monde animal on s’aperçoit que les mâles et les femelles ont parfois des phénotypes différents. Les mâles sont souvent plus colorés ou dotés d'ornements voyants. Les femelles possèdent, en général, des attributs plus discrets. Au regard de la théorie de la sélection naturelle, il semble contre-intuitif que des individus soient sélectionnés alors qu’ils arborent des pelages multicolores qui les rendent plus visibles pour les prédateurs et les encombrent fortement.
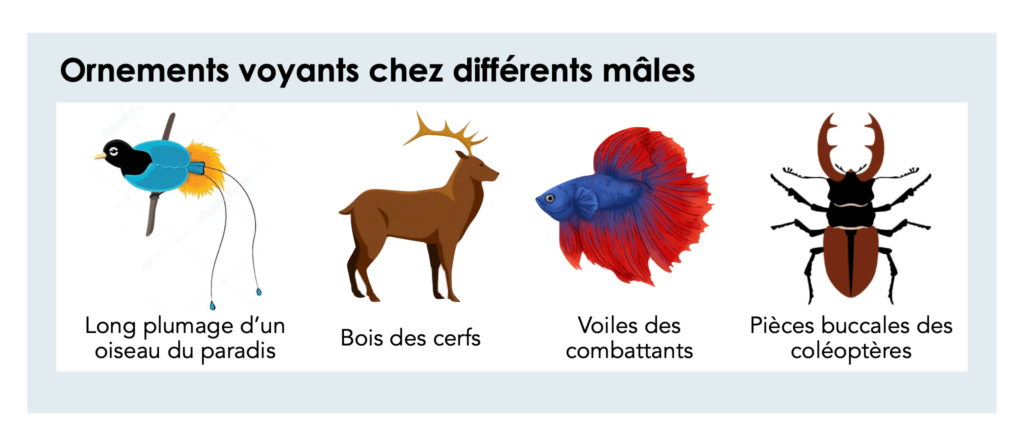
Mais alors, Darwin et Wallace se seraient-ils trompés ? À quoi bon favoriser des caractéristiques si handicapantes qui augmentent la probabilité de mourir ? Et bien la réponse réside tout simplement en une phrase : pour avoir accès à la reproduction !
Tous deux savaient que l'on ne pouvait s'attendre à ce que la sélection naturelle favorise l'évolution de traits désavantageux. Bien qu’ils eussent des idées divergentes à ce sujet ils ont quand même pu offrir une solution à ce problème : la sélection sexuelle. Ainsi dans son livre « The descent of man and selection in relation to sex »[1] paru en 1874, Darwin propose un nouveau processus évolutif différent de la sélection naturelle. Ce processus ne dépend pas d’une lutte pour l’existence par rapport à d’autres organismes ou à des conditions environnementales, mais d’une lutte entre les individus d’un sexe, pour la possession de l’autre sexe.
La sélection sexuelle est une théorie selon laquelle l'évolution de certains traits physiques remarquables tels qu'une coloration prononcée, une taille accrue ou des ornements frappants chez les animaux peut permettre à ceux qui les possèdent d'obtenir plus facilement des partenaires.
Mais pourquoi, dans la majorité des cas, ce sont les mâles qui se retrouvent parés d’ornements supplémentaires ?!
La théorie la plus répandue pour expliquer ce phénomène est l’anisogamie. « Anisos » signifie non-égal et « gamos » veut dire mariage. Ainsi, l’anisogamie désigne une forme de fécondation dans laquelle les gamètes des deux sexes diffèrent, notamment par la taille.
Les gamètes mâles (spermatozoïdes) sont beaucoup plus petits que les gamètes femelles (ovocytes). Chez les humains, un ovocyte mesure environ 120µm alors qu’un spermatozoïde mesure environ 50µm. De plus, il existe une différence de coût de production importante entre la production d’un gamète mâle et celle d’un gamète femelle. Les ovocytes vivent plus longtemps et contiennent des ressources nutritives, ils sont plus « chers » (métaboliquement) à fabriquer.
L’idée principale de cette théorie est que les mâles produisent des gamètes plus nombreux et peu coûteux. Les femelles n’en possèdent qu’un stock limité et précieux. De ce déséquilibre va découler un conflit sexuel. Les femelles ont intérêt à choisir avec attention un mâle alors que les mâles ont tout intérêt à féconder le plus de femelles possibles.
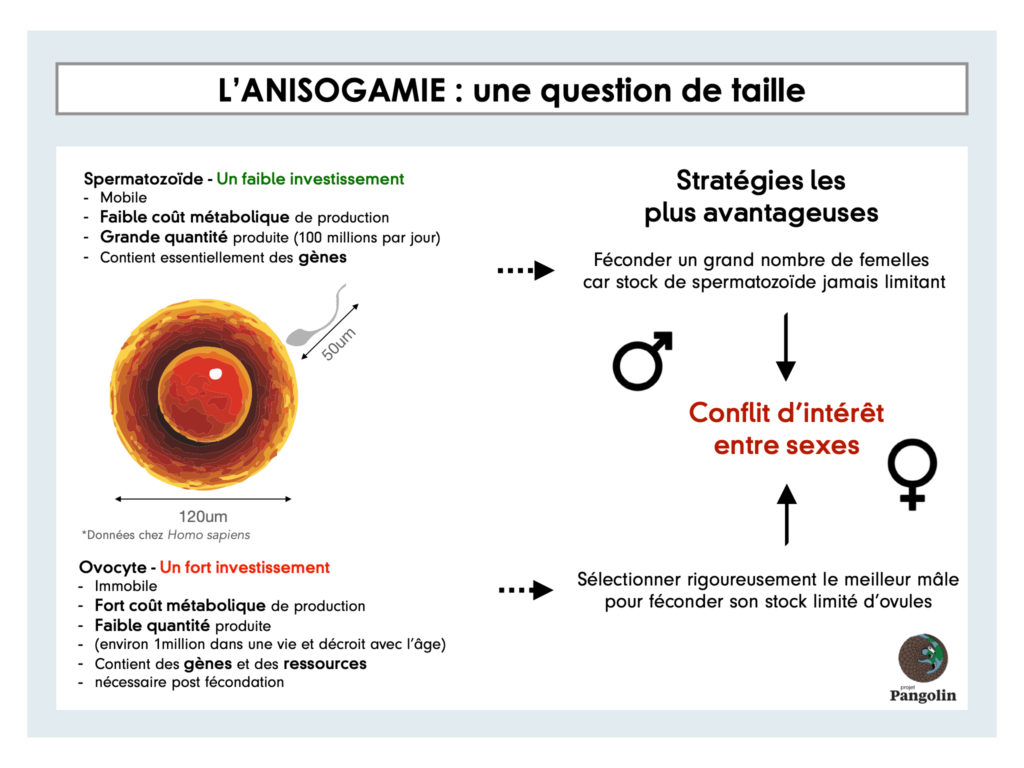
Au fil de l’évolution, cette guerre des sexes a mis les mâles en compétition entre eux pour accéder à une quantité de gamètes femelles limitée et ainsi s’accaparer la paternité tant espérée.
NB : il est intéressant de se demander comment l’anisogamie a émergé. Mais aussi pourquoi il existe des sexes différenciés. L’une des réponses réside dans le fait que cela permet d’éviter l’autofécondation. Si cela vous intéresse je vous invite à lire cet article en français qui porte sur le sujet.
Si les objectifs des mâles sont clairs. Ils ont besoin des femelles pour s'assurer une descendance et sont en compétition pour y accéder. Qu'est-ce que les femelles y gagnent et pourquoi choisir un critère plutôt qu’un autre ?
Dans certains cas c’est assez limpide. Si on prend pour exemple une femelle gorille qui aurait le choix entre un gorille gringalet et de faible rang social ou un gorille dominant et musclé, on s’imagine assez facilement pourquoi elle choisirait le gorille dominant. En effet, ce mâle a probablement accès à plus de nourriture et peut protéger son territoire. La femelle y gagne de la sécurité physique et alimentaire. Maintenant, si on prend l’exemple du paon, il est un peu moins intuitif de comprendre pourquoi les femelles préfèrent les mâles qui font le mieux la roue.
Le choix des femelles repose sur deux grandes catégories de critères : les avantages directs et indirects.
Un avantage direct va être immédiatement identifiable par la femelle et augmenter instantanément sa fécondité ou de sa durée de vie. Par exemple, les femelles peuvent obtenir : un meilleur accès à la nourriture, une protection contre les mâles qui les harcèlent ou une aide pour élever leur progéniture, ou encore éviter d'être infectées par des parasites (ou d'autres maladies) en choisissant des mâles en bonne santé.
Les avantages directs peuvent être de différentes natures. Certaines espèces offrent des cadeaux nuptiaux qui sont en général de la nourriture. On retrouve ce comportement chez une grande diversité d’organismes comme les oiseaux, les insectes et les araignées. Parfois il existe une corrélation positive entre la taille de l’offrande et le temps de copulation autorisé par la femelle. Ainsi si le mâle fournit une grosse proie à la femelle cela lui permettra de transférer plus de spermatozoïdes [3,4]. Chez d’autres espèces comme la Veuve noire à dos rouge, les mâles s’offrent eux-mêmes comme cadeau nuptial en se laissant dévorer [5].
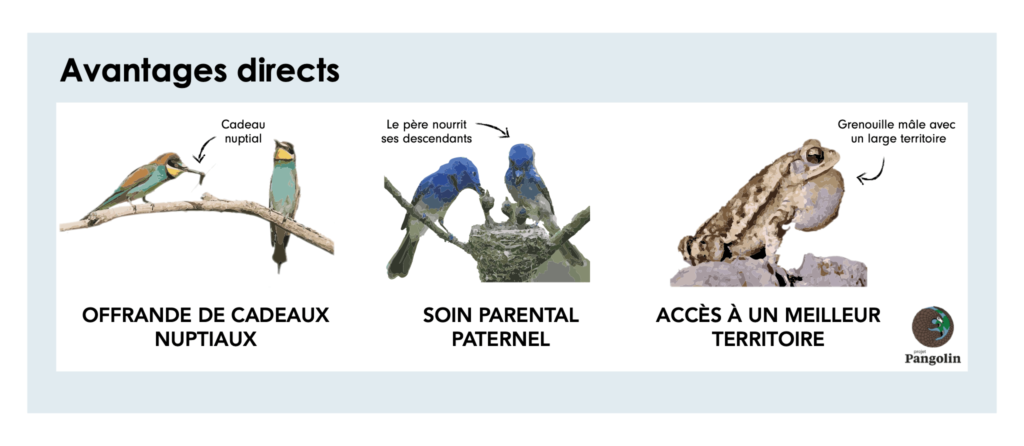
Un autre avantage direct et qui paraît évident est de choisir un partenaire sexuel qui participera à l’élevage des jeunes pour certaines espèces. Les femelles choisiront un bon père pour les aider à construire un nid et à nourrir les petits. Ces comportements sont observés chez de nombreuses espèces d’oiseaux mais aussi chez les souris.
Un dernier exemple est retrouvé chez les grenouilles taureau. Les femelles vont préférer des mâles avec le « meilleur » territoire. Les œufs seront ainsi protégés des prédateurs pendant leur développement.
Un avantage indirect va, cette fois-ci, être moins évident pour la femelle et peut être interprété comme un pari. La femelle va devoir détecter si un mâle est un bon partenaire à partir d’indices plus ou moins clairs (pour nos yeux d’humains). Si sa mise est gagnante alors la femelle produira des descendants en bonne santé et capables à leur tour de produire de nombreux descendants, augmentant alors indirectement le succès reproducteur de la femelle.
Pour faire son choix, la femelle va se baser sur des signaux particuliers qui seront interprétés comme des indicateurs de qualité. Souvent ce sont des traits physiques exagérés qui ont été sélectionnés chez les mâles au fil de l’évolution. Ils sont appelés caractères sexuels secondaires. Deux théories complémentaires permettent d’expliquer l’apparition de ces drôles de caractéristiques.
La théorie de l’emballement de Fisher propose qu’au fil des générations, un trait non-adaptatif, visible et garant d’une bonne qualité va être sélectionné par les femelles. S’en suivra alors un mécanisme de boucle de rétroaction positive. Les femelles sont de plus en plus intéressées par cette caractéristique alors la sélection sexuelle va favoriser son augmentation.
Par exemple les femelles se verront choisir les mâles avec les plus longs plumages car leurs descendants hériteront aussi d’un long plumage et seront à leur tour choisit par les femelles de la génération suivante, maximisant alors leurs probabilités de dispersion de gènes (Fisher 1930).
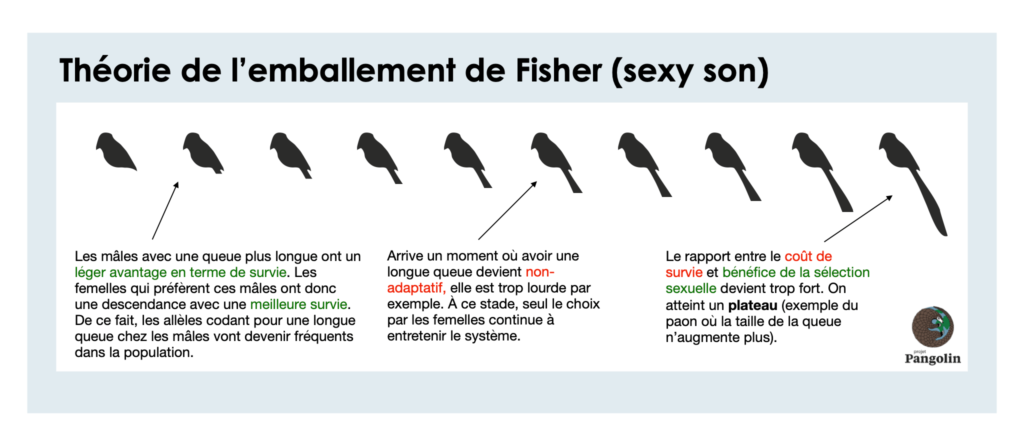
Ce mécanisme entraînera alors une sélection effrénée pour l'exagération de l'ornement et de la préférence. Ce mécanisme se poursuivre jusqu'à ce que les coûts de production de l'ornement dépassent l'avantage reproductif de sa possession. En théorie il peut s’agir de n’importe quel trait non-adaptatif tant que les femelles peuvent facilement les comparer. Le coût n’apparaît qu’au stade final d’un emballement évolutif.
La théorie alternative à l’emballement fisherien se nomme la théorie du handicap. Elle est aussi appelée la théorie des bons gènes.
Selon cette théorie du handicap, les mâles arborant des traits extravagants voire dangereux pour leur survie seraient des mâles de bonne qualité globale. En effet, les mâles handicapés par un trait extravagant ont été capables de survire dans un environnement hostile alors même qu’ils devaient (par exemple) trainer une immense queue multicolore (Zahavi 1975). Leur caractère extravagant serait alors un signal honnête informant sur leurs conditions physiques et donc leurs ‘bons gènes’.

Tous ces mécanismes reposent sur l’existence supposée de gènes conférant une meilleure vigueur (hypothèse des « bons gènes »), révélés par des indices extérieurs handicapants et ne pouvant donc être développés que par les individus de très bonne qualité individuelle. Cependant, les preuves du choix des femelles pour les bons gènes restent rares malgré des décennies d'études sur le choix du partenaire chez de nombreux organismes. Ce manque apparent de consensus continue de créer un débat quant à l'importance du modèle des bons gènes dans le domaine de la biologie évolutive.
La plupart du temps lorsque l’on parle de sélection sexuelle on pense aux affrontements à l’approche de la saison des amours ou bien aux somptueuses parades nuptiales. Dans le règne animal ces stratégies sont très répandues et surviennent avant la copulation. Si ces comportements ont été sélectionné au cours de l’évolution c’est principalement car ils permettent de départager les meilleurs mâles. À la fois en termes d’avantage indirect (si je choisis le mâle qui gagne, alors ma progéniture héritera probablement elle aussi des gènes qui lui permettront de gagner la compétition à son tour), ou bien d’avantage direct (si je choisis le mâle le plus fort, alors j’augmente ma probabilité de survie et celle de ma progéniture car je serais mieux protégée des prédateurs).
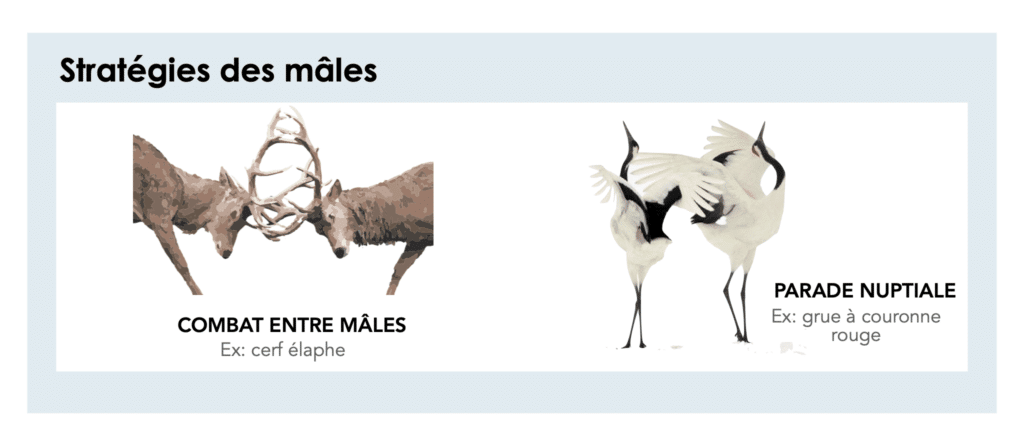
Les femelles ont parfois le choix de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Chez ces espèces il est alors fréquent qu’elles s’accouplent avec différents mâles pour maximiser leurs chances d’avoir une descendance en bonne santé. Dans cette situation, la compétition entre mâle intervient au niveau du sperme et s’appelle la compétition spermatique.
Les mâles n’ont pas intérêt à ce que d’autres mâles viennent féconder la femelle avec laquelle ils viennent de s’accoupler. Ainsi, au cours de l’évolution de multiples stratégies ont vu le jour à différentes temporalités du stade copulatoire.
Chez certaines espèces (comme les libellules par exemple) lorsque la femelle a déjà été fécondée, il arrive que le mâle suivant prenne plusieurs heures pour nettoyer la cavité spermatique de la femelle avant d’y introduire sa semence. Ainsi, à l’aide de petits plumeaux, il élimine le sperme d’éventuels prédécesseurs et accroît ses propres chances de paternité.
Afin de prolonger la durée de copulation, certains mâles ne vont plus lâcher la femelle d’un pouce. L'objectif étant de maximiser les chances de fécondation de leurs spermatozoïdes pendant l’accouplement. Pour cela il arrive que certains mâles fassent office de bouchon copulatoire. Chez certains phasmes le contact génital peut durer jusqu’à 79 jours ! [10].
Obstruction des voies génitales : Certaines espèces (blattes, criquets, et autres insectes) vont accompagner leur sperme d’une substance (glandes à ciment) destinée à obstruer les voies génitales de la femelle lors d’accouplements ultérieurs (par exemple, la mouche du fumier).
Contraception induite : Une autre stratégie consiste à libérer une substance qui empêche tout accouplement ultérieur. Chez les moustiques, les mâles produisent une substance par le biais de leur glande sexuelle secondaire qui inhibe la réceptivité des femelles inséminées. Ainsi, elles refusent la plupart des accouplements avec d'autres mâles [11].
Gardiennage des femelles : D’autres vont simplement ne plus quitter les femelles des yeux et éloigner tous mâles susceptibles de vouloir féconder la femelle [3], c’est le cas de certains singes ou bien des canards colvert.
Ugly beauty : Une autre tactique consiste à rendre les femelles peu attirantes pour les autres mâles. Ce phénomène est particulièrement bien connu chez les papillons de nuit. En effet, les mâles déposent des anti-aphrodisiaques sur les femelles lors de l’accouplement [3].
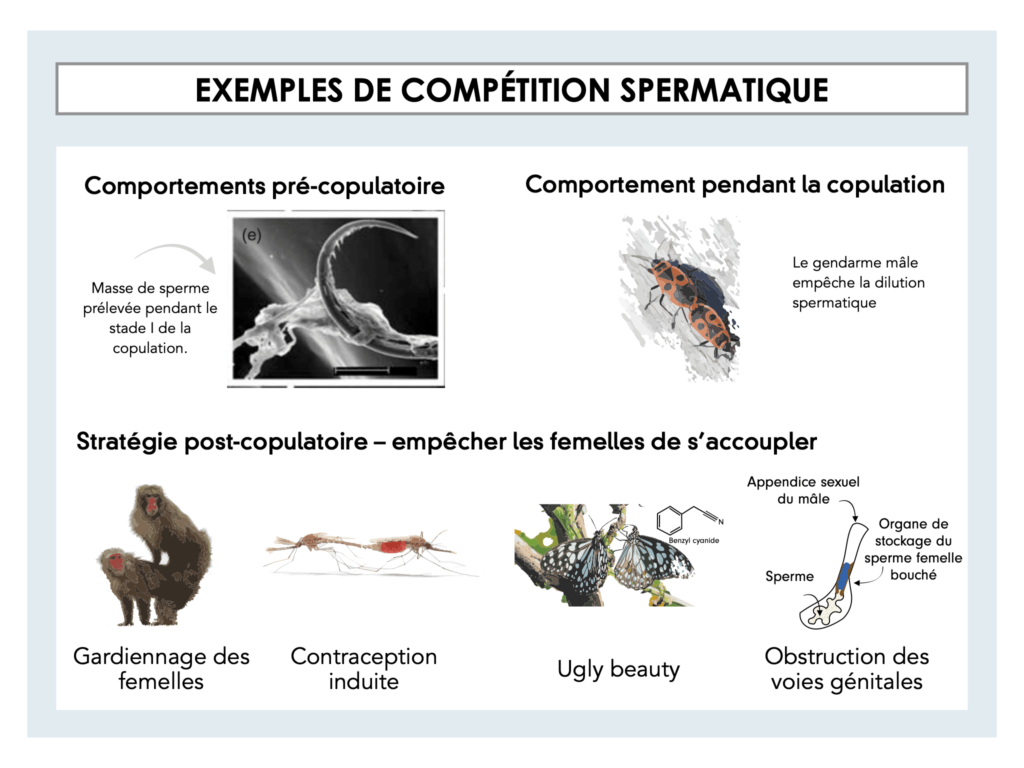
Jusqu’à présent nous avons vu que les caractères sexuels secondaires (par exemple, la queue du paon) étaient des indicateurs honnêtes de la qualité sous-jacente des mâles. Les coûts associés à la production et à l’entretien de ces caractéristiques extravagantes informaient les femelles sur l’état de santé global des mâles qui les portaient. En effet, plus un mâle est en bonne forme physique, plus il a accès à des ressources énergétiques de qualité. Et plus il est capable de les gaspiller en se pavanant avec une très longue queue dans la forêt. Certains mâles y ont vu l’opportunité d'optimiser leur allocation d’énergie en réduisant certains coûts liés aux traits sexuels secondaires sans nuire à leur succès reproductif global. C’est là que la triche rentre en jeu !
Certains mâles araignées remplissent leurs cadeaux nuptiaux de soie à la place d’une proie pour duper les femelles et se reproduire plus longtemps [14].
A défaut de ne pouvoir rivaliser avec les mâles plus imposants, certains vont ruser pour accéder tout de même à la fécondation. Chez certains batraciens, les mâles plus petits vont suivre de près les gros mâles et agripper les femelles attirées à ce dernier.
Les mâles d’autres espèces de poissons vont profiter de la fécondation qui se fait par jetée de sperme dans l’eau pour mêler le leur à celui d’autres poissons. Chez certains scarabées, les mâles vont aller féconder les femelles en cachette tandis qu'un mâle plus imposant va monter la garde.
Enfin, de nombreuses femelles choisissent des mâles qui vont accorder tout leur temps pour aider au nourrissage ou bien défendre le territoire. Les mâles se retrouvent ainsi tiraillés entre rester avec la femelle et féconder le plus de femelles possibles. Ainsi, il n’est pas rare d’observer des mâles aller féconder d’autres femelles en douce. Une étude sur des oiseaux, les Parulines orangées a ainsi montré que près de 27% des progénitures ont été identifiées comme résultant d'un accouplement extra-pair [15] !

Historiquement le domaine de la sélection sexuelle reste très jeune. En effet, la recherche dans ce domaine n’a démarré que dans les années 1960 [22]. Il n’est donc pas étonnant que le concept de sélection sexuelle reste méconnu, alors que le grand public a déjà connaissance de la sélection naturelle.
La science n’est pas neutre. Un.e scientifique est pris.e dans une matrice axiologique dont iel ne peut se défaire et dont il n’est pas souhaitable qu’iel se défasse car cela enlèverait à la science sa dimension humaine. Il est faux de penser que lorsqu’un.e scientifique pose son chapeau, son manteau et enfile sa blouse blanche iel efface le filtre interprétatif entre nous et le réel.
Il faut donc rester prudent quant aux observations que nous faisons sur le monde qui nous entoure, bien que nous puissions avoir des études très sérieuses sur la question, il n’en reste pas moins que notre perception des choses est subjective, spécialement dans un monde aussi complexe que le nôtre. L’idée de valeur commune est difficile à maintenir. Nous avons donc, aujourd'hui plus que jamais, besoin de partager les connaissances et les points de vue d'une diversité de chercheur.e.s sur un sujet de recherche car c’est en ce sens que nous pourrons diminuer au maximum nos interprétations personnelles.
Nous venons dans cet article de voir quelques exemples que j’ai choisis, mais en réalité il existe autant de différences qu’il n’existe d’espèces. Je ne vous ai pas parlé des espèces sans reproduction sexuée ou bien encore celles chez qui le sexe change au cours de la vie des individus (ce n’est que partie remise) ! Je reste personnellement toujours fasciné par toutes ces singularités qui nous entourent d’autant que la sexualité en générale façonne et occupe une place primordiale dans les processus évolutifs : celui de la passation des gènes !
1- Darwin, C., 1875. The Descent of Man, and Selection in relation to Sex. Nature, 11(277)
3- Albo, M. and Peretti, A., 2015. Worthless and Nutritive Nuptial Gifts: Mating Duration, Sperm Stored and Potential Female Decisions in Spiders. PLOS ONE, 10(6)
4- Gwynne, D., 2008. Sexual Conflict over Nuptial Gifts in Insects. Annual Review of Entomology, 53(1)
5- Andrade, M., 1998. Female hunger can explain variation in cannibalistic behavior despite male sacrifice in redback spiders. Behavioral Ecology, 9(1)
6- Toft, S. and Albo, M., 2016. The shield effect: nuptial gifts protect males against pre-copulatory sexual cannibalism. Biology Letters, 12(5)
7- Cecie Starr and Ralph Taggart, Biology – the Unity and Diversity of Life, 6th Ed., Wadsworth Publishing Company, 1992
8- Edward T. Hall, The Hidden Dimension, New York, Anchor Books, 1966
9- Córdoba-Aguilar, A., Uhía, E. and Rivera, A., 2003. Sperm competition in Odonata (Insecta): the evolution of female sperm storage and rivals' sperm displacement. Journal of Zoology, 261(4)
10- Gangrade, G., 1964. Accessory glands of female phasmid, Necroscia sparaxes Westwood. Annals and Magazine of Natural History, 7(84)
11- Helinski, M., et al., 2012. Duration and dose-dependency of female sexual receptivity responses to seminal fluid proteins in Aedes albopictus and Ae. aegypti mosquitoes. Journal of Insect Physiology, 58(10)
12- Parker, G., 1970. Sperm competition and its evolutionary consequences in the insects. Biological Reviews, 45(4)
13- van Noordwijk, A. and de Jong, G., 1986. Acquisition and Allocation of Resources: Their Influence on Variation in Life History Tactics. The American Naturalist, 128(1)
14 - Ghislandi, P., et al., 2017. Silk wrapping of nuptial gifts aids cheating behaviour in male spiders. Behavioral Ecology, 28(3)
15 – Morton Catherine Heidrich Virginia., 2013. PhD thesis. Who's Your Daddy? A Study of Extra-Pair Copulation and Mating Behaviors of Protonotaria citrea Behaviors of Protonotaria citrea.
16 - Sinervo, B. and Lively, C., 1996. The rock–paper–scissors game and the evolution of alternative male strategies. Nature, 380(6571)
17- Puts, D., 2021. Human sexual selection. 20015. Current Opinion in Psychology.
18- Scott, I., et al., 2014. Human preferences for sexually dimorphic faces may be evolutionarily novel. PNAS, 111(40)
19- Wheatley, J.,et al., 2014. Women’s faces and voices are cues to reproductive potential in industrial and forager societies. Evolution and Human Behavior, 35(4)
20- Collins, S. and Missing, C., 2003. Vocal and visual attractiveness are related in women. Animal Behaviour, 65(5)
21- Singh, D., et al., 2010. Cross-cultural consensus for waist–hip ratio and women's attractiveness. Evolution and Human Behavior, 31(3)
22- Giraldeau, L., Cézilly, F. and Danchin, E., 2005. Écologie comportementale. Paris: Dunod.
Les insectes… un mot qui génère à la fois de la curiosité et de la crainte chez nombre de personnes. On les associe souvent à des petites bêtes qui nous embêtent, qui peuvent nous piquer, et quand on pense à eux, on voit beaucoup de pattes qui pourraient nous courir dessus.
Pourtant, plus de la moitié des espèces animales connues sont des insectes [1]. On connaît 1 million d’espèces et on estime qu’il nous en reste encore au moins 5 millions à découvrir [2].
On vous emmène donc avec nous à la découverte de ce groupe riche et original.
Dans la suite de cet article, nous allons vous présenter 12 espèces communément rencontrées en France. À la fin de cette partie vous pourrez télécharger les fiches d’identités de ces espèces pour les emmener avec vous sur le terrain et faire vos observations.
Ensuite, nous vous donnerons des astuces pour aider les insectes à survivre et nous vous expliquerons pourquoi c’est important.
Vous apprendrez alors comment construire vos propres abris à insectes et rendre votre jardin insectes-friendly !
La coccinelle à damier (Propylea quatuordecimpunctata) appartient à l’ordre des Coléoptères et à la famille des Coccinellidae.
Elle est assez commune et se retrouve à travers toute l’Europe dans les milieux ouverts. Elle affectionne les petits arbustes et les plantes basses. Vous pourrez assez facilement l’apercevoir aussi bien dans la végétation en bordure de champs que dans votre jardin.
Les adultes de cette espèce émergent légèrement plus tard que les plus grosses espèces de coccinelles, lorsque les températures sont plus douces. On peut ainsi la rencontrer d’avril à octobre.
Comme la plupart des coccinelles, elle est très vorace, particulièrement au stade larvaire et se nourrit de petits insectes comme les pucerons. Elle est donc une alliée pour les jardiniers. Comme d’autres espèces de coccinelles elle est utilisée en tant qu’auxiliaire pour la protection des cultures face aux attaques de pucerons et autres petits ravageurs.
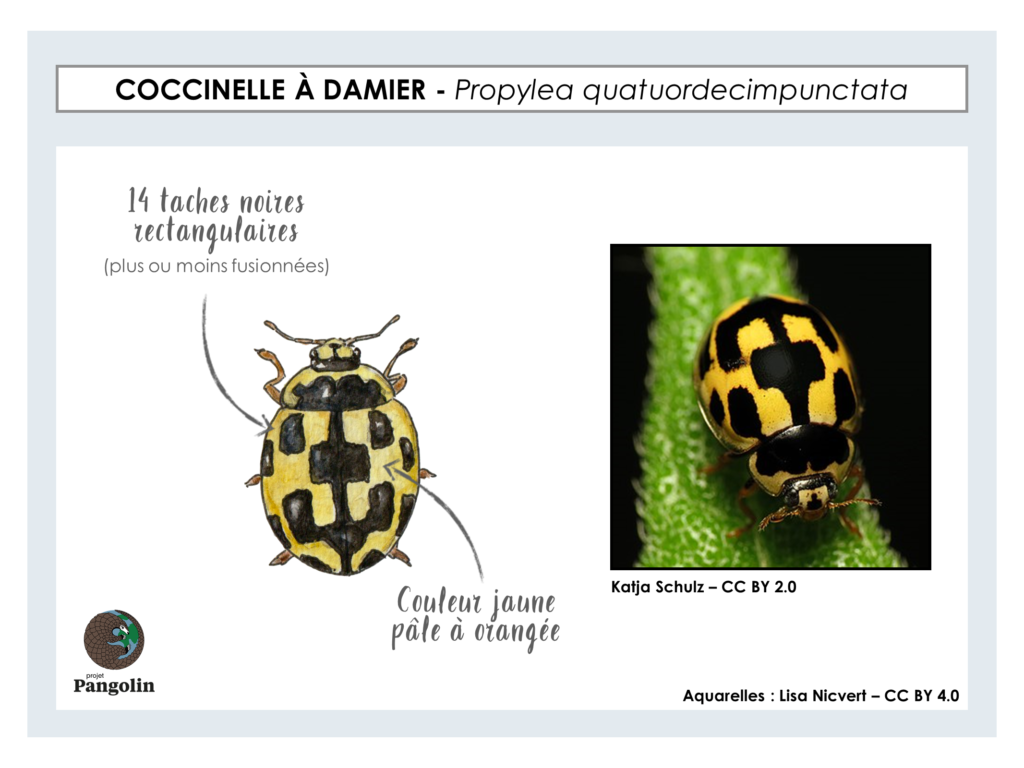
À la différence de ses cousines rouges à petits pois noirs bien connues, comme les coccinelles à 2 points (Adalia bipunctata) ou à 7 points (Coccinella septempunctata), la coccinelle à damier arbore une livrée (son « costume ») jaune et noire à motifs carrés. Elle compte ainsi 14 taches noires carrées/rectangulaires, bien visibles sur un fond jaune crème à orange très pâle.
Les taches sont rarement bien dessinées, elles sont le plus souvent partiellement fusionnées donnant ce motif de damier dont est tiré son nom. Elle possède également des taches noires sur son pronotum (la partie supérieure du thorax visible entre la tête et les élytres) qui se rejoignent en formant un motif en forme de couronne.
Bien qu’elle ne dépasse pas les 5 mm, cette petite coccinelle ne passe pas inaperçue dans la végétation avec ses belles couleurs !
Le nombre de points sur les élytres des coccinelles ne permet malheureusement pas de connaitre leur âge. En revanche c'est souvent un bon moyen de différencier les espèces. On retrouve cette particularité dans beaucoup de leurs noms latins : bipunctata (2 points), septempunctacta (7 points).
La libellule déprimée (Libellula depressa) est un insecte de l’ordre des Odonates et appartenant à la famille des Libellulidae.
Son aire de répartition s’étend de l’Europe jusqu’en Asie, à l’exception de la pointe Sud de l’Espagne et du Nord de l’Europe. C’est une espèce très commune en France.
On peut facilement l’observer autour de nombreux types de points d’eau de mai à septembre. C’est une espèce dite pionnière, c’est-à-dire qu’elle est souvent une des premières espèces à coloniser un nouveau milieu. C’est ainsi qu’on pourra la rencontrer aux abords de marres ou bassins apparus récemment ou aux abords de petits points d’eau stagnante.
Cette libellule rapide ne sera pas aisée à observer en vol ou au-dessus de l’eau. En revanche, vous la verrez souvent dans la végétation alentours, postée sur un perchoir souvent en hauteur. Les mâles, très territoriaux, chassent tout intrus qui volerait trop près de leur territoire.
Comme toutes les libellules, c’est une chasseuse hors pair qui attrape de petits insectes en plein vol.
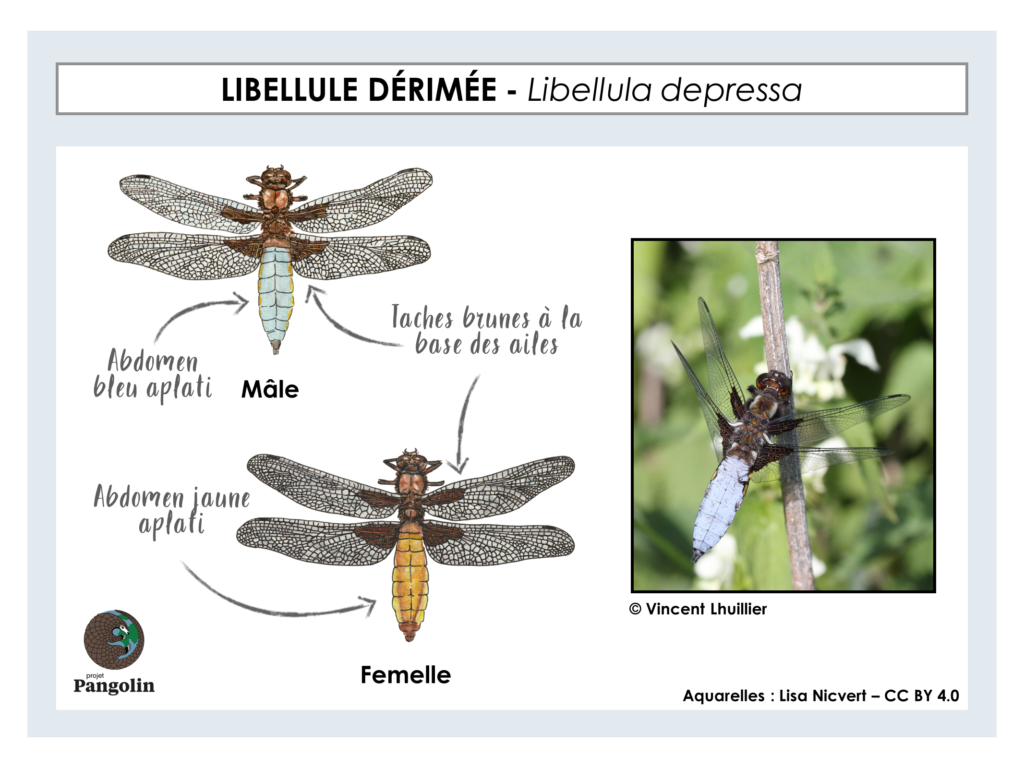
La libellule déprimée est une grande libellule qui peut atteindre presque 5 cm pour une envergure allant jusqu’à 7,5 cm. Elle possède un abdomen large et aplati (ou « déprimé », d’où son nom) bleu clair chez le mâle, avec de légères tâches jaunes sur le côté, et jaune à brun chez la femelle. Ses yeux sont bruns sur le dessus.
Point distinctif, la libellule déprimée possède de larges taches à la base de ses ailes : de grandes taches brunes triangulaires sur ses ailes postérieures (comme chez de nombreux Libellulidae) mais aussi de longues taches brunes à la base des ailes antérieures, ce qui vous fera dire à coup sûr « c’est bien Libellula depressa ! ».
Déjà toute petite, dans l'eau, la larve de libellule est un prédateur impitoyable qui chasse tout ce qui passe à sa portée. Elle possède une arme redoutable que l'on appelle le 'masque' : c'est une sorte de bras articulé se finissant en pinces acérées. Comme les caméléons avec leur langue, elle projette son masque en avant vers sa proie pour la saisir avant de s'en repaitre. Larves de moustiques ou petits tritons parfois, rien ne résiste à cette terreur petite mais costaude !
Le phasme gaulois (Clonopsis gallica) est un phasme (Phasmida ou Phasmoptères) de la famille des Bacillidae.
Avec le phasme d’Espagne et le phasme de Rossi, il fait partie des trois espèces de phasmes présentes en France. Il est néanmoins le plus communément rencontré en France et on peut l’observer dans toute la moitié sud du pays et jusqu’à l’ouest.
Il apprécie les environnements ombragés comme les lisières de forêts ou les bords de chemins et préfère rester à 1 ou 2 m de hauteur. On le retrouvera très souvent sur les plantes et buissons desquels il se nourrit, comme les ronces ou les rosiers. Les adultes sont visibles de mai à octobre.
Les œufs, qui ressemblent à de toutes petites graines, sont pondus avant l’hiver et effectuent une diapause. C’est une pause dans leur développement, qui dure pendant plusieurs périodes hivernales avant que les œufs n’éclosent.
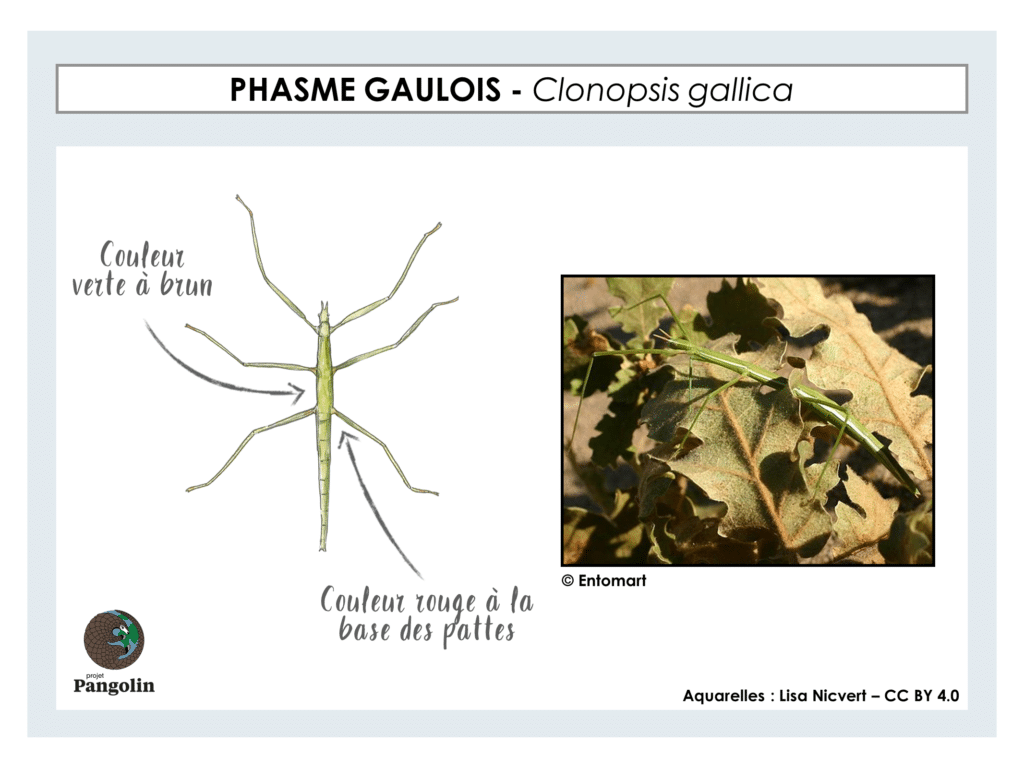
Le phasme gaulois ressemble à s’y méprendre à une brindille à 6 pattes. C’est d’ailleurs son meilleur atout pour se camoufler dans son environnement. Il est fin, tout en longueur, arbore une couleur allant du vert au brun et peut atteindre les 7 cm. On le différencie des autres phasmes que l’on peut trouver en France par la couleur rouge qui apparaît à la base de ses pattes avant, près du thorax.
Dans la nature, les mâles Clonopsis gallica n'existent pas ! En effet, les femelles se reproduisent en pondant des oeufs non fécondés qui donneront d'autres femelles : c'est ce que l'on appelle la parthénogenèse. Cette stratégie de reproduction est présente chez de nombreuses espèces d'insectes mais est particulièrement répandue chez les phasmes.
L’osmie cornue (Osmia cornuta) appartient à l’ordre des Hyménoptères. C’est une abeille de la famille des Megachilidae.
Elle est présente dans toute l’Europe, à l’exception des pays nordiques. On peut voir ces abeilles sauvages voler et butiner dans les parcs, les prairies et les jardins, de mars à juin.
L’osmie cornue butine de nombreuses fleurs dont elle récolte et consomme le nectar et le pollen. Elle semble avoir une préférence pour les Fabacées (comme le trèfle ou le lupin) et les Rosacées (nombreux arbres fruitiers tels que les pommiers ou les cerisiers).
La femelle construit des nids dans des cavités (tiges creuses, trous d’évacuation de fenêtres). Elle y dépose du nectar et du pollen pour la future larve, pond un œuf unique, puis rebouche le tout avec une argile formée d’un mélange de terre et de salive. Elle construit ainsi de nombreuses loges pour toute sa descendance durant tout l’été.
À la fin de l’été, les larves se métamorphosent en adulte (ou imago) et restent dans la cellule où elles ont grandi. Elles ne sortiront qu’au printemps suivant.
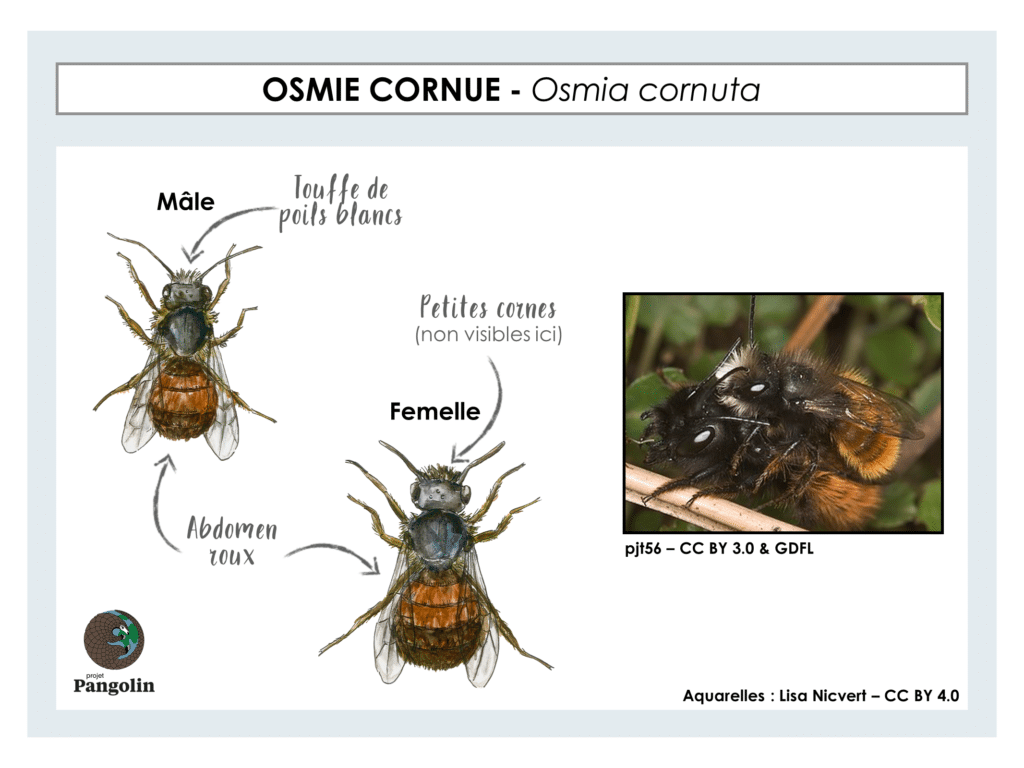
L’osmie est une abeille relativement trapue. Son abdomen ovale est roux tandis que son thorax et sa tête sont noir. Le mâle possède une touffe de poils (ou soies) blancs sur la face. La femelle en est dépourvue mais possède deux petites cornes noires sur l’avant de la tête. Elle a également une petite brosse ventrale roux vif, sous l’abdomen, qu’elle utilise pour récolter le pollen. Les antennes sont légèrement plus courtes chez la femelle.
L'osmie est une travailleuse acharnée : la femelle fait plusieurs dizaines de voyages chargée de nectar et de pollen pour remplir convenablement une loge pour sa larve. Elle participe ainsi à la pollinisation. On connait en général le rôle pollinisateur de l'abeille domestique (Apis melifera) mais les 870 espèces d'abeilles sauvages solitaires en France ont également un rôle crucial dans le maintien de nos écosystèmes.
Le syrphe porte-plume (Sphaerophoria scripta) est un Diptère (comme les mouches communes !) de la famille des Syrphidae.
Il est répandu dans tout l’hémisphère Nord et est particulièrement fréquent en Europe. Il apprécie les fourrés, prairies et autres jardins riches en plantes à fleurs, et peut être aperçu d’avril à novembre.
L’adulte syrphe porte-plume se nourrit du nectar et du pollen des fleurs qu’il butine. La larve, en revanche, est plus vorace et se nourrit, comme de nombreux Syrphidae, de pucerons. Les syrphes rendent ainsi un double service : à l’état de larve ils protègent les cultures des ravageurs et, à l’âge adulte, ils participent à la pollinisation.
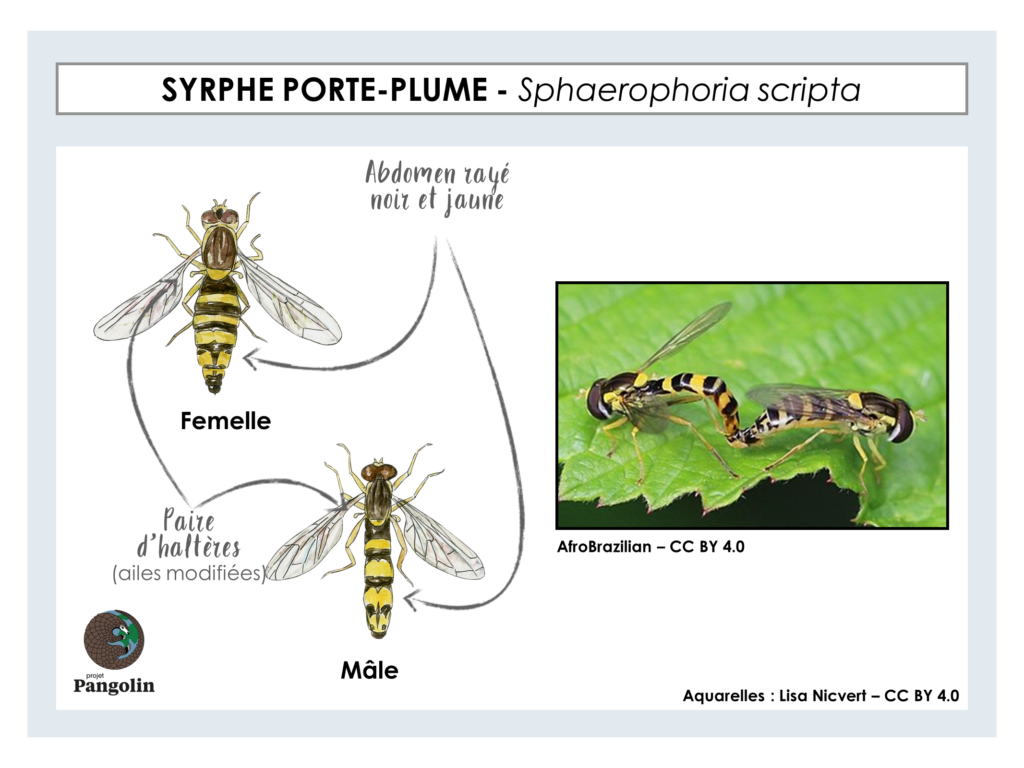
C’est un insecte volant très gracile. Comme tous les diptères il ne possède qu’une paire d’ailes : la seconde est modifiée en petites massues (ou haltères) qui servent de gyroscope en vol (pour se stabiliser).
Il présente de grands yeux globuleux. Le thorax est brun foncé et parcouru de grandes bandes latérales plus claires tandis que l’abdomen est rayé de noir et de jaune. La femelle est légèrement plus large que le mâle et ce dernier a l’extrémité de l’abdomen renflé en une boule qui lui donne l’allure d’une pointe de plume, d’où son nom vernaculaire de syrphe porte-plume.
La larve est apode (elle n’a pas de pattes !) et ne possède pas de tête bien visible. Le corps est vert et traversé de deux lignes blanches plus ou moins rectilignes sur le dos.
Avec ses rayures et ses couleurs le syrphe porte-plume pourrait être confondu avec des guêpes ou d'autres insectes piqueurs. Mais il est inoffensif et ne pique pas ! C'est bien là toute la ruse ! En imitant des insectes auxquels il n'est pas bon de se frotter, ce syrphe dissuade les prédateurs de s'approcher de peur de se faire piquer. Ce type de mimétisme, où l'espèce mimant est inoffensive, est appelé mimétisme batésien.
La chrysope (Chrysoperla carnea, sensu lato) est un Névroptère de la famille des Chrysopidae.
Présente dans toute l’Europe, elle affectionne les milieux où l’on retrouve des plantes à fleurs (prairies et jardins) et là où se concentrent les colonies de pucerons.
Elle est active de mars à octobre et passe l’hiver à l’abri dans des haies ou des tas de bois. L’adulte est principalement actif la nuit, mais il n’est pas rare d’en observer de jour dans un buisson ou une haie, ou à l’abri sous une feuille. La larve, particulièrement mobile, peut être observée dans la végétation, chassant parmi les pucerons.
À l’état adulte, la chrysope se nourrit de nectar et de pollen de fleurs ainsi que de miellat de pucerons. À l’état larvaire, elle est un redoutable prédateur particulièrement friand de pucerons. Elle est d’ailleurs utilisée en lutte biologique comme auxiliaire de culture pour lutter contre des ravageurs comme les pucerons, les thrips et certaines chenilles. Son appétit pour les pucerons est tel qu’elle est parfois appelée « lion des pucerons ».
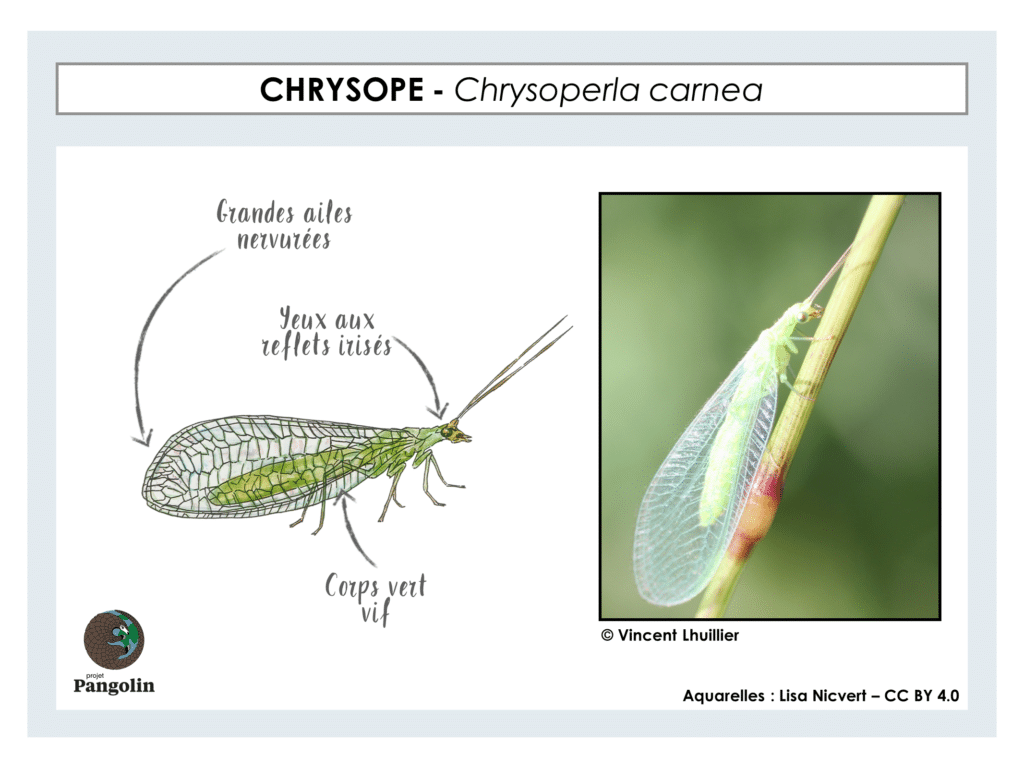
La chrysope adulte présente de grandes ailes transparentes ovales, très nervurées. Son corps vert clair est long et fin. Ses yeux d’une couleur métallique ont des reflets dorés, ce qui lui a valu le surnom de « demoiselle aux yeux d’or ».
La larve est gris-brun, parfois verte aux premiers stades, et traversée de deux lignes rougeâtres. Elle possède à l’avant de la tête de grandes mandibules, semblables à une pince. Ce sont en fait deux petits tubes percés, que la larve utilise pour injecter à l’intérieur de sa proie une substance qui liquéfie cette dernière, permettant à la larve de chrysope d’aspirer son contenu (comme avec une paille).
Du fait de l'activité essentiellement nocturne des chrysopes, les chauves-souris constituent leurs principaux prédateurs. Mais les chrysopes ont trouvé la parade : sensibles aux ultrasons que produisent les chauves-souris, elles savent quand elles sont prises en chasses et cessent instantanément de battre des ailes.
La panorpe (Panorpa communis) appartient à l’Ordre des mécoptères et à la famille des Panorpidae.
Elle est présente dans toute l’Europe et l’Asie et est parfois très abondante ponctuellement. On retrouve les panorpes dans les milieux ombragés et plutôt humides. Elles sillonnent ainsi les forêts, les bords de cours d’eau ou les marécages. On les rencontre principalement au printemps et en été.
Les adultes sont essentiellement carnivores : ils se nourrissent de mouches ou de petits animaux morts. À l’occasion, ils se nourrissent également de nectar ou miellat de pucerons.
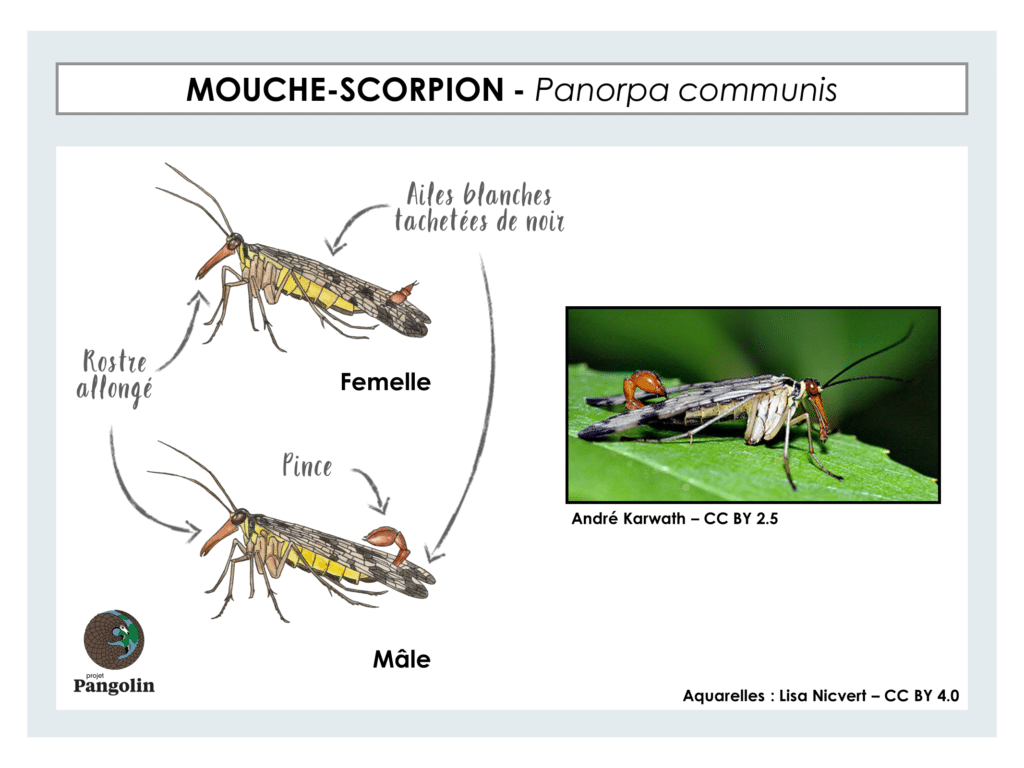
La mouche-scorpion est un petit insecte d’environ 20 mm de long. Son corps est jaune et noir et ses ailes, au nombre de quatre, sont zébrées de taches noires, plus ou moins nombreuses selon les espèces du genre Panorpa. Chez P. communis, les taches sont plus discrètes que chez les autres Panorpa.
Comme chez tous les mécoptères, sa tête est allongée, formant un rostre au bout duquel se trouvent les pièces buccales. Malgré son nom de mouche-scorpion, la panorpe est inoffensive. En effet, ce surnom vient de la ressemblance de l’extrémité de l’abdomen des mâles avec la queue des scorpions, bien qu’elle soit plus proche d’une pince que d’un aiguillon.
Pour trouver sa nourriture, la panorpe est plutôt opportuniste et préfère profiter de l'aubaine d'un cadavre de mouche plutôt que de chasser activement. Elle n'hésite d'ailleurs pas à voler les petits insectes pris dans les toiles d'araignées.
Le paon-du-jour (Aglais io) est un papillon (ou Lépidoptère) de la famille des Nymphalidae.
Il est présent dans toute l’Europe et jusqu’en Asie et est commun en France.
De février à octobre ce papillon se rencontre en prairies ou en lisière de forêts, parcs et jardins. Il apprécie les milieux légèrement humides et évitera ainsi tout environnement trop sec. Il passe l’hiver sous forme de chrysalide ou sous forme adulte, caché dans des anfractuosités et souvent dans nos maisons, garages ou autres abris de jardins.
Adulte, il se nourrit du nectar des fleurs qu’il visite çà et là. Sa chenille, quant à elle, se nourrit sur l’ortie dioïque (Urtica dioica, celle qui pique !).
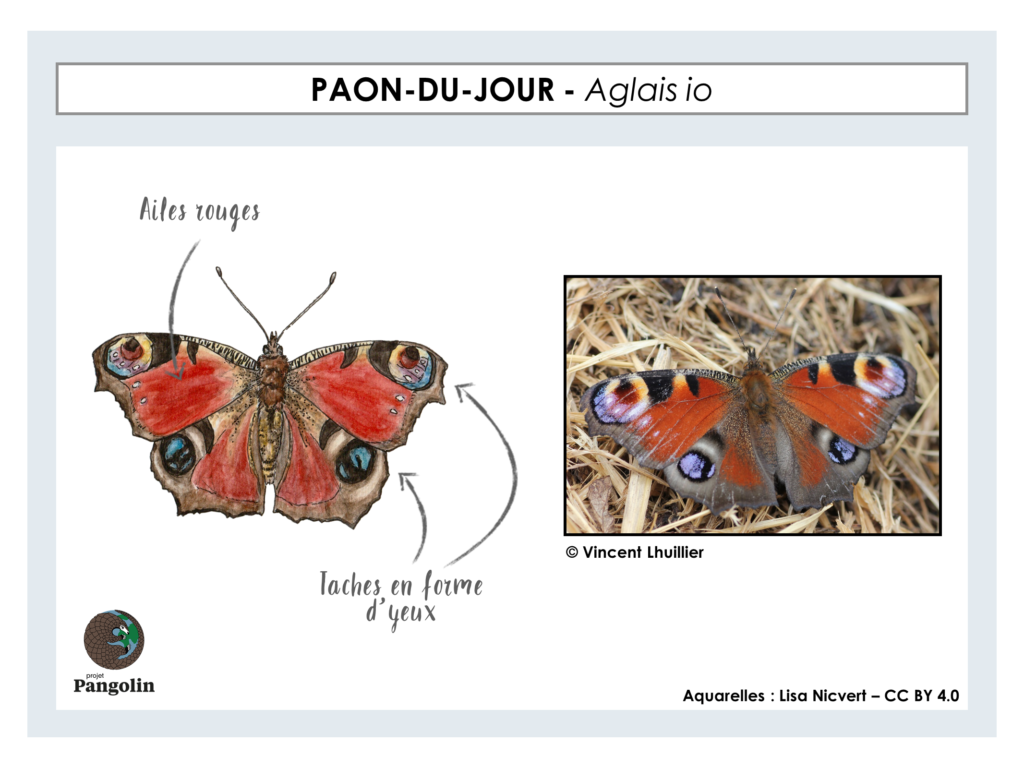
La chenille du paon-du-jour a la tête et le corps noirs parsemé de points blancs. Elle possède de nombreux petits pics grêles appelés scoli sur le dos et les flancs. Une fois sa nymphose (la métamorphose qui la transforme en chrysalide) achevée, bien à l’abri dans sa chrysalide toute verte, elle se transforme en un grand papillon de 5 cm d’envergure.
Bien que le dessous des ailes soit d’un brun sombre, la face supérieure est vibrante de couleurs : le fond des ailes est rouge foncé et sur chacune d’elles est présente une grosse tache violet brillant en forme d’œil. C’est de là que vient son nom de paon-du-jour car il rappelle le motif des plumes du mâle paon.
Fait étonnant chez les insectes (mais que l’on retrouve chez de nombreux Nymphalidae) : ce papillon n’a que 4 pattes !
Le Paon-du-jour n'est pas le seul papillon qui se développe sur les orties. Elles sont également la source de nourriture de la Petite Tortue (Aglais urticae - "Urtica", comme l'ortie !), du Vulcain (Vanessa atalanta) ou du Robert-le-diable (Polygonia c-album). Pensez ainsi à garder une petite touffe d'orties au fond de votre jardin si vous voulez continuer à voir ces beaux voiliers visiter vos fleurs en été.
Le gendarme, ou pyrrhocore (Pyrrhocoris apterus), est un petit insecte bigarré de l’ordre des Hémiptères appartient à la famille des Pyrrhocoridae.
Il est présent dans toute l’Europe, à l’exception des extrémités nord des îles britanniques et de la Scandinavie, et jusqu’en Inde.
Il se rencontre en groupes au pieds des arbres, notamment le tilleul et l’hibiscus, dans les milieux très ensoleillés. On peut l’observer d’avril à octobre, puis en hiver les adultes se cachent sous l’écorce des arbres ou dans des anfractuosités du sol.
Les gendarmes sont polyphages (ils peuvent consommer divers aliments) mais se nourrissent principalement de graines, de sève et de fruits (notamment ceux des roses trémières, des mauves ou des hibiscus). Il leur arrive aussi de se nourrir d’œufs ou de cadavres d’insectes.
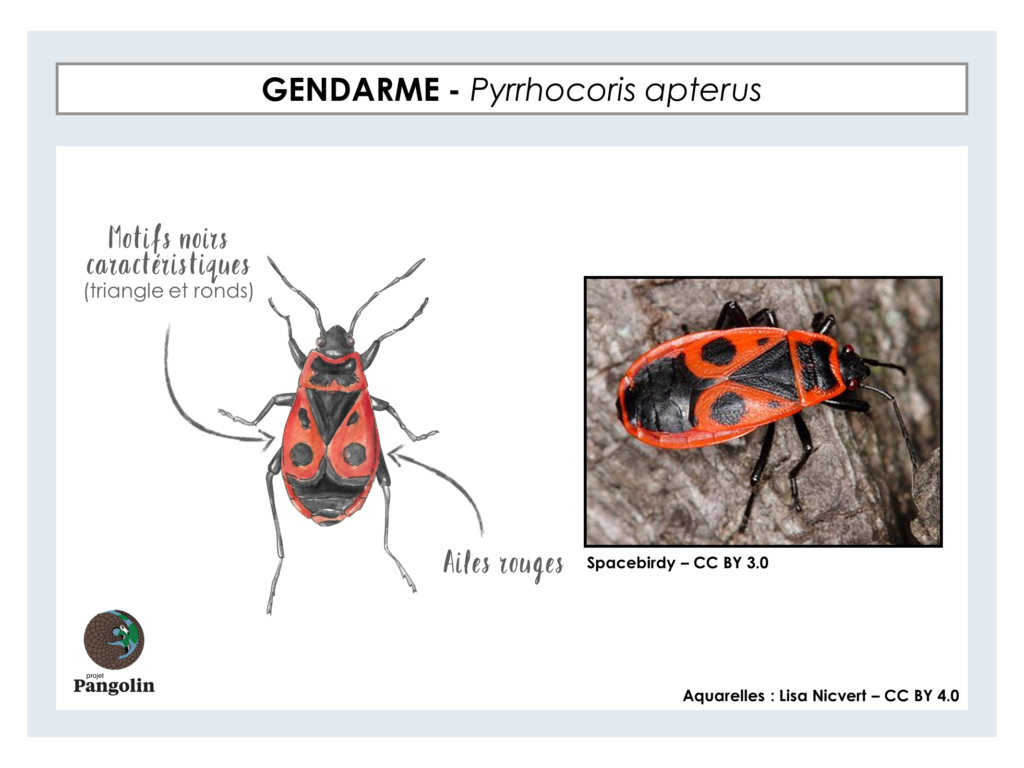
Le gendarme est une petite punaise d’environ 10 mm à la coloration rouge et noire, formant sur son dos un motif ressemblant à un visage ou un grand masque. Les pattes et la tête sont entièrement noires et les yeux sont rouges.
Comme tous les Hémiptères (punaises, pucerons, cigales, cochenilles…) il possède un long rostre (ou stylet) qu’il utilise pour piquer et aspirer sa nourriture. Les larves et juvéniles ressemblent aux adultes mais en plus petits, et ne possèdent pas les motifs noirs et rouges car leurs ailes ne sont pas encore développées. L’absence d’ailes laisse ainsi apparaître l’abdomen d’un rouge éclatant.
Les couleurs du gendarme le rendent bien visible pour les prédateurs, mais elles sont aussi un avertissement pour ces derniers. Bien souvent dans le règne animal, de telles couleurs criardes servent à avertir les prédateurs que l'animal est toxique ou a très mauvais goût. On parle alors de couleurs aposématiques. Ce n'est pas le des gendarmes, étrangement, car ils n'ont pas d'odeur, ce qui est un fait étonnant pour une punaise terrestre.
Le géotrupe du fumier (Geotrupes stercorarius) est un insecte Coléoptère de la famille des Geotrupidae.
Visible d’avril à septembre, on le rencontre dans toute l’Europe dans les milieux boisés et peuplés de grands mammifères, tels que les cerfs ou les chevreuils.
Le géotrupe, particulièrement sa larve, est en effet coprophage, c’est-à-dire qu’il se nourrit d’excréments d’animaux. Il affectionne les excréments de grands mammifères qui serviront de nourriture pour ses larves. C’est un bousier efficace qui contribue à la dégradation des déjections en forêt. Bien qu’également partiellement coprophages, les adultes se nourrissent aussi beaucoup de champignons.
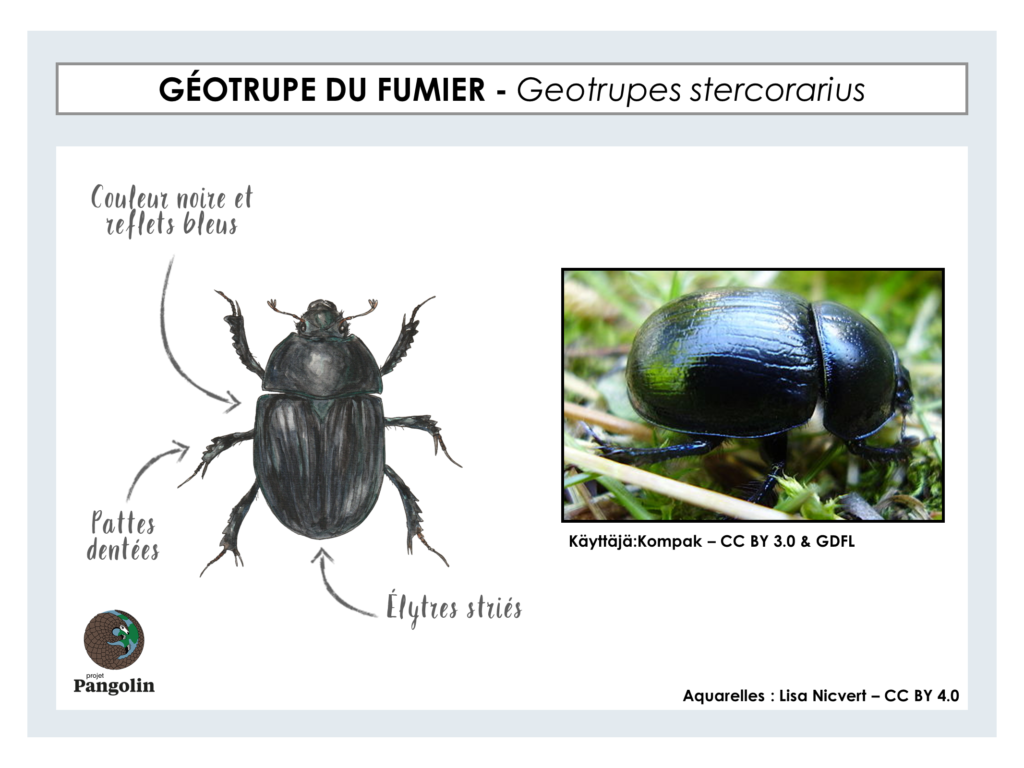
Le géotrupe est un scarabée au corps trapu, bombé et arrondi, de couleur noire à reflets métalliques bleus. La tête et le pronotum (la partie supérieure du premier segment thoracique visible) sont lisses ou légèrement ponctués. Les élytres (la première paire d’ailes rigides protégeant la seconde) sont, quant à eux, striés. Ses pattes sont dentées et la première paire à l’avant est légèrement plus large que les autres et sert à l’animal à creuser.
La dégradation des diverses bouses et crottins est un processus qui fait intervenir de nombreuses espèces d'insectes et participe à l'enrichissement et l'aération des sols. En moins d'une heure, une bouse fraiche est déjà colonisée par les mouches et les coléoptères qui consomment la matière et y pondent leurs oeufs. Champignons, bactéries, et autres lombrics, ne tardent pas ensuite à coloniser aussi ce nouvel écosystème, aidées par les galeries creusées par les coléoptères.
La mante religieuse (Mantis religiosa) appartient à l’Ordre des Mantodea et à la famille des Mantidae.
Originaire du bassin méditerranéen, sa répartition s’étend maintenant sur toute l’Asie. En Amérique du Nord, où elle a été introduite, elle est considérée comme invasive. On peut la retrouver dans toute la France sauf à l’extrême Nord. Elle affectionne particulièrement les environnements secs, les prairies, les champs en friches ou encore les buissons.
La mante religieuse peut s’observer durant une grande partie de l’année. Dès le début du printemps on peut rencontrer les juvéniles fraîchement éclos, qui ressemblent aux adultes en version miniature. En été, les individus ont atteint le stade adulte et s’apprêtent à s’accoupler jusqu’à fin octobre. La ponte a ensuite lieu jusqu’en novembre.
La mante religieuse, que l’on surnomme également « tigre de l’herbe », est un prédateur hors pair. Elle se nourrit de tout insecte qui aura le malheur de croiser sa route. Elle chasse en effet, à l’affut, et s’attaque à des proies aussi grosses qu’elle. Adulte, elle consomme papillons, mouches, moustiques, criquets et sauterelles ; juvénile, elle se contente de pucerons ou de petites mouches.
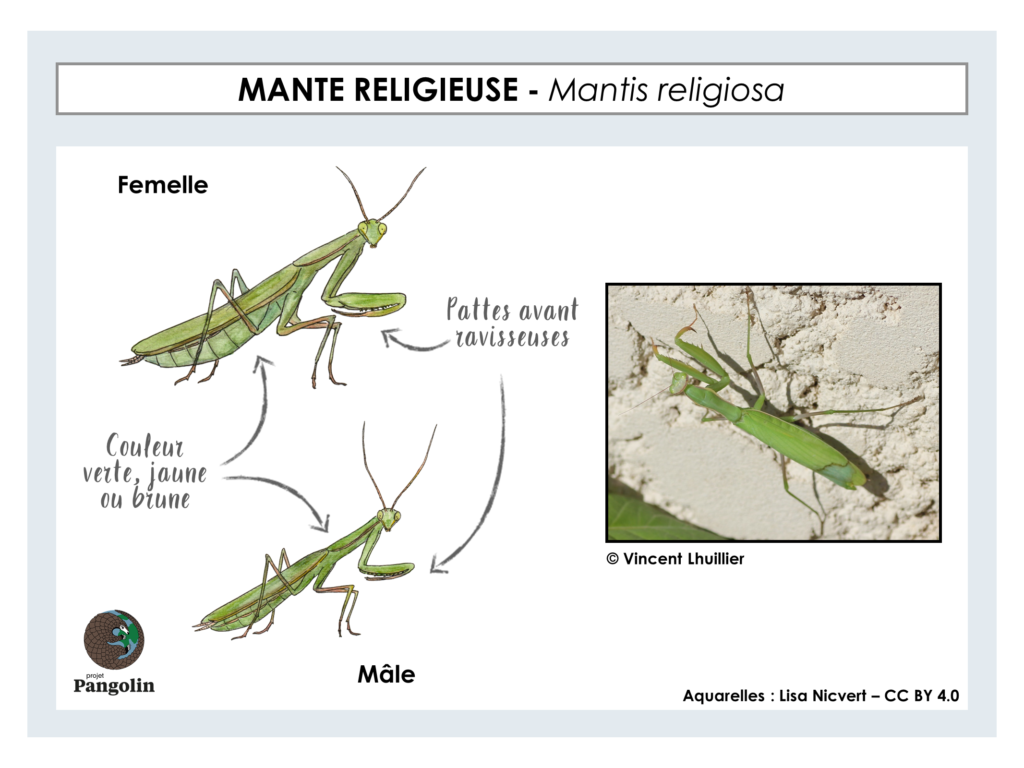
Lorsqu’on rencontre une mante religieuse, on ne peut pas se tromper sur son identité. C’est un grand insecte très élancé, vert ou brun, pouvant atteindre 8 cm de long. Elle possède de très grands yeux et une tête triangulaire très mobile qui peut pivoter à 180° pour toujours avoir ses proies en vue.
Ses pattes avant, dites « ravisseuses », sont bardées d’épines et fonctionnent comme des pinces qu’elle projette vers ses proies pour les attraper. On la reconnaît aussi facilement grâce aux tâches noires qu’elle possède à l’intérieur de ses pattes antérieures (côté tête), au niveau de l’aisselle.
Chez les mantes, les oeufs ne sont pas pondus individuellement mais dans une coque de protection que l'on appelle l'oothèque (littéralement boite à oeufs en grec). La femelle Mantis religiosa pond 200 à 300 oeufs en même temps qu'une sorte de mousse expansive qui va progressivement se solidifier. Cette structure est si résistante qu'elle peut rester dans la nature plusieurs années après l'émergence des petites mantes.
La grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) est un insecte de l’ordre des Orthoptères et appartient à la famille des Tettogonidae. Cette sauterelle est commune en France. On la rencontre également dans toute l’Europe occidentale.
C’est un habitant des milieux ouverts herbacés comme les prairies et les landes. Bien que l’on puisse la trouver dans l’herbe, elle affectionne particulièrement les arbustes, les buissons ou les arbres, qui sont ses zones de chasse préférées. Il est possible de la rencontrer dans la végétation, de la voir voler, ou même de l’entendre, à partir de la mi-juillet et jusqu’en octobre.
Cette sauterelle est dotée de puissantes pièces buccales de type broyeur, alors attention, elle peut mordre ! Elle est essentiellement carnivore. Il lui arrive de consommer quelques végétaux de temps à autres, mais son menu quotidien est composé de chenilles, de mouches ou d’autres grandes sauterelles vertes si l’occasion se présente !
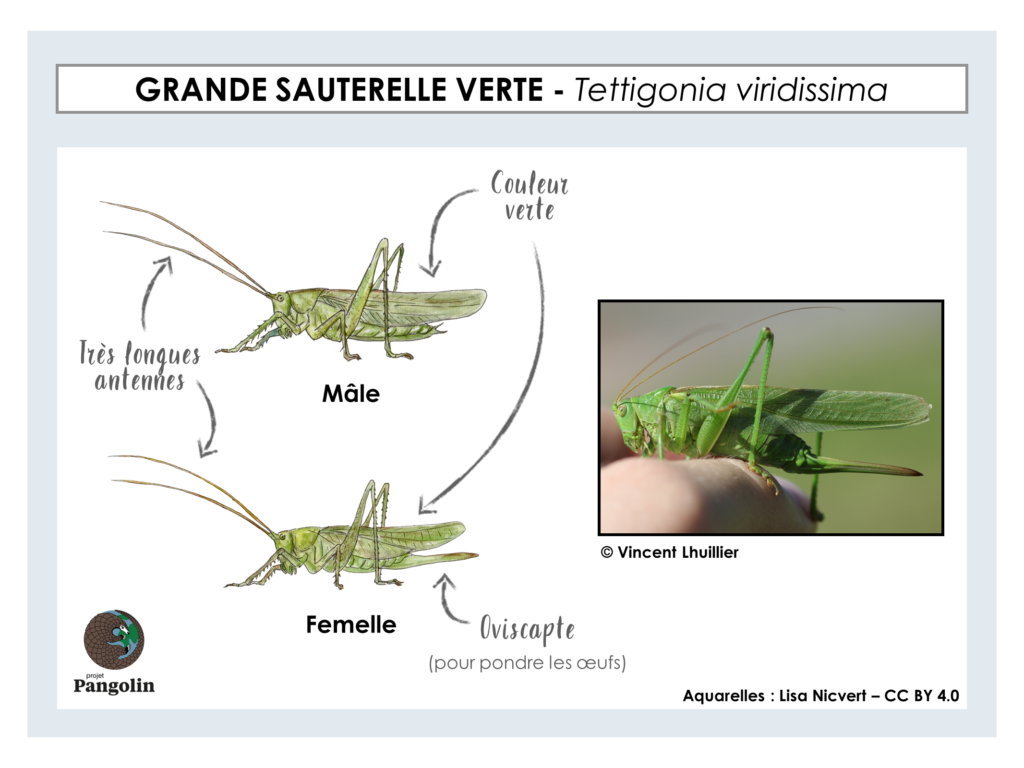
La grande sauterelle verte est tout d’abord remarquable par sa taille. Elle peut mesurer jusqu’à 4,2 cm pour les femelles (> 6cm avec les ailes). Celles-ci possèdent en plus un oviscapte (sorte d’appendice en forme de lame pour pondre ses œufs dans le sol) qui les rend encore plus longues.
Cette sauterelle est entièrement verte (viridissima signifie « très verte » en latin), à l’exception du dessus de la tête et du thorax qui sont légèrement bruns, ce qui lui permet de se confondre avec son environnement et la rend difficile à repérer quand elle est immobile.
Elle possède également de grandes pattes postérieures et de longues ailes, qu’elle utilise pour bondir et s’envoler d’arbre en arbre. Comme les autres sauterelles, elle possède de très longues antennes filiformes qui peuvent atteindre une fois et demie sa taille.
Discrète dans la végétation avec sa couleur, c'est bien souvent par son chant que l'on repère la grande sauterelle verte. Les mâles émettent leurs stridulations en frottant leurs ailes antérieures durcies l'une contre l'autre. Les femelles repèrent ces sons grâce à leurs tympans situés dans les pattes avant. Les mâles infatigables, chantent du crépuscule à l'aube pour attirer les femelles.
Maintenant que l’on a eu un bel aperçu du monde fascinant des insectes, de leur diversité et originalité, on va s’intéresser à comment les aider.
Car la 6ème crise d’extinction de masse n’épargne pas nos amis à 6 pattes. Environ 40% des espèces d’insectes sont aujourd’hui en déclin, un tiers d’entre elles sont menacées de disparition et chaque année, 15 000 espèces de plus le deviennent [3].
Les principales causes du déclin des insectes sont : la perte de leur habitat à cause de la déforestation, l’intensification de l’agriculture, l’urbanisation ; la pollution et l’utilisation de pesticides et de fertilisants qui les tuent ; les facteurs biologiques comme les pathogènes et les espèces invasives ; et enfin, le changement climatique [3].
Vous pouvez lire notre article sur la biodiversité pour avoir plus d’informations sur ce sujet.
Déjà, car des insectes dépend notre alimentation ! Par leur rôle de pollinisateurs, les insectes assurent, en effet, la production d’au moins 30% des végétaux que nous consommons mondialement. La pollinisation assurée par les insectes permet également la survie de nombreuses espèces végétales sauvages, qui sont, elles-mêmes, à la base de la chaîne alimentaire et permettent la vie de nombreux animaux herbivores, qui eux-mêmes assurent la survie des carnivores.
Par ailleurs, les végétaux sont des puits de carbone : ils consomment du CO2 pour vivre et permettent ainsi d’aider à réguler le climat (on vous explique mieux dans notre article à ce sujet) ! Dans le contexte de réchauffement climatique actuel, nous n’avons pas envie de perdre une partie de nos puits de carbone.
En plus de la pollinisation, les insectes assurent d’autres fonctions très importantes dans les écosystèmes (et rendent ainsi des services écosystémiques). Ils dégradent les déchets produits par les autres organismes (déjections, carcasses, et déchets végétaux). En enterrant et dégradant cette matière organique, ils permettent aux sols d’être fertiles et aux élevages d’animaux domestiques de ne pas être des dépotoirs. Ce service qu’ils rendent est donc également essentiel à l’agriculture.
Les insectes permettent aussi de réguler les populations de ravageurs de cultures, qui sont certes d’autres insectes pour une large part, mais qui pourraient voir leurs populations augmenter si les insectes « amis des cultures » (ou auxiliaires) venaient à disparaitre.
Enfin, les insectes servent d’aliment à de nombreuses autres espèces : les oiseaux comme on l’a vu dans le guide naturaliste sur ces derniers, mais aussi d’autres vertébrés (amphibiens, mammifères comme les chauves-souris, hérissons, musaraignes…). Leurs larves aquatiques sont également la ressource principale de beaucoup d’espèces de poissons. Imaginer les conséquences d’un déclin trop important des insectes donne le vertige. Bon, alors, qu’est-ce qu’on fait pour les aider ?
ici on prend volontairement un point de vue "anthropocentré", c'est à dire que l'on se demande en quoi un tel déclin est alarmant pour les humains. Mais il est intéressant d'aussi de se rappeler que la perte de biodiversité, qu'elle ait des effet néfastes pour les humains ou non est un problème. Pourquoi, pour vivre, les humains devraient-ils être responsable du déclin des autres ?
Depuis ces dernières années, on voit apparaitre dans beaucoup de magasins et de jardins des « hôtels à insectes ». Mais qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des abris qui ont pour but d’attirer les insectes auxiliaires dans notre jardin, leur procurant un habitat où nicher et se reproduire. Ils sont souvent constitués de différentes « cases » qui abritent différents types d’éléments (des pommes de pin, des branches, des planches percées, des tubes de bambou, des briques…).
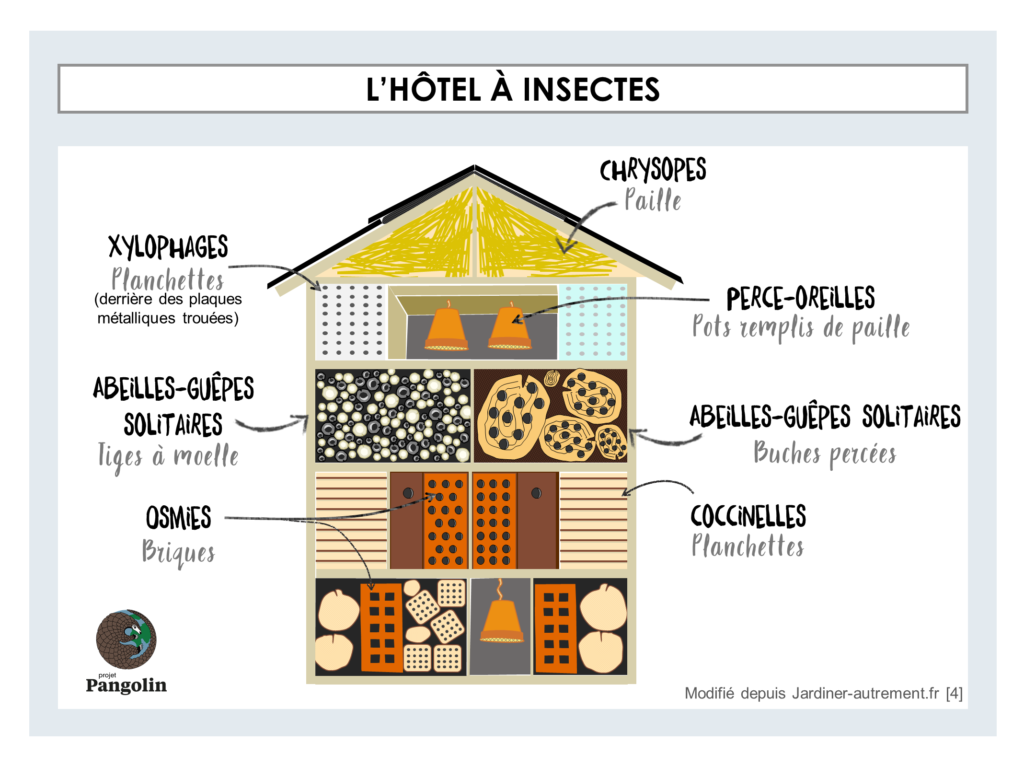
Comme vous vous en doutez, en matière d’écologie, rien n’est jamais simple. Les hôtels à insectes tels que vendus dans le commerce présentent un certain nombre de désavantages et sont rarement utilisés correctement. Ils sont plus pédagogiques qu’utiles à la biodiversité.
Tout d’abord, l’idée d’attirer et de faire loger toutes ces différentes espèces au même endroit est une fausse bonne idée. Dans la nature, tous ces organismes ne vivent pas dans le même immeuble et il y a de bonnes raisons pour cela.
Leurs nids sont petits et séparés, ce qui leur permet de ne pas se gêner et évite également la circulation des pathogènes et parasites d’un nid à l’autre. De plus, si un prédateur (par exemple, un oiseau) repère le grand hôtel à insecte et vient s’y restaurer : il va tout décimer d’un coup !
Si l’on souhaite héberger différentes espèces, il va donc plutôt falloir construire plusieurs abris différents que l’on disposera à différents endroits de notre jardin ou balcon. La première étape sera donc de se renseigner sur quels insectes vivent par chez nous, réfléchir à ceux que l’on voudrait abriter et ensuite, déterminer de quels types d’abris et d’habitats ils ont besoin.
En consultant le site de Promesse de fleurs, on apprend par exemple que pour aider les perce-oreilles, on utilisera un pot en terre cuite que l’on remplira de paille et que l’on suspendra dans un arbre (par exemple, un fruitier).
Pour les abeilles et guêpes solitaires, ainsi que pour les osmies, on prévoira des bûches ou planches épaisses que l’on percera de trous de différents diamètres (pour accueillir différentes espèces), ou encore des fagots de tiges creuses (par exemple bambou ou roseaux) ou de tiges à moelle (sureau, ronce, rosier).
On s’arrête ici mais ce n’est pas une liste exhaustive des abris que l’on peut construire ! Vous pouvez trouver plus d’informations sur internet, mais comme toujours : ayez un esprit critique et croisez vos sources afin d’être surs de ne pas faire de bêtises !
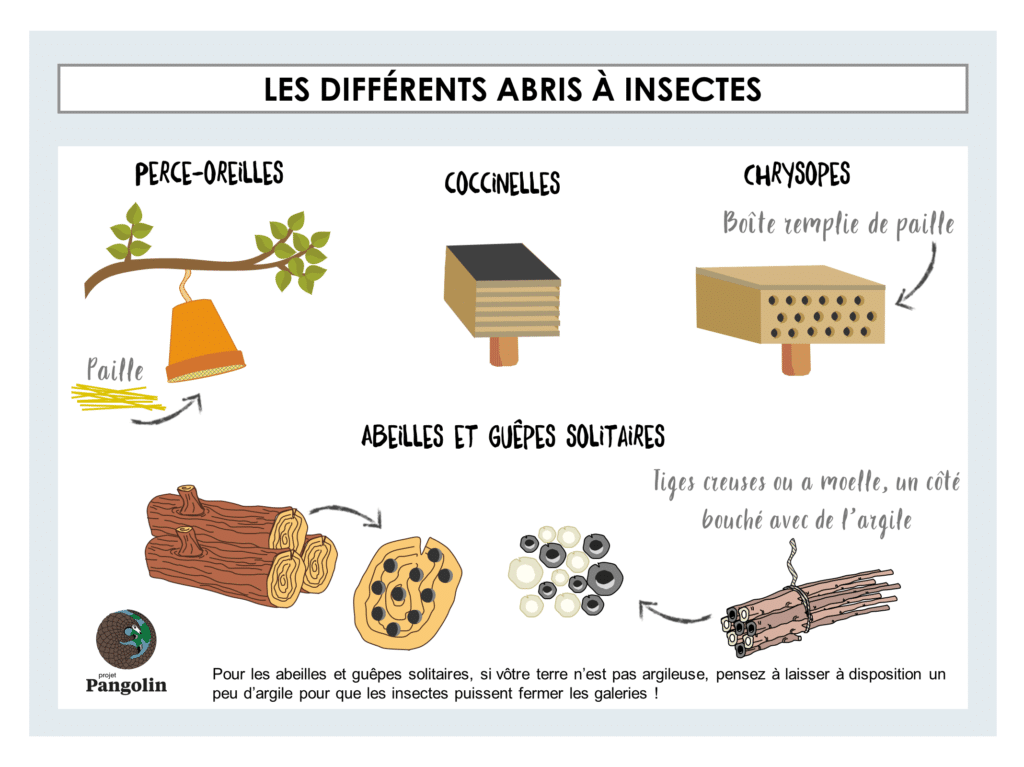
Attention à utiliser des matériaux naturels et non traités pour la construction de vos abris. Les traitements chimiques des matériaux (souvent avec des insecticides) seraient néfastes aux insectes. Renseignez vous sur les espèces qui vivent chez vous pour savoir quel diamètre de trou percer dans les essences de bois.
Une fois nos abris construits, on devra choisir avec précaution l’endroit où on les place. Un endroit calme du jardin, avec un accès facile pour se poser (pas de branches et feuilles qui gênent), avec une orientation vers le sud ou le sud-est (pour le soleil, les insectes sont ectothermes, leur température corporelle dépend de la température ambiante) et abrités du vent et de la pluie.
Il faut ensuite ne pas oublier d’entretenir nos abris. Pour ceux contenant de la paille : on devra changer la paille. Pour ceux avec des trous ou tiges bouchés à l’argile, si à la fin de l’été certains sont encore bouchés, il faudra vider le contenu de ces cavités (ou les remplacer si ce sont des fagots de tiges creuses).
Enfin, disposer des abris à insectes dans un jardin qui ne contient aucune ressource est inutile ! Il nous faut alors prévoir de quoi nourrir et abreuver les insectes (des fleurs à pollen et nectar, des réserves d’eau). On évite aussi bien sûr l’usage de pesticides (insecticides mais aussi fongicides et herbicides), qui vont décimer les insectes.
Bon, tout ça mis bout à bout, avoir des abris à insectes semble un peu fastidieux, non ? Surtout si l’on veut accueillir plusieurs espèces et faire les choses correctement. N’y a-t-il pas plus simple ?
Heureusement, si ! On peut tout simplement veiller à avoir un jardin qui soit favorable aux insectes : plus besoin d’abris, ils seront naturellement présents ! Découvrez avec nous comment faire ci-dessous.
Comment faire pour attirer l’entomofaune dans son jardin ? Rien de très sorcier : il faut s’assurer que notre jardin offre des abris et des ressources aux insectes. Le moyen le plus simple : ne rien faire. Laisser la nature s’installer toute seule, la flore indigène attirera naturellement les insectes et lui fournira des abris.
Bon, vous n’avez pas envie de voir votre jardin se transformer en jungle sauvage ? Vous pouvez quand même aider !
D’abord, sans laisser tout le jardin en friche, on peut décider de laisser une partie vierge de toute intervention.
Dans la partie « gérée », on peut choisir de planter des fleurs mellifères et nectarifères locales (car les espèces d’insectes locales ont besoin de leurs ressources locales). On pourra alors se renseigner sur quelles espèces d’insectes vivent chez nous et quelles sont les plantes dont elles raffolent.
Pour cela, on peut vous conseiller ce document de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ou encore les sites de Jardiner autrement ou Terre vivante. On y apprend par exemple que pour favoriser les syrphes, on choisira de planter des coquelicots, de la menthe, des pâquerettes… Pour les coccinelles, se sera des orties, du sureau, des molènes ou encore du fenouil.
On peut aussi penser à planter des végétaux qui fleuriront à différents moments de la saison, comme ça on s’assure de proposer des ressources en continu.

Par exemple, un tas de compost, des tas de feuilles mortes (qui enrichissent le sol et servent d’abri pour l’hiver, et peuvent en plus servir à pailler le potager !), des tas de bois mort laissés çà et là, des tas et murs en pierres …
Les haies sont aussi un outil écologique important. Elles abritent du vent, retiennent l’humidité et permettent de créer des microclimats favorables. On peut mettre plusieurs espèces d’arbres et arbustes dans sa haie pour pouvoir accueillir différentes espèces (fruitiers, baies, mais aussi arbustes à fleurs comme les rosiers). Ici encore, favorisons les essences locales.
De la même manière, ne tondez pas trop souvent ou trop ras, une tonte raisonnée permet de protéger la biodiversité. On laisse un peu de hauteur (6-8 cm), on ne tond pas tout le jardin en même temps, on laisse les résidus de tonte sur place (ou on s’en sert pour pailler les plantes et potagers).
Vous pouvez retrouver des conseils fournis par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ici. Au lieu de tondre, on peut faucher (c’est-à-dire, couper, et tardivement, pour laisser les refuges et ressources aux insectes plus longtemps !).
On a beaucoup parlé nourriture et abris, mais n’oublions pas la boisson ! On peut laisser de l’eau dans nos coupelles de pots de fleurs, mettre des points d’eau exprès (de faible profondeur et avec des cailloux au fond, sinon c’est la noyade).
Attention avec les abreuvoirs pour celleux vivants dans des zones à moustiques ! Les larves de ces derniers se développent dans l'eau stagnante, alors on évite dans ces régions ou bien on veille à changer l'eau très régulièrement pour ne pas être envahis !
De nombreuses larves d’insectes vivent dans le sol (par exemple, les perce-oreilles, la grande sauterelle…), pour garder un sol vivant, on ne le laboure donc pas ! On peut aussi creuser une marre, car de nombreuses espèces ont des larves aquatiques (comme les libellules).
Bien sûr, on proscrira les pesticides du jardin (et même à la maison), ou en tout cas, on limitera au maximum leur usage, et on ne s’en servira pas partout ! Leur pouvoir toxique est souvent à large spectre : ils ne ciblent pas un insecte mais tuent tous ceux qui sont en contact, auxiliaires comme ravageurs.
Pour conclure sur tout ça, les mots-clés d’un jardin insecte-friendly sont : naturel, sauvage (gestion modérée et raisonnée), hétérogène (différents milieux, différentes ressources) et non traité. Et en plus, c’est super joli !
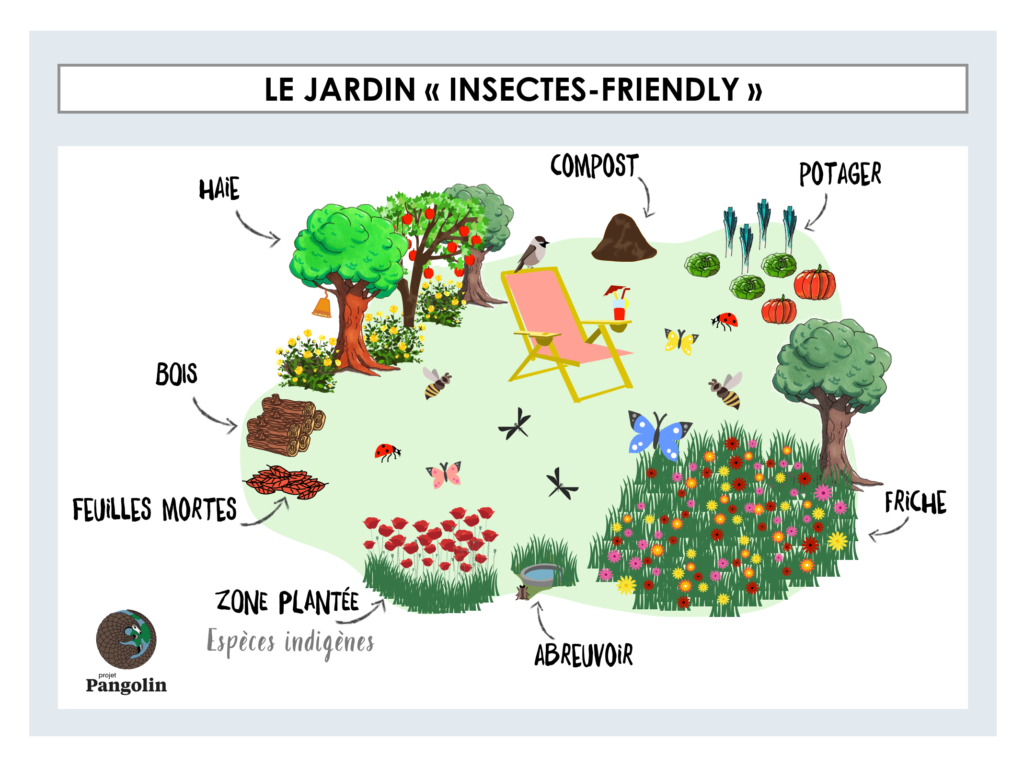
[1] Insect Biodiversity: Science and Society (2009) Footit RG & Adler PH, Eds. Blackwell Publishing Ltd. doi: 10.1002/9781444308211
[2] Numbers of Living Species in Australia and the World, 1st edn (2006) Chapman AD, Ed. Australian Biological Resources Study. ISBN: 9780642568502
[3] Sánchez-Bayo F, Wyckhuys KAG (2019) Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological Conservation 232: 8–27.
[4] Jardiner autrement – Construire un hôtel à insecte
Smith MR, Singh GM, Mozaffarian D, Myers SS (2015) Effects of decreases of animal pollinators on human nutrition and global health: a modelling analysis. Lancet 386: 1964–72.
Biesmeijer JC, Roberts SPM, Reemer M, Ohlemüller R, Edwards M, Peeters T, Schaffers AP, Potts SG, Kleukers R, Thomas CD, Settele J, Kunin SWE (2006) Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands. Science 313: 351-353.
Danièle Boone, Tribune Reporterre, 2019.
Jean-Baptiste Veyrieras, Journal du CNRS, Déclin des insectes : l’urgence d’agir.
Jardins de Noé, Laisser des abris naturels pour la faune du jardin
Marc Carlton, The Pollinator Garden, Make a bee hotel
Jo-Lynn Teh-Weisenburger, The entomologist lounge, Insect Hotels: A Refuge or a Fad?
Aquarelles : Lisa Nicvert – Licence CC-BY-SA 4.0
Photographies © Vincent Lhuillier – Autorisation spéciale pour le Projet Pangolin
Photographies autres :
Ces dernières années, on entend très souvent les termes “empreinte carbone” ou “bilan carbone”. Ces mots sont partout. iIls reviennent à toutes les sauces et dans tous les contextes.
Dans cet article nous commencerons par définir des termes importants pour la compréhension globale de cette thématique comme « GES », « effet de serre » ou « tonne équivalent carbone »
Ensuite nous entrerons dans le vif du sujet en décortiquant les concepts d’empreinte carbone, empreinte écologique et bilan carbone.
Ce sujet est un peu compliqué et utilise des termes particuliers. Restez avec nous pour un déchiffrage de tout ce jargon ! Si vous êtes familiers de ces questions, on se retrouve un peu plus bas.
Les gaz à effet de serre (ou GES) sont des gaz présents dans l’atmosphère. Ils sont responsables de l’effet de serre. Par sa composition, l’atmosphère “retient”, en effet, plus ou moins de “chaleur” sur la surface de la planète et permet donc de “réguler” la température.
Une partie de l’énergie reçue par le soleil est directement réfléchie par l’atmosphère et les surfaces claires de la planète (par exemple, les banquises) et renvoyée dans l’espace : c’est l’albédo. Grâce à cela, il ne fait pas trop chaud et les UV sont filtrés. Le reste est absorbé par la surface de la planète. S’ensuivent ensuite des échanges de rayons infrarouges entre surface et atmosphère. C’est grâce à cela qu’il ne fait pas trop froid non plus. Ces effets combinés de l'atmosphère permettent la vie sur Terre. Les GES, selon leurs concentrations, vont impacter la quantité d’infrarouges (et donc de chaleur) qui est renvoyée sur la surface de la planète, impactant ainsi la température.
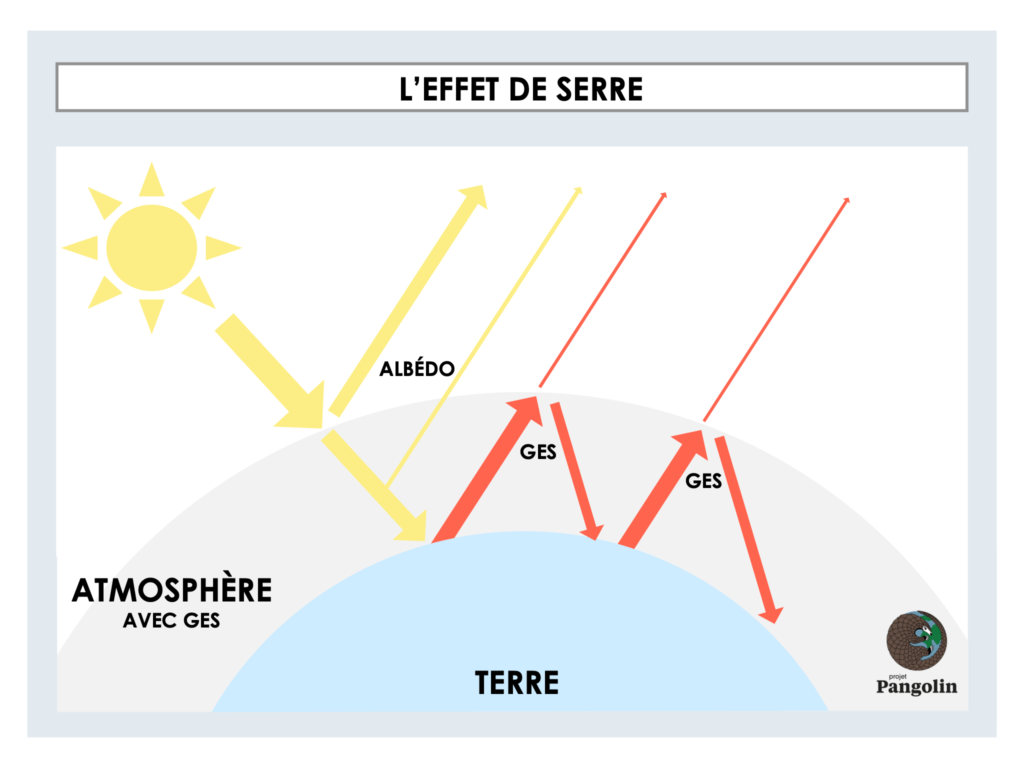
Les principaux GES naturels sont (par ordre d’importance) :
Les gaz à effet de serre sont donc présents naturellement dans l’atmosphère et sont essentiels à la survie des espèces.
C’est quoi le problème alors ? Le problème c’est que depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont fait augmenter de manière exponentielle la concentration des GES dans l’atmosphère augmentant ainsi l’effet de serre et causant le réchauffement climatique [1]. On parle d’effet de serre « anthropique », qui s’ajoute à l’effet de serre naturel.
Grâce à l'absorption par des "puits" des GES émis naturellement, les concentrations GES dan l'atmosphère étaient régulés avant que les humains ne mettent le bazar. Les océans, la photosynthèse, l'activité des micro-organismes sont des puits de carbone.
Il est important de le savoir afin de pouvoir agir dessus ! Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a répondu à cette question pour nous. Leur analyse des émissions de GES par secteur économique nous révèle que l’un des principaux chevaux de bataille est l’énergie, et en particulier, les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel).
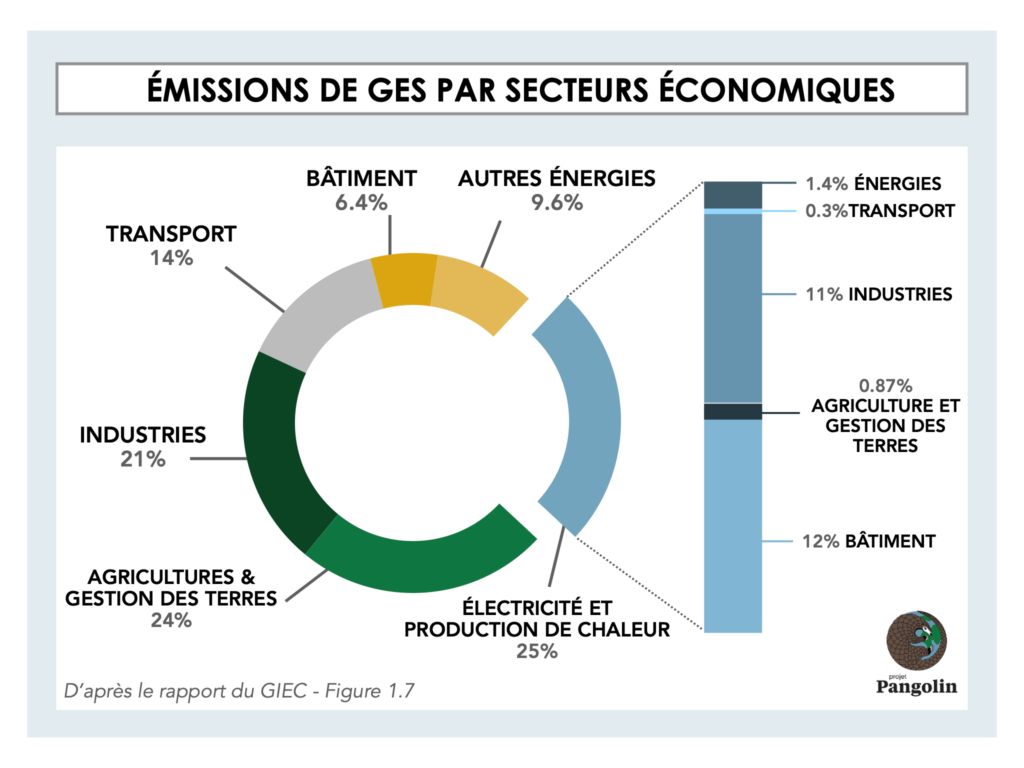
La combustion des énergies fossiles est par exemple responsable d’une très grande partie de nos émissions de CO2. Leur extraction, transport et utilisation est aussi la seconde source principale de méthane. Les énergies fossiles servent à tout un tas de choses, comme à la production d’électricité, de carburant ou encore au chauffage des bâtiments (chauffage au gaz). Ces ressources sont utilisées dans TOUS les autres secteurs (industries, transport, agriculture, services, logements...) qui relâchent eux même du CO2.
L'électricité n'est pas une énergie mais est produite à partir d'énergies. En France, elle est majoritairement produite à partir du nucléaire (~70%). Mais elle peut être produite à partir d'énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne) ou à partir d'énergies fossiles (cad énergies dont le stock est épuisable par exemple le pétrole).
C’est la source principale de méthane et de N2O. Ces émissions sont dues à l’élevage des animaux destinés au secteur alimentaire (viande mais aussi lait et produits dérivés tels que le fromage, les yaourts etc.), à la culture du riz qui nécessite l’inondation des terres, ainsi qu’à l’utilisation d’engrais azotés. Il faut ici préciser qu’en plus, les activités humaines impactent les puits naturels de GES (via la déforestation par exemple), réduisant ainsi la quantité de GES atmosphériques réabsorbée. Le serpent qui se mord la queue en somme.
Ces deux secteurs sont responsables à eux seuls de 50% de nos émissions de GES. Et la France ne fait pas exception à ce schéma. Viennent ensuite l’industrie et le transport.
L’industrie est à l’origine d’émissions de GES dits « industriels », c’est-à-dire qui n’ont pas de sources naturelles, comme les halocarbures. Ces gaz sont émis lors de processus industriels comme la combustion de carburants fossiles, le traitement des eaux usées et beaucoup en raison des fuites présentes dans les systèmes de refroidissement. Ils sont en effet utilisés dans tous les systèmes produisant du froid. De notre frigo/congélateur, à la climatisation de nos voitures et bâtiments, en passant par le refroidissement nécessaire aux data center dont nous vous parlions dans notre article sur la pollution numérique. Bien que le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali prévoient une disparition future des CFC (responsables du "trou" de la couche d'ozone) et HFC (fort pouvoir de réchauffement global, on vous explique ci-dessous), ils sont encore largement émis et ont impact considérable sur le changement climatique.
Avant de vous parler de l’empreinte carbone, nous devons vous parler de l’unité principalement utilisée pour la quantifier : la tonne équivalent carbone.
En fait, “l’empreinte carbone” ne concerne pas que le carbone (et donc le CO2). Mais bien tous les GES émis par diverses sources au sein d’un territoire. Mais pourquoi parle-t-on d’empreinte carbone si elle ne concerne pas que le carbone ?
Les scientifiques ont choisi de se concentrer sur le CO2 car c’est le gaz le plus émis. On convertit donc les émissions de tous les autres GES en « équivalent CO2 ». C’est-à-dire, en la quantité de CO2 qui aurait le même impact climatique que la quantité de GES x ou y réellement émise. Dans cette conversion on prend en compte le pouvoir de réchauffement global (PRG) des différents gaz, qui dépend de leur durée de persistance dans l’atmosphère et de la quantité d’énergie qu’ils absorbent (et donc renvoient sur Terre sous forme de chaleur).
En effet, tous les GES ne réchauffent pas autant les uns que les autres. On estime par exemple que sur une période de 100 ans, l’émission d’une tonne de méthane aura des effets sur le changement climatique équivalents à ceux qu’aurait l’émission d’environ 25 tonnes de CO2 (1 tonne de méthane = 25 tonnes équivalent CO2, et 1 tonne de N2O = 300 tonnes équivalent CO2 !).
L’utilisation de la tonne équivalent CO2 permet donc d’avoir une unité unique et commune et de comparer les effets des différents GES.
L’empreinte carbone c’est la quantité de GES émise par les activités humaines, exprimée en équivalent carbone (ou « eqCO2 », « CO2e », « CO2-eq »). Elle peut être calculée pour un individu, une entreprise, à l’échelle d’un pays, pour un objet ou un service. Sa valeur finale va dépendre de ce que l’on considère dans le calcul.
Si l’on prend l’exemple d’un pays et la définition de l’INSEE, il faudra tenir compte :
Au niveau individuel, elle dépend du pays de l’habitant et des choix de ce pays en termes de production d’énergie mais aussi du mode de vie global de l’individu (on vous en dit plus ci-dessous).
Lorsque l’on raisonne à l’échelle d’un objet, on va pouvoir tenir compte :
En bref, tout son cycle de vie.
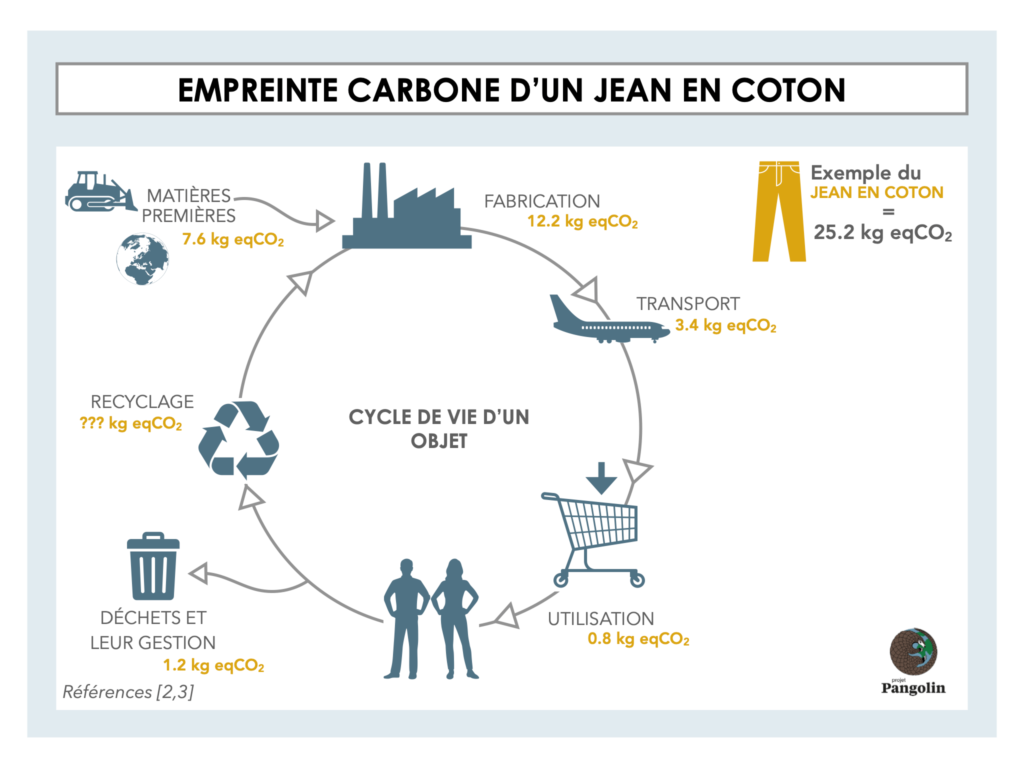
On retrouve l’empreinte carbone sur les “étiquettes GES” (ou “étiquettes climat”) des logements. Ces étiquettes permettent d'attribuer une note de A à G à nos habitations. Elles constituent un indice d’émission de gaz à effet de serre. Elles sont accompagnées des étiquettes “classes énergétiques” qui nous renseignent sur la consommation en énergie du logement (ou de tout autre appareil électroménager ou véhicule vendu dans le commerce).
Tous les pays ne sont pas autant émetteurs de GES les uns que les autres. Nous allons nous intéresser à l’empreinte carbone de la France en comparaison avec 9 autres pays/régions du monde parmi les plus émettrices de GES.
Sur le graphe ci-dessous on remarque que la Chine est en tête, suivie par les US. Les autres émetteurs principaux tels que l’Inde, la Russie ou l’Indonésie viennent ensuite. La France ne semble pas faire partie des plus gros émetteurs. (le graphique a été créé grâce au site ClimateWatch, sur lequel vous pouvez aussi aller vous amuser à regarder les pays qui vous intéressent).
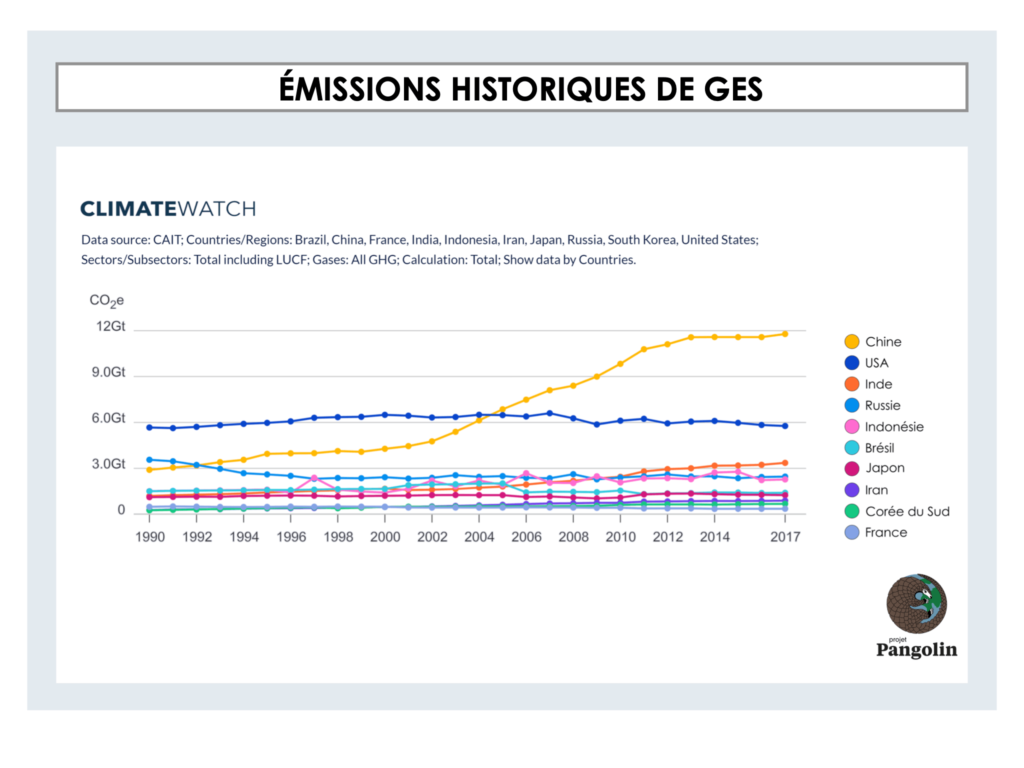
Mais il faut, ici, faire marcher son esprit critique. Ces chiffres veulent-ils dire que la France s’en sort bien ? En réalité, ce n’est pas si simple. Décortiquons tout cela ensemble.
La Chine produit énormément de biens (produits informatiques et téléphonie, vêtements et autres objets “made in China”) qu’elle exporte. Ainsi, la consommation du reste du monde a un effet sur les émissions de GES en Chine ! Nous y compris, même si de prime abord “on ne s’en sort pas si mal”.
C’est pour cette raison que l’empreinte carbone d’un pays doit tenir compte des importations. Sans cela, les pays comme la France, en délocalisant une grosse partie de leurs industries apparaîtraient faussement “verts”. Il en va de même pour l’électricité, la nourriture et tout un tas d’autres choses que l’on importe. De plus, tous les pays n’ont pas le même nombre d’habitants et ne font pas la même taille ! Il est logique qu’un pays dont la population représente 21 fois celle de la France, comme c’est le cas de la Chine, émette plus de GES.
L’empreinte écologique (ou empreinte environnementale) est un indicateur de l’effet des activités humaines sur la nature. Contrairement à l’empreinte carbone, elle n’est pas focalisée sur les GES. Elle considère l’impact environnemental plus global en comparant d’une part “la demande” (les activités humaines) et d’autre part “l’offre” (la capacité de la Terre à produire des ressources, à absorber des déchets et à se régénérer : la biocapacité).
L’empreinte écologique tient compte de :
Si on la représente par secteurs d’activités, on voit que, comme pour l’empreinte carbone, l’alimentation, les logements et les transports ont le plus d’impacts.
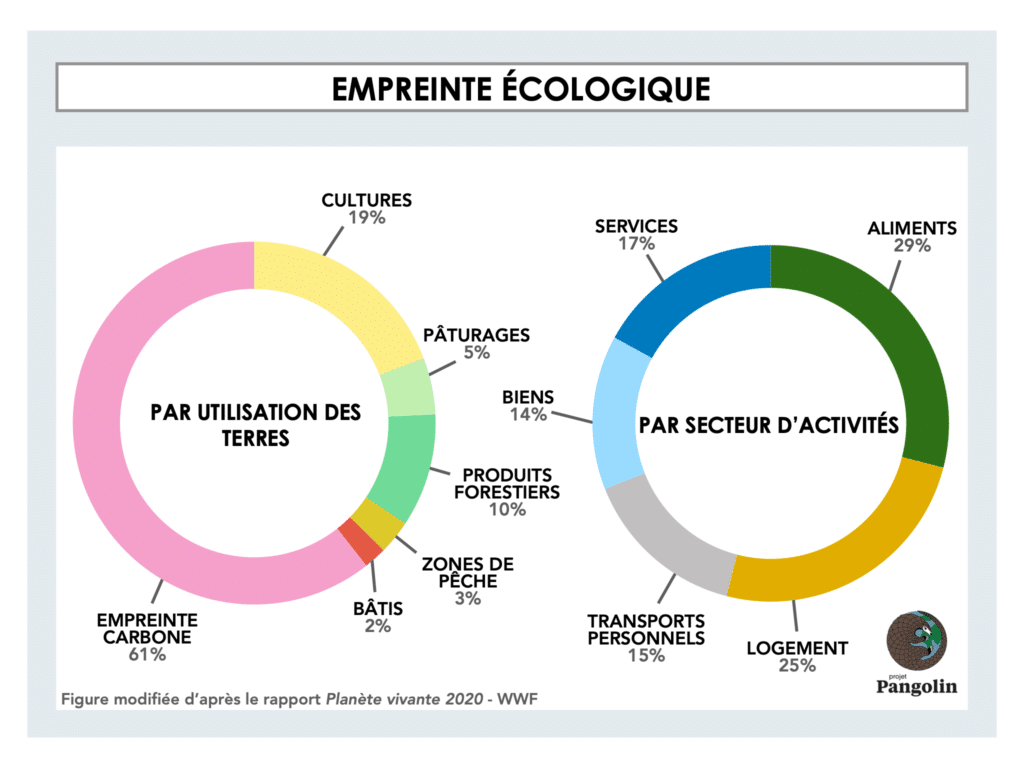
L’empreinte écologique est exprimée en hectares (et non en équivalent CO2) puisqu’elle mesure la superficie biologiquement productive nécessaire pour soutenir la consommation humaine.
Ainsi, pour subvenir aux besoins de l’humanité, la WWF (ONG “World Wide Fund for Nature”) estime qu’il faudrait la superficie de 1.6 Terres. C’est de là que vient le « jour du dépassement » de l’ONG Global Foodprint Network, qui nous donne le jour de l’année à partir duquel on a consommé toutes les ressources que la Terre pouvait produire en 1 an et que l’on vit donc en puisant dans les réserves (à crédit).
Comme le révèle la WWF dans son rapport “Planète vivante 2020”, l’empreinte écologique ne fait qu’augmenter au fil des années, tout comme l’empreinte carbone. Et comme pour cette dernière, vous pouvez calculer votre empreinte écologique personnelle.
Attention, il faut ici aussi se rappeler que tous les pays et tous les individus n'ont pas la même empreinte écologique. L'empreinte écologique d'un américain moyen serait de 8 ha alors que celle d'un congolais moyen est estimée à 0.8 ha. Données provenant de [4]
Le bilan carbone est une méthodologie de calcul développée par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) en 2004 pour mesurer l’empreinte carbone d’une entité, par exemple, d’un individu (on parle alors de “bilan carbone personnel”) ou d’une entreprise.
Mais, bilan carbone et empreinte carbone sont-ils synonymes ? Oui et non.
En effet, c’est un outil destiné aux entreprises et organisations qui souhaitent mesurer leur empreinte carbone. Il tient compte du secteur d’activité de l’entreprise et de nombreux éléments pour rendre son bilan. Il est aujourd’hui très connu car il est devenu obligatoire pour de nombreuses entreprises.
Si ces sujets et cet article vous ont intéressés, vous trouverez ici des pistes à creuser pour en apprendre plus sur le changement climatique et les impacts anthropiques. Par exemple, si l’on a beaucoup parlé ici des gaz à effet de serre, ce ne sont pas les seuls acteurs dans toute cette histoire. Les aérosols jouent aussi un rôle.
De la même manière, vous pouvez creuser les questions liées aux problèmes posés par la compensation carbone, en consultant entre autres cet article (et plus généralement le site) de « Bon Pote ». Ou en écoutant ce podcast.
Le podcast « Y’a le feu au lac » vous parle aussi des enjeux liés à la voiture électrique.
[1] IPCC Fifth Assessment Report, 2014
[2] https://www.liberation.fr/apps/2018/09/empreinte-carbone/
[4] https://data.footprintnetwork.org/#/
Dans cet article, je vais vous guider dans le monde des parasites, des virus et des guêpes. Nous commencerons par découvrir que des réalisateurs à succès se sont grandement inspirés de la vie réelle et n’ont rien inventé.
Ensuite, nous quitterons le cinéma pour retrouver la science. Nous définirons ensemble ce qu’est le parasitisme et plus particulièrement le parasitoïdisme. Nous verrons que la domestication ne rime pas toujours avec chiens ou chats mais peut aussi concerner des organismes microscopiques voir même une petite portion de leur ADN ! Pour cela je vous présenterais un exemple passionnant où se mêlent évolution des espèces et invasion des hôtes !
Enfin, nous verrons comment l’étude des systèmes biologiques peut permettre de répondre à des questions d’intérêt général au travers de l’étude d’un exemple particulier en lien avec le parasitoïdisme.
Imaginez-vous un instant à bord d’un vaisseau spatial de retour d’une mission commerciale de routine dérivant dans un espace vide et froid. Dix mois avant votre arrivée sur Terre, vous êtes tiré de votre léthargie par Mother qui n’est autre que l’ordinateur de bord. Elle détecte d’étranges signaux en provenance d’un planétoïde inconnu : LV-426.
Vous décidez de visiter cette planète et y trouvez un ancien vaisseau abandonné contenant d’étranges œufs parfaitement alignés. L’un de vos coéquipiers, un peu trop curieux, effleure l’un de ces œufs étranges et déclenche alors son éclosion. Une créature grêle et osseuse bondit et s’empresse de percer le scaphandre de l’homme pour s’accrocher à sa bouche avec vivacité. Vous venez de faire la rencontre des Facehuggers !
Aussitôt, vous reconduisez votre coéquipier au vaisseau pour décrocher cette créature de son visage, mais rien n’y fait. L’homme est plongé dans un profond coma. Quelques jours plus tard, vous assistez avec effroi au réveil de votre coéquipier. Il agonise. Une étrange créature semble vouloir s’extirper de son corps. Après quelques secondes de cris abominables, une tête sombre et élancée surgit de la cage thoracique de votre ami. C’est à ce moment précis que vous comprenez que le signal n’était pas un appel à l’aide, mais une mise en garde. Il est maintenant trop tard, l’horreur est en marche …
Arrêtons-nous là avec ces histoires effrayantes ! Les amateurs de films de frissons auront reconnu la célèbre saga Alien. Toute droit sortie de l’imaginaire débordant de H.R Giger et produite par Ridley Scott en 1979 ! Dans ce film, d’étranges créatures, appelées des Xenomorphes ou Aliens, mènent la vie dure aux astronautes. Et pour cause, il s’agit de créatures qui ont besoin d’autres organismes vivants pour compléter leur propre cycle de vie. Vous pourriez être apeuré par cette vision horrifique, et vous auriez sans doute raison de l’être. Mais que diriez-vous si je vous assurais que notre monde, bien réel, regorge de créatures ayant un mode de vie similaire aux Aliens ?
Vous les avez toutes et tous croisé au moins une fois dans votre vie : les insectes parasitoïdes ! Ce mot est peut-être tout nouveau pour vous, alors nous allons nous attarder un peu sur sa définition.
Un parasite désigne une espèce qui profite d’une autre à ses dépens. Parfois sans tuer l'organisme hôte, le parasite de la malaria appelé Plasmodium, les poux ou bien le VIH sont des exemples de parasites.
Un insecte parasitoïde désigne un cas particulier de parasites dont les larves se nourrissent de l’intérieur ou sur le corps d’autres insectes. Les larves du parasitoïde consomment donc leur hôte (hé non, on ne parle même pas d’extra-terrestres là !).
On retrouve de nombreuses espèces dites parasitoïdes dans le monde vivant. Ce mode de vie est très représenté au sein de l’ordre des Hyménoptères (guêpes, abeilles, fourmis). Ces guêpes dites parasitoïdes n'ont rien à voir avec celles de couleurs jaunes et noires que l’on connaît bien. Il s’agit d’insectes de petite taille, pouvant être assez minuscule pour passer à travers le chas d’une aiguille ! Les plus grosses ne dépassent que très rarement les 5 cm.
Dans la suite de cet article, nous allons nous concentrer particulièrement sur ces très petites guêpes. Ce groupe d’insecte est considéré comme le plus diversifié. Il regroupe plus d’un million d’espèces différentes [1,2,3]. C'est le groupe le plus complexe sur le plan taxonomique et le plus important sur le plan économique. En effet, il contient de nombreuses espèces pollinisatrices qui tuent naturellement d’autres insectes ravageurs de cultures.
Il existe de nombreux types de guêpes parasitoïdes. Certaines ont des cycles de vie extrêmement complexes et intéressants. Comme par exemple des espèces capables de se reproduire sans l'aide des guêpes mâles [4]. Certaines espèces produisent plusieurs générations de descendants en une seule saison, d'autres mettent plus d'un an à développer un seul adulte.
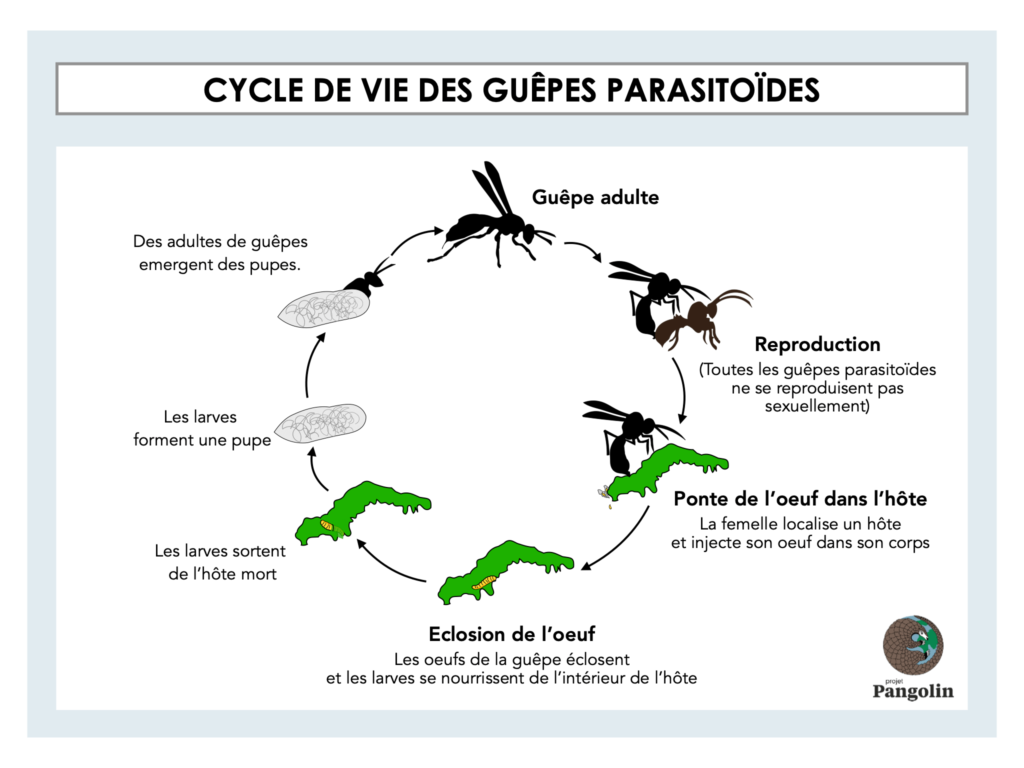
Cependant, nous pouvons dire qu'en général, les guêpes parasitoïdes suivent un cycle de vie complet comprenant : œuf, larve, pupe et adulte. Comme décrit sur ce schéma, après accouplement la femelle dépose ses œufs à l’intérieur d’un hôte. Certaines guêpes déposent les œufs sur l’hôte, ils se développent alors attachés à sa peau. Les œufs se développeront dans cet environnement particulier pour donner des larves. Puis, ces larves sortiront de l’hôte pour former une pupe (l’équivalent de la chrysalide chez les papillons) et enfin des adultes émergeront de ces pupes.
Le saviez-vous ? Les hôtes de ces guêpes sont extrêmement variés. En effet, tous les insectes sont susceptibles d'être parasitoïdés par une guêpe parasitoïde. En effet, même une guêpe parasitoïde peut être parasitoïdée ! On appelle alors cela de l'hyper parasitoïdisme.
Cela ne vous aura pas échappé. S'imaginer une seconde que nous puissions être les hôtes de ces parasitoïdes suffit à donner la nausée. Ces guêpes parasitoïdes présentaient d'ailleurs un style de vie suffisamment « atroce » pour que Charles Darwin lui-même les cite comme une remise en question à l’existence de Dieu.
Darwin avait donc une certaine difficulté à imaginer que des espèces qui se nourrissent du corps vivant de chenilles puissent avoir été créées par un dieu bon et aimant. Et pour cause, cette stratégie analogue à celle des Aliens, aussi horrible soit-elle à nos yeux, est le fruit de millions d’années d'évolution qui ont doté certains organismes de cette fascinante manière de survire : le parasitoïdisme !
Quittons maintenant cette ambiance sombre et lugubre et rapprochons-nous de la beauté du réel. Nous allons comprendre comment ces créatures survivent depuis 250 millions d’années grâce au parasitoïdisme.
Pour ce faire, nous devons nous intéresser à leur biologie et décortiquer les interactions qu’elles entretiennent avec leurs hôtes. Afin de simplifier le discours, nous vous proposons une BD récapitulative. Vous allez voir, ces guêpes parasitoïdes nous réservent bien des surprises !
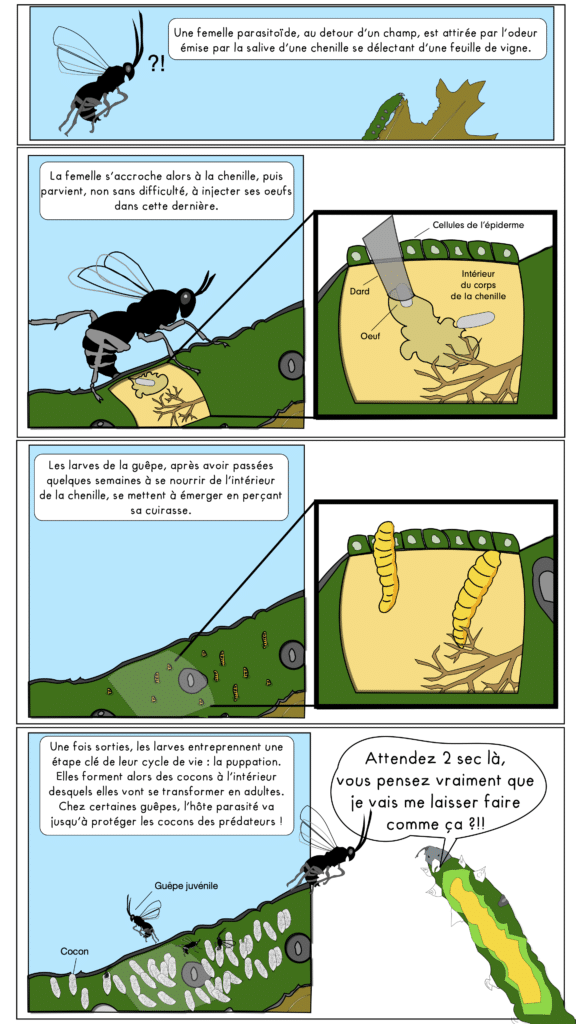
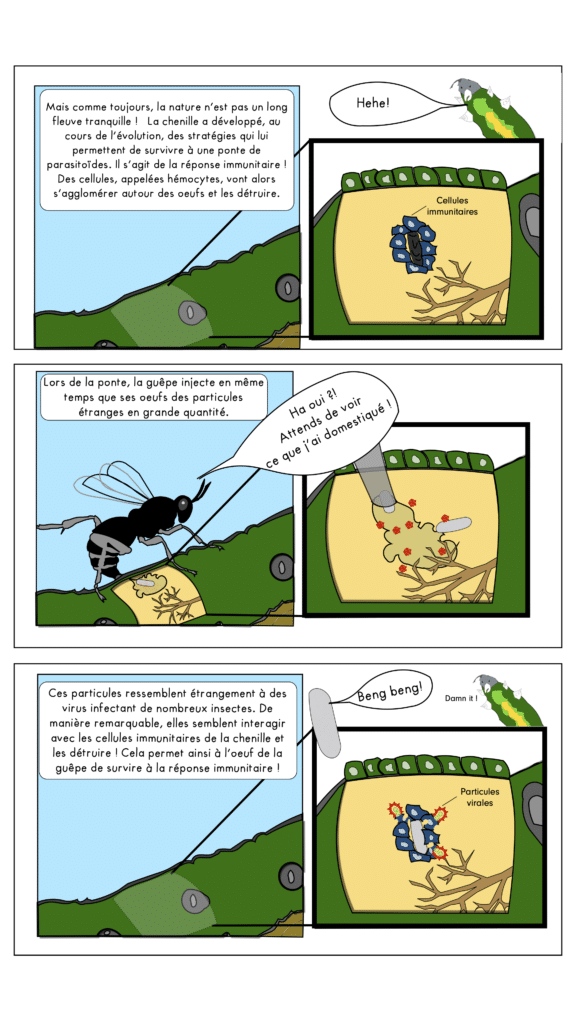
La lecture de cette courte bande dessinée vous a permis d’en apprendre un peu plus sur ces guêpes parasitoïdes. Mais elle a surement engendré de nombreuses questions ! Vous êtes alors au même stade de compréhension que les scientifiques des années 1970. En effet, à l’époque, personne ne savait réellement quelles étaient ces étranges particules injectées par les guêpes dans les chenilles…
Comme nous l’avons vu dans la BD, on s’attend à ce que la chenille développe des stratégies pour contrer la ponte de la guêpe. Autrement, elle meurt. Ainsi, tout comme nous, lorsque la chenille va être attaquée par un corps étranger, une réponse immunitaire va être activée pour détruire le corps étranger : ici les œufs de la guêpe. Bien évidemment, une telle manœuvre va être délétère pour la guêpe puisque ses descendants ne pourront pas vivre et propager son patrimoine génétique.
Au cours de l’évolution, de nombreuses stratégies ont alors été adoptées par les guêpes pour garantir la survie de leurs petits. Par exemple, certaines guêpes ont développé un venin qui permet de paralyser les hôtes et de dégrader leur système immunitaire. Plus récemment, des chercheureuses ont découvert que certaines guêpes ont domestiqué des virus pour lutter contre le système immunitaire des chenilles ! Et oui ces particules que vous venez dans la BD sont des virus ! Mais que font-ils dans le corps des guêpes, d’où proviennent-ils et quelles sont leurs fonctions ?
Les chercheurs ont testé l’effet de ces virus sur les chances de survie des œufs de guêpe. Ils ont alors découvert que ces particules, une fois injectées dans le corps de la chenille, apportaient un avantage remarquable à la survie des descendants des guêpes [7]. Ces particules virales protègent donc les œufs des guêpes de la réponse immunitaire de la chenille !
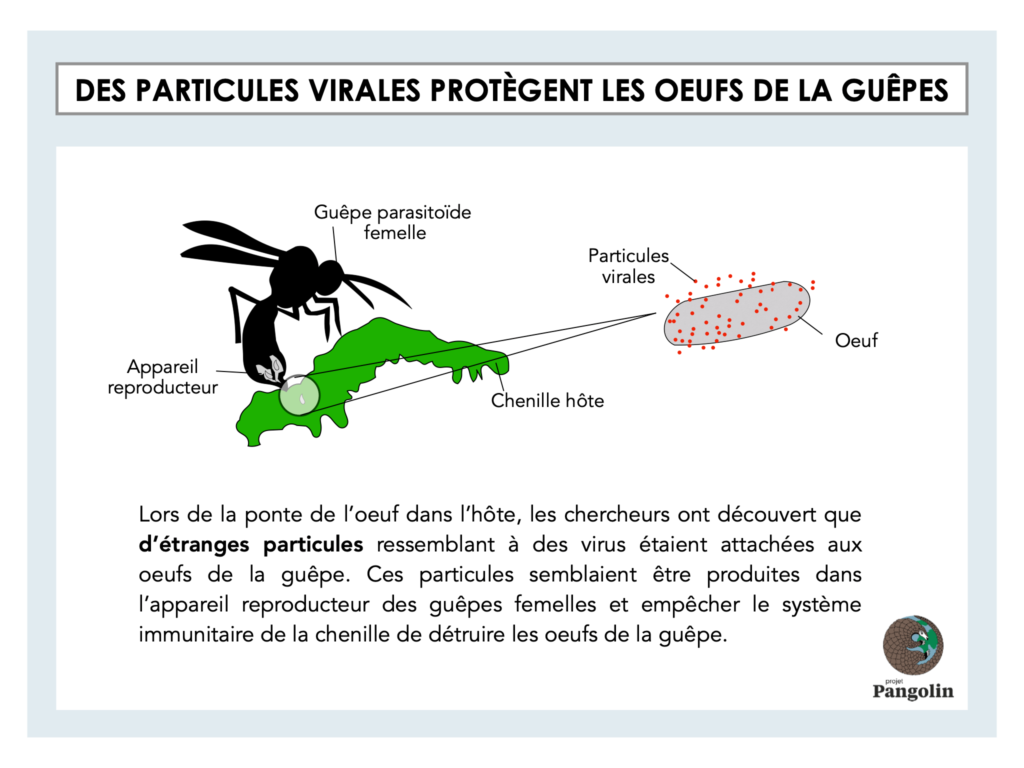
Ces particules aussi baptisées polyDNAvirus [6] ne sont pas des virus comme les autres. Il s’agit en réalité de chimères entre des structures virales et des structures propres à la guêpe ! En effet, si nous regardons de plus près ces particules et que nous les comparons à des virus classiques, nous nous apercevons de quelques différences :
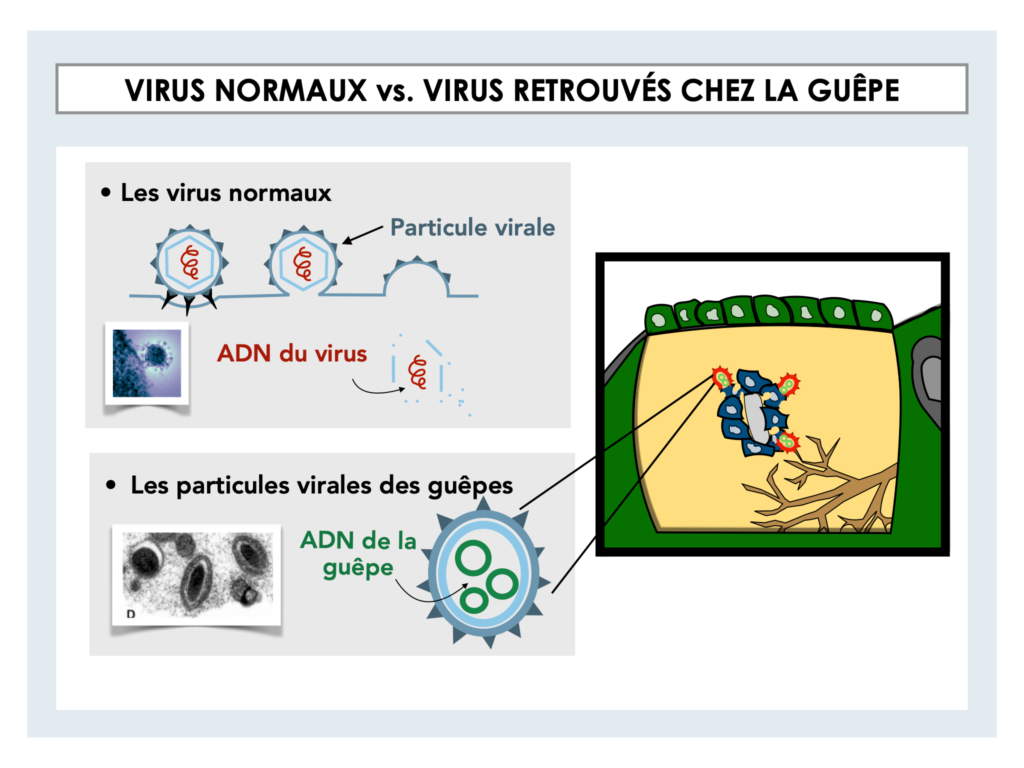
Au lieu d’avoir des gènes de virus à l’intérieur de ces véhicules (en rouge), ce sont plutôt des gènes de la guêpe qui sont intégrés (en vert). Ces polyDNAvirus sont donc l’assemblage de parties du génome d’une guêpe et d’un virus.
nous allons maintenant nous demander comment elles font pour désactiver le système immunitaire des hôtes ? Quelle est la fonction de ces particules virales et des gènes qui sont à l’intérieur ? Et hop, une seconde BD !
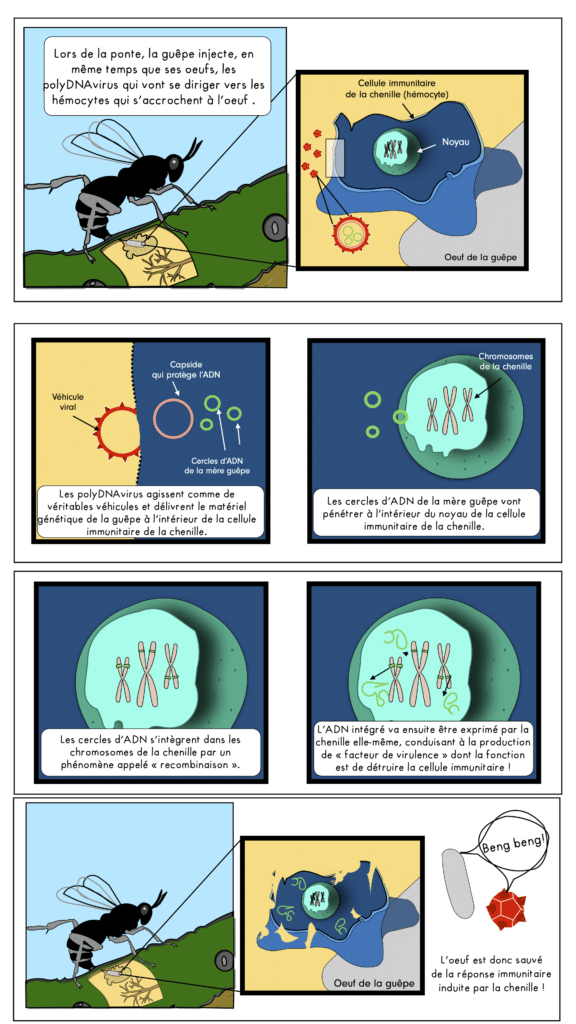
Non vous ne rêvez pas, ces particules virales injectées par la femelle parasitoïde font de la thérapie génique ! Pour celles et ceux qui ne seraient pas familier avec ce terme il s’agit d’une technique expérimentale bien connue en médecine qui vise à utiliser des gènes pour traiter ou prévenir une maladie. À l'avenir, cette technique pourrait permettre aux médecins de traiter une maladie en insérant un gène dans les cellules d'un patient au lieu de recourir à des médicaments ou à de la chirurgie.
Si vous comprenez ce qu’est la thérapie génique, alors vous comprenez comment ces particules virales détruisent les cellules immunitaires de l’hôte. Tout simplement en servant de véhicule à des gènes de la guêpe qui s'intégreront dans les cellules immunitaires, un petit peu comme un cheval de Troie. Une fois intégrés dans les chromosomes de la chenille, celle-ci va lire ces gènes comme s’ils lui appartenaient. Cette lecture va engendrer la production de protéines qui vont la détruire : un piège machiavélique !
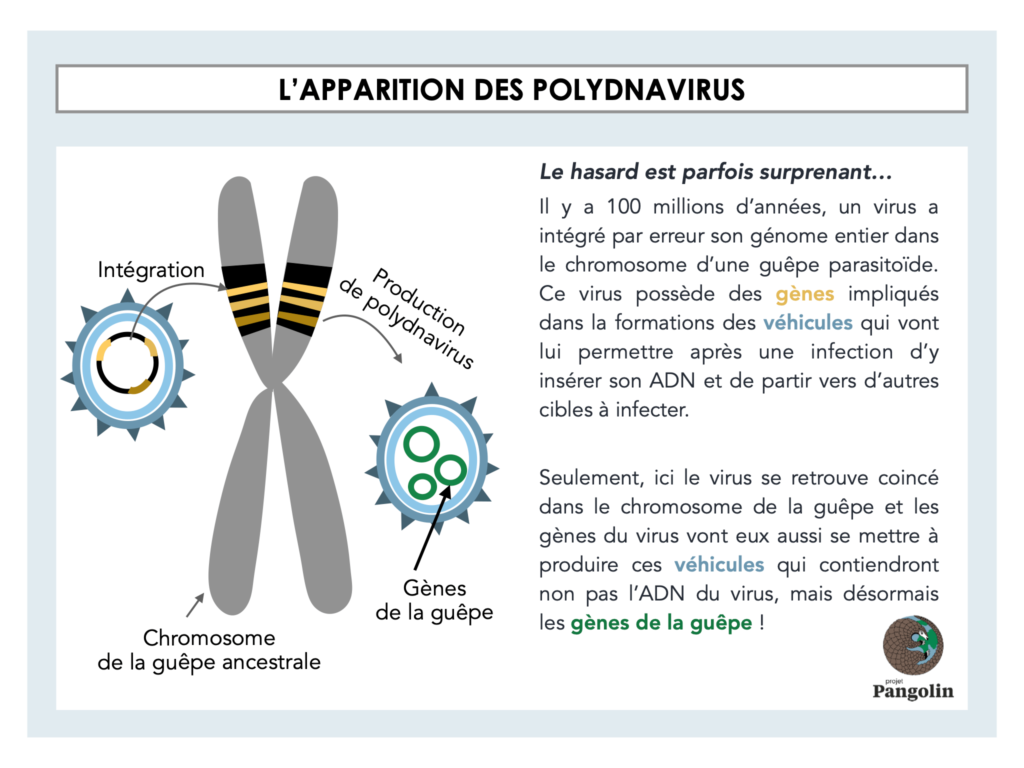
Vous l’aurez compris, suite à un évènement de transfert horizontal d’un virus dans le génome d’une guêpe il y a 100 millions d’années, les guêpes ont pu domestiquer ce virus pour protéger leurs œufs !
Hop hop hop, attendez ?! Transfert horizontal? Domestiqué ? Beaucoup de termes compliqués que je m’empresse de vous définir.
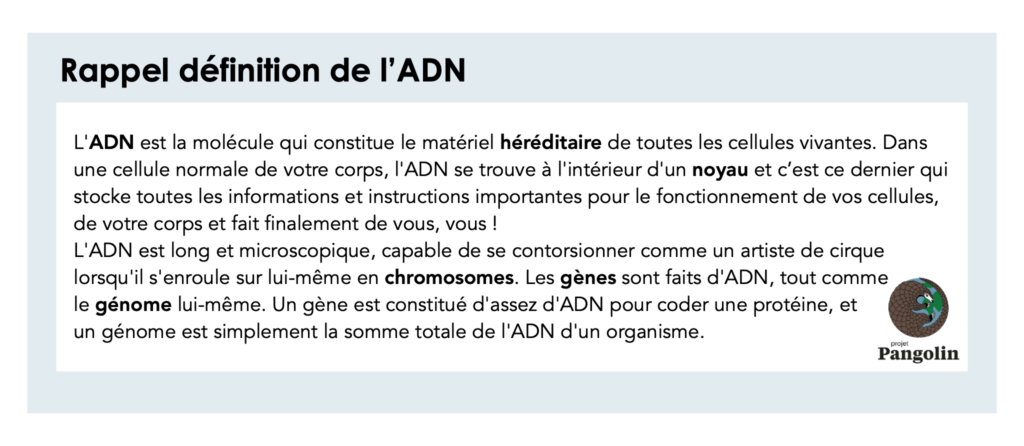
Tout comme les histoires, les gènes peuvent, eux aussi, voyager. Leur voyage le plus commun est appelé transfert vertical : celui de vos parents jusqu’à vous. Le moins commun, mais néanmoins le plus intéressant selon moi est le transfert horizontal entre espèces différentes ! En effet, contrairement au transfert vertical classique, celui-ci a lieu entre individus ou espèces différents sans reproduction. Il peut arriver que les gènes voyagent entre différents génomes, par accident, au cours de l’évolution. À titre d’exemple dans le génome humain nous avons toute une ribambelle de gènes qui appartenaient à des virus, des bactéries etc. Il arrive même parfois que le génome d’un organisme s’intègre entièrement dans celui d’un autre organisme [12], surprenant non ?
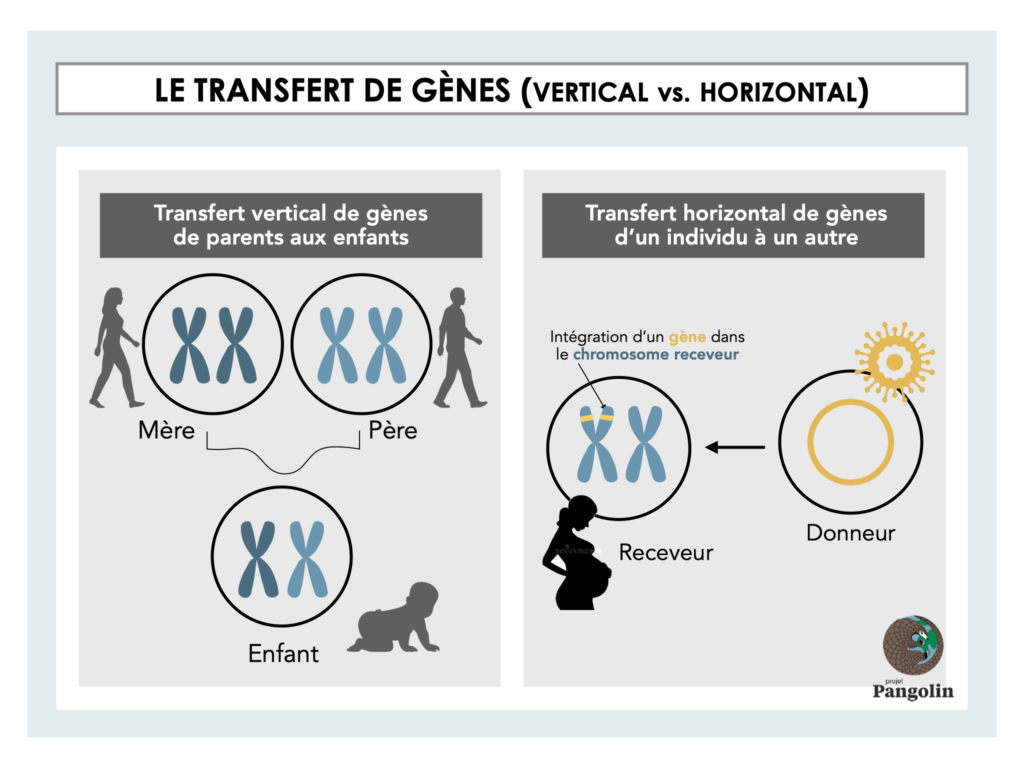
Mais que se passe-t-il lorsqu’un gène intègre un autre génome ? Et bien la plupart du temps : rien ! Ce gène va tout simplement se dégrader au fil des générations en accumulant des changements (mutations) qui ne rendront plus lisible ce gène par l’organisme. Seulement, il peut arriver parfois que ces gènes nouvellement acquis apportent un avantage adaptatif important à l’individu receveur. Dans ce cas, ces gènes seront sélectionnés, et alors cet individu pourra les transmettre à sa descendance par transfert vertical ! On parlera alors de domestication de ce gène par l’organisme receveur.
Un des exemples le plus connu de transfert horizontal d’un gène suivi de sa domestication par l’individu l’ayant reçu nous concerne directement. Nous, les mammifères placentaires. En effet suite à une intégration d’un virus il y a 100 millions d’années dans le génome de nos ancêtres proto-mammifères, nous avons domestiqué un gène appelé syncytine [13] !
Chez les virus, ce gène permet d’entrer dans des cellules hôtes par fusion membranaire. De manière spectaculaire, son intégration dans le génome de notre ancêtre fût fort utile puisque ce gène a permis le développement du placenta ! Ce gène d’origine virale permet, toujours aujourd’hui, d’assurer la fusion et les échanges métaboliques entre les cellules de la mère et du fœtus. Et ce n’est pas tout ! Les structures placentaires ne se limitent pas aux mammifères, mais apparaissent également chez certains autres vertébrés comme chez les lézards !
Ainsi des chercheureuses ont découvert que la protéine responsable de cette structure placentaire chez le vivipare Mabuya scincidae venait elle aussi d’un virus [14]. Décidément ces virus semblent apporter beaucoup d’innovations dans le monde vivant !
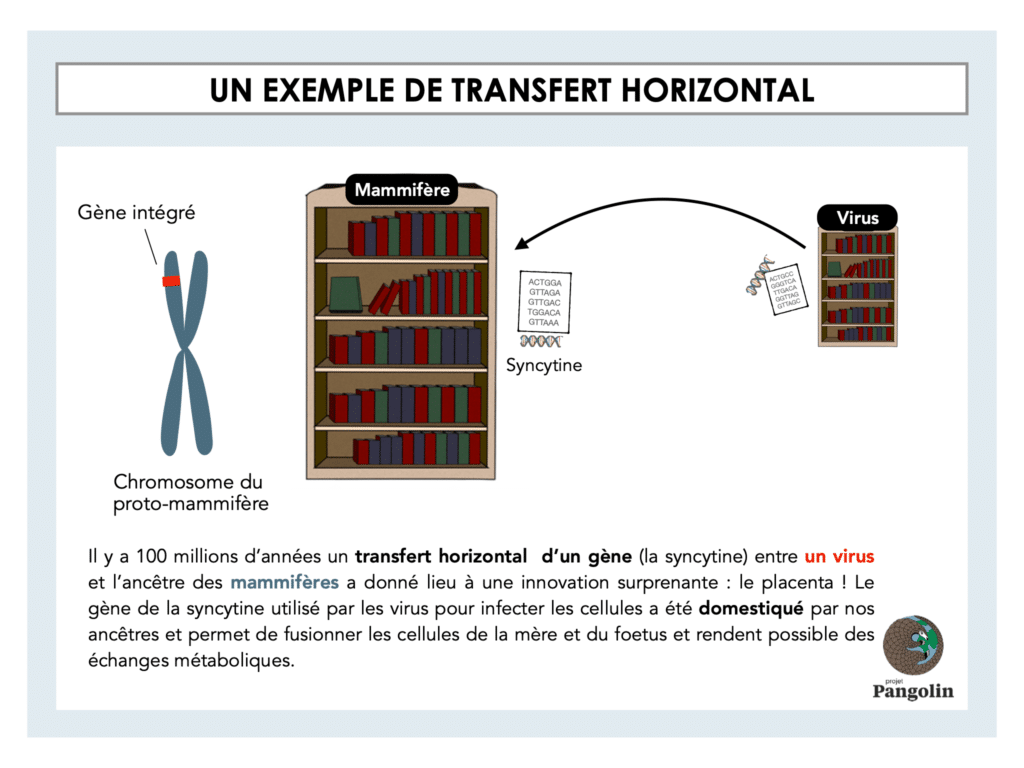
Grâce à toutes ces histoires, on vient de comprendre ce qu’était un gène, un transfert horizontal et la domestication de gènes. Maintenant nous pouvons comprendre ce qu’il s’est passé précisément chez nos guêpes parasitoïdes il y a 100 millions d’années.
Nous avons vu que lorsque la guêpe pond ses œufs, elle injecte également des particules virales qui vont empêcher le système immunitaire de la chenille de détruire les œufs. En 2009 [11], des chercheureuses se sont rendus compte que ces particules virales étaient composées de deux choses : des gènes d’origine virale permettant la production de véhicules viraux et des gènes de virulence de la guêpe.
Ce virus s’est intégré par erreur il y a 100 millions d’années dans le génome de l’ancêtre des guêpes. Ainsi, ce n’est pas un seul gène ou une petite partie du virus qui s’est transféré horizontalement, mais le génome du virus tout entier d’un seul coup ! Et puisque certains des gènes présents dans le génome du virus se sont retrouvés avantageux pour cette guêpe, ils ont été sélectionnés et gardés de générations en générations. Ils continuent donc de produire ces fameux véhicules (polyDNAvirus) qui transportent les gènes de la guêpe qui, une fois intégrés dans les chromosomes de l’hôte, vont le mener à sa perte, n'est-ce pas impressionnant ? Et si je vous disais maintenant que nous pouvons également utiliser toutes ces connaissances pour protéger nos cultures agricoles ? Ahhh l’intérêt de la recherche fondamentale 🙂 .
La destruction des cultures et la transmission de maladies par les insectes ont un impact important sur l'économie et la santé. On estime par exemple que les insectes nuisibles sont responsables de la perte de 18 à 26 % du rendement annuel des cultures dans le monde, pour un coût économique supérieur à 470 milliards de dollars US ! [15]. La transmission des maladies aux animaux et aux populations humaines, quant à elle, est un problème croissant dans différentes régions du globe, comme le paludisme qui reste l'une des principales causes de décès dans le monde.
En effet, les ravageurs de cultures ont toujours représenté une menace pour la pérennité des sociétés humaines sédentarisées. L’utilisation de produits chimiques s’est normalisée à partir des années 1940 avec l'introduction des insecticides synthétiques (type DDT) et s'est poursuivie avec le développement d'un nombre croissant de substances neurotoxiques.
Ces méthodes mettent l’accent sur les gains économiques à court terme avec des effets néfastes sur le long terme. En effet, l'illusion d'un contrôle chimique global et efficace des insectes a été progressivement remise en cause. Notamment par le développement de résistance aux insecticides par les insectes ciblés, la pollution de l'environnement et la toxicité pour les organismes non ciblés. Face à ce constat, des méthodologies de contrôle des insectes ravageurs plus durables ont dû être envisagées.
Vous me voyez venir ? Il existe un lien évident entre les pesticides et ces guêpes parasitoïdes. Ils ont tous deux la même cible : les insectes ravageurs de cultures ! Et oui, car ces guêpes parasitoïdes, présentes dans le monde entier, s’attaquent, elles aussi, à des insectes qui détruisent certaines cultures humaines !
Il existe donc un moyen moins invasif de lutter contre les insectes ravageurs en exploitant les interactions naturelles entre insectes. Si tant est qu’il soit rigoureusement étudié en amont. On appelle ça le biocontrôle. Ce type d’approche a déjà été implémenté avec succès depuis un plus d’un siècle [16]. Il représente une solution prometteuse pour une agriculture durable. Les guêpes parasitoïdes présentées précédemment ont longtemps été utilisées comme agents de biocontrôle des insectes nuisibles agricoles. Cela permet finalement d’envisager des méthodes alternatives durables pour maitriser les populations de ravageurs de cultures en élevant à échelle industrielle les parasitoïdes.
A la fin de l’article vous devriez déjà avoir une grande quantité d’information à digérer, et vous pourriez vous poser une nouvelle question intéressante : « ok mais finalement, c’est encore un virus ou pas qui est intégré dans le génome de ces guêpes parasitoïdes ? » Et je serais tenté de vous poser la question suivante à mon tour : « ok mais est ce que finalement la guêpe est toujours une guêpe ? ».
Nous avons tous tendance à voir le monde comme quelque chose de simple : un individu est un individu avec son identité propre, une plante porte un nom latin et peut être reconnue grâce à diverses caractéristiques physiques, mais finalement nous ne voyons le reflet que d’un tout qui se compose de milliers de choses à peine perceptibles par l’œil humain !
Nous respirons grâce à des bactéries logées dans nos cellules, digérons grâce à notre microbiote, nourrissons nos fœtus via le placenta grâce à un gène de virus, et ces guêpes, quant à elles, assurent la survie de leurs progénitures grâce à un virus qui fait désormais partie d’elles, tout comme elles font désormais partie de lui. Le monde n’est pas figé et les interactions entre organismes, qu’elles soient durables ou non, en sont de merveilleux exemples. Ces guêpes et ces virus font désormais partie d’une seule et même entité qui ne se séparera sans doute jamais. Leur interaction représente un avantage mutualisé : si la guêpe réussit à se reproduire, alors elle pourra disperser ses gènes, et le virus quant à lui (ou plutôt les gènes de virus) quant à eux le seront aussi ! Ça ne ressemblerait pas à du win-win ?
À ce propos j’écrirai prochainement un article qui portera sur les interactions égoïstes entre entités biologiques, de l’échelle de l’organisme jusqu’aux molécules d’ADN, en attendant je vous encourage vivement à lire « le gène égoïste » de Richard Dawkins !
Et si vous en voulez encore, une version vidéo du sujet est disponible sur youtube !
Nous sommes souvent subjugués par les connaissances de nos grands-parents en ce qui concerne les espèces présentes dans nos forêts. Nos générations ont quelque peu perdu ce lien à la nature et nous sommes nombreux à être (presque) incapables de faire la différence entre un hibou et un moineau. Pour y remédier nous vous proposons de découvrir ce premier guide du naturaliste sur le thème des oiseaux. L’objectif est de vous fournir assez d’informations pour que vous soyez capables de reconnaître une dizaine d’espèces d’oiseaux communs, mais aussi pour éveiller votre curiosité !
Pour ce faire, vous retrouverez tout d’abord la présentation de 12 espèces d’oiseaux rencontrées fréquemment en France. À la fin de ces présentations vous pourrez télécharger les fiches d'identités correspondantes !
Nous vous donnerons ensuite des astuces de nourrissage pour les aider à survivre à l’hiver.
Et enfin, nous vous présenterons quelques précieux conseils pour vous permettre d’installer des nichoirs adaptés aux oiseaux qui visitent vos jardins, et ainsi de participer à la diminution de la fragmentation de leur habitat.
Bonne lecture !
Le geai des chênes (Garrulus glandarius) est un passereau de la famille des Corvidés.
On retrouve cette espèce sur tout le continent eurasiatique et en Afrique du nord, aussi bien en plaine qu’en moyenne montagne (jusqu’à 1400 m d’altitude).
Le geai des gênes a une préférence marquée pour les forêts de feuillus (e.g. hêtre, chêne, châtaignier, etc), mêlés ou non avec des conifères (e.g. pin, sapin, etc). On le rencontre aussi dans les parcs et bosquets, à condition que ceux-ci soient arborés. En dehors de sa période de reproduction, son habitat s’élargit et vous pourrez le rencontrer dans des milieux semi-ouverts tels que vos jardins, milieux agricoles et urbains (mais toujours arborés !).
Il se nourrit d’une grande diversité d’aliments, on le qualifie donc d’omnivore. Bien qu’il raffole des glands (i.e. les fruits du chêne), son alimentation varie selon la saison. Du printemps jusqu’au début de l’été, il consomme de nombreux petits vertébrés tels que des lézards, campagnols et mulots. À l’automne et en hiver, il opte plutôt pour une alimentation à base de végétaux.
Vous pourrez observer cette espèce tout au long de l’année en France car il n’est pas migrateur. Mais il faut savoir qu’il peut le devenir si les conditions climatiques ne sont pas favorables (épaisse couche de neige par exemple).
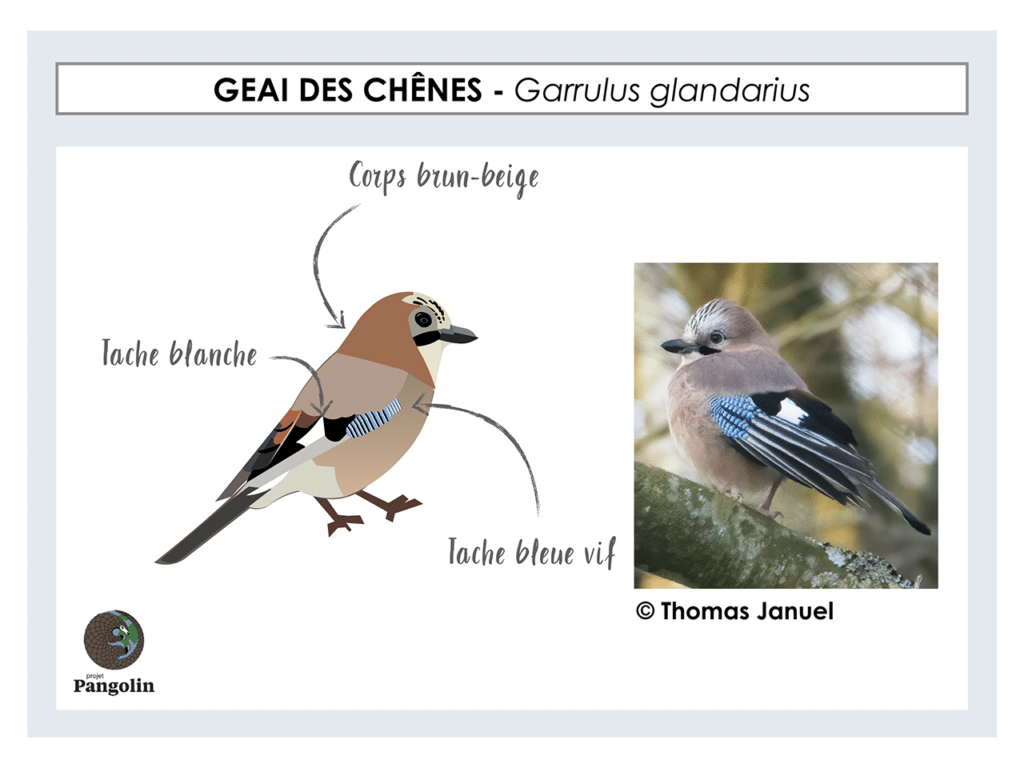
Le geai des chênes est facilement reconnaissable grâce à son plumage atypique et très coloré. Il arbore une belle couleur brun-beige sur la plus grande partie de son corps, avec des nuances de rose. On distingue la tête, vivement colorée, avec une nuance de brun-beige qui tend vers le roussâtre. Le ventre, tout comme le dos, sont gris rosé pâle. Ses ailes sont majoritairement noires, avec une tache d’un bleu très vif que l’on peut facilement repérer lorsque les ailes sont fermées, et derrière laquelle une tâche blanche de plus petite taille vient prendre place.
Il n’y a pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce, c’est-à-dire que tous les individus (i.e. mâles, femelles) ont les mêmes caractéristiques physiques. Les mâles sont simplement parfois un peu plus grands que les femelles.
Cet oiseau porte le nom de "geai des chênes parce qu'il est particulièrement friand des fruits produits par ces arbres, les glands. Il est également qualifié de sentinelle des forêts en raison des cris d'alarme stridents qu'il pousse quand un danger d'approche.
La pie bavarde (Pica pica) appartient, comme le geai des chênes, à la famille des Corvidés.
Cette espèce est retrouvée dans absolument toute l’Eurasie, comme le montre cette carte de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN).
Elle vit aussi bien dans les campagnes que les villes, en milieux ouverts et semi-ouverts tels que les bosquets, bois clairs, parcs et jardins.
Elle est omnivore et se nourrit majoritairement d’insectes, mais aussi de lézards, jeunes amphibiens ou petits mammifères. Elle consomme parfois des graines, des fruits, et peut s’attaquer aux œufs et/ou poussins d’autres oiseaux, notamment de passereaux. Elle peut aussi être nécrophage et ainsi aider à nettoyer les carcasses d’animaux en bords de routes ou en campagne. Grâce à ses grandes capacités d’acclimatation, on peut également l’observer se servir dans les ordures ménagères !
Ce n’est pas une espèce migratrice, vous pourrez donc l’observer toute l’année dans nos contrées.
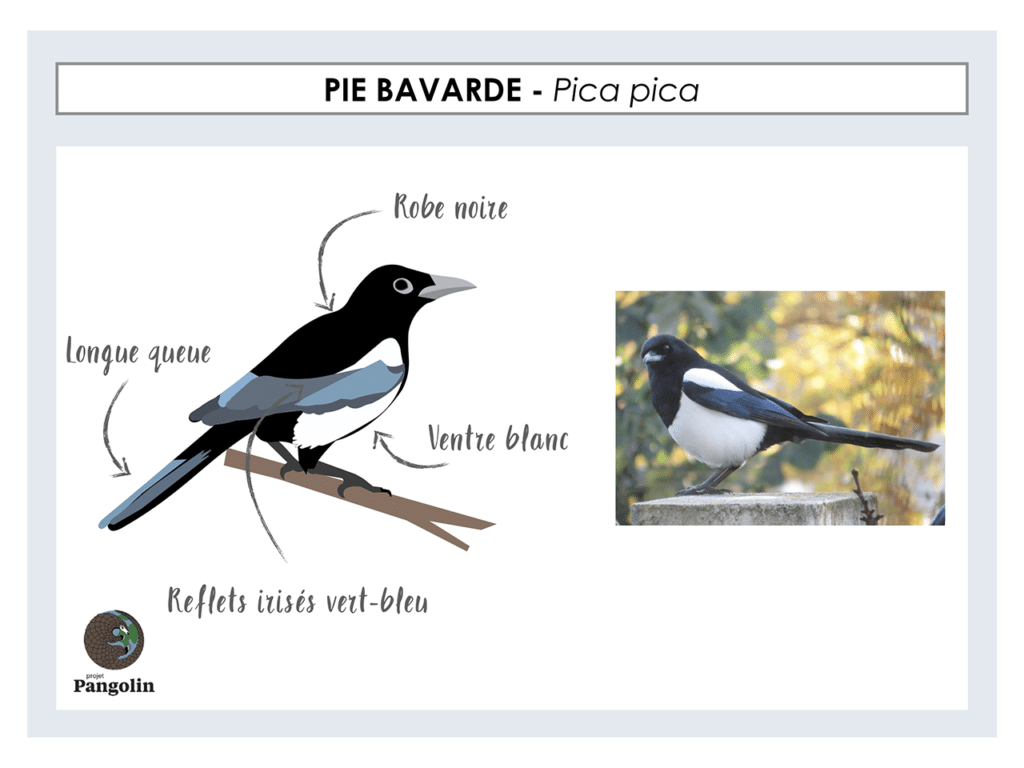
La pie bavarde est très facile à reconnaître. Elle est noire avec le ventre blanc, a une longue queue et des reflets irisés vert-bleu à la lumière sur ses plumes noires. Son bec est noir également et en vol, le bout de ses ailes est blanc. Le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup, il n’y a pas de dimorphisme sexuel.
Saviez-vous que la pie bavarde a une réputation de voleuse, accusée de voler des objets, particulièrement ceux qui brillent ? Légende ou réalité selon vous ? Une étude parue en 2015 (Shepard et al.) a montré que la pie n'est pas particulièrement attirée par les objets qui brillent. Cette réputation lui viendrait probablement du fait que la pie est souvent observée dérobant des éléments du nid de ses congénères.
Le pic épeiche (Dendrocopos major) appartient à la famille des Picidés et est le plus répandu des pics dits bigarrés (i.e. au plumage coloré de noir, blanc et rouge). Il est présent sur l’ensemble du continent eurasiatique, à l’exception de l’Irlande.
Cet oiseau est un forestier ubiquiste, c’est-à-dire qu’il fréquente des milieux forestiers divers et variés et ce d’une altitude nulle (niveau de la mer) jusqu’à plus de 2000 mètres.
Il se nourrit de divers aliments qui changent avec les saisons. Au printemps et en été, son régime est plutôt insectivore. Grâce à son bec et sa longue langue, il extirpe les larves de nombreux insectes directement des troncs et des branches et s’attaque aussi aux fourmilières. À la mauvaise saison, il continue de se nourrir de larves qu’il trouve dans le bois tout en se mettant à la recherche de graines et fruits riches en lipides (e.g. faines).
Le pic épeiche est le plus souvent sédentaire, vous pourrez donc l’observer toute l’année en France. Quelques déplacements locaux peuvent cependant être réalisés, lorsque les ressources alimentaires dans la forêt de résidence se font rares par exemple.
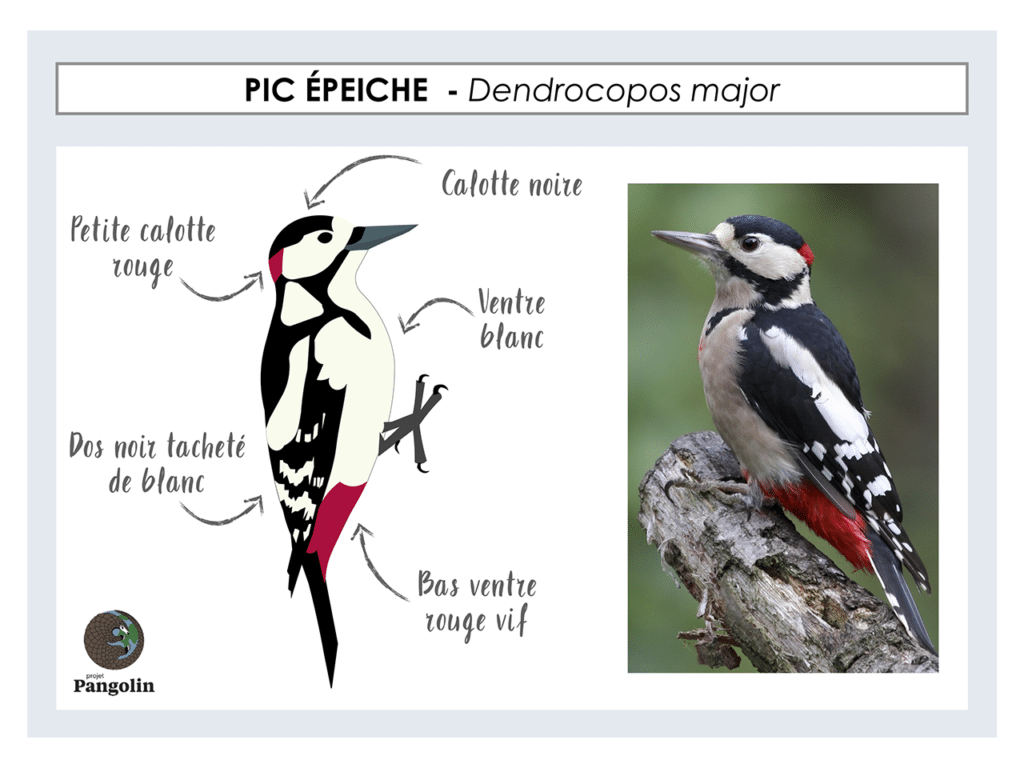
Il est facile à reconnaître grâce à son plumage atypique et coloré, dit « bigarré ». Le dos et les ailes sont noirs, et une large tache blanche est présente sur les épaules. Le dessous de son cou, ainsi que la partie supérieure de son ventre, sont blancs. Son bas ventre est en revanche d’un rouge vif très caractéristique. La tête est blanche également, et il y a sur son sommet une très large calotte noire allant du bec jusqu’à quasiment le sommet du crâne. Enfin, une petite calotte rouge vive sur le haut de la tête permet de distinguer le mâle de la femelle.
il peut marteler un arbre jusqu'à 15 coups par seconde. Cet oiseau a aussi une méthode bien à lui pour ouvrir les graines dures puisqu'il les coince dans une fente d'écorce et tape dessus avec son bec jusqu'à ce qu'elles éclatent.
Tout comme le pic épeiche, le pic vert (Picus viridis) appartient à la famille des Picidés. On le retrouve dans toute l’Eurasie, sauf au nord des pays Scandinaves et sur les îles Méditerranéennes (Corse, Sardaigne, Sicile).
On peut trouver le pic vert aussi bien en plaine qu’en montagne, jusqu’à 2000 m d’altitude. Il affectionne les bois et forêts de feuillus et mixtes, ainsi que les zones cultivées avec pâturages. On peut aussi le retrouver dans les grands parcs et des zones plus ouvertes comportant des bosquets ou des haies en milieux urbains. Ce qui lui importe le plus est l’alternance de zones boisées et de zones ouvertes (clairières, lisières et zones herbeuses pour la recherche de nourriture) et la présence de vieux bois. Il aime s’installer dans les parcelles avec des feuillus âgés de 150-200 ans !
Les zones herbeuses sont importantes pour le pic vert car il se nourrit majoritairement de fourmis. Il mange aussi d’autres insectes xylophages (qui mangent du bois) ou insectes tout court (perce-oreilles, cloportes, araignées, guêpes). Il peut parfois se nourrir de fruits et de graines (céréales, conifères, chênes).
Ce n’est pas une espèce migratrice, il est donc observable toute l’année en France.

Le pic vert porte bien son nom puisqu’il est vert ! Le dessus de la tête (calotte) est rouge, le ventre est jaunâtre, ses rémiges et rectrices (plumes des ailes et de la queue) sont striées de noir. Son bec est jaunâtre avec la pointe sombre. Pour distinguer le mâle de la femelle il faut pouvoir observer sa tête en détails : le mâle a une amande rouge au niveau de la moustache (cou, à côté du bec) alors que la femelle non (amande noire). Attention à ne pas le confondre avec le pic cendré (Picus canus) qui, lui, n’a pas de calotte rouge.
Afin de chasser les fourmis et de les débusquer dans leurs fourmilières, le pic vert a une langue très longue, qu'il peut sortir d'une dizaine de centimètre.
Le pinson des arbres (Fringilla coelebs) est un passereau commun de la famille des Fringillidés.
Originaire de l’ouest du continent eurasiatique, son aire de répartition s’étend aujourd’hui sur l’ensemble de ce dernier, ainsi que dans l’extrême nord de l’Afrique et la majeure partie de l’Amérique du Nord.
Bien que décrit comme une espèce forestière, le pinson a su s’adapter à tous les milieux arborés (forêts, parcs et jardins, du niveau de la mer jusqu’à la limite supérieure de la forêt en altitude).
Omnivore, son régime alimentaire varie en fonction des saisons. À la belle saison, les insectes et leurs larves constituent la plus grande part de son alimentation alors qu’à la mauvaise saison, comme le pic épeiche, il recherche surtout graines, fleurs et bourgeons qui sont des ressources riches en protéines et glucides.
Cet oiseau est sédentaire, et est donc visible tout au long de l’année en France. Néanmoins, quand les conditions hivernales sont hostiles à sa survie (e.g. en Scandinavie), il peut migrer en direction de régions au climat méditerranéen. Des vagues de milliers d’oiseaux peuvent alors être observées !
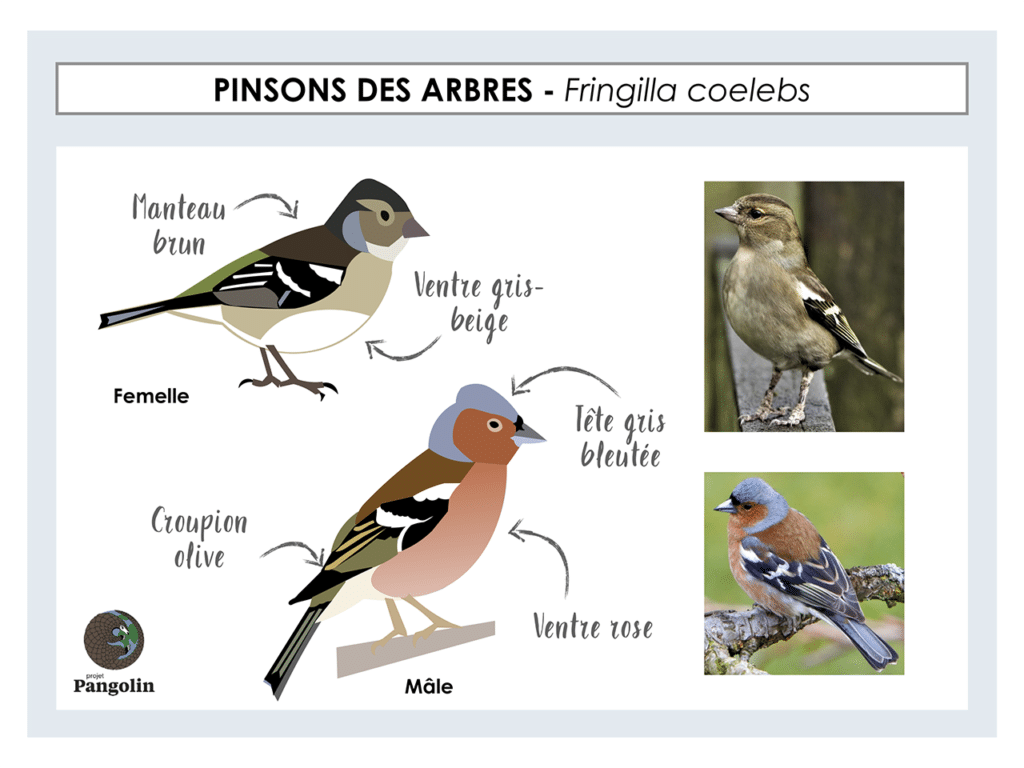
Contrairement à ce que l’on a vu chez le geai et la pie bavarde, le dimorphisme sexuel est très marqué chez le pinson des arbres. Le mâle et la femelle présentent des caractéristiques physiques distinctes. Le mâle est « haut en couleur », avec un haut du dos brun-marron, une tête grise-ardoise bleutée, un front noir, des joues châtains, un croupion olive, et un sous-ventre d’un rose vineux. La femelle a un plumage beaucoup plus discret, qui présente de subtiles nuances de beige-gris. Le manteau est brun terne, la tête et son dessous arborent un beige grisé, et les ailes présentent un brun-verdâtre foncé et sont ponctuées de barres blanches.
il faut environ 1300 voyages à la femelle pinson pour construire un nid qui se fond parfaitement dans son environnement.
Le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) est un passereau discret de la famille des Muscicapidés.
Il est présent sur l’ensemble du continent Eurasiatique, à l’exception de la Scandinavie et du Royaume Uni. On le retrouve également sur la quasi-totalité du continent Africain.
Bien qu’il puisse occuper les jeunes forêts, le rossignol philomèle n’est pas un oiseau forestier mais un oiseau de transition. Il occupe donc des milieux tels que les lisières, autrement dit, des milieux pourvus d’une végétation basse et dense. Il démontre également une préférence marquée pour les fourrés humides et privilégie les habitats proches d’un cours d’eau.
Il se nourrit principalement d’insectes et de fourmis qu’il capture directement au sol. Quand elles sont disponibles, il consomme également des baies et quelques graines.
C’est une espèce migratrice, qui quitte son aire de reproduction (c’est-à-dire, l’Europe (sauf la Scandinavie), le Proche et Moyen-Orient, la Mongolie et le Maghreb) entre septembre et octobre, et atteint ses zones d’hivernage en Afrique tropicale entre la fin de l’automne et le début de l’hiver. Elle est donc présente en France entre fin avril, date de son retour d’hivernage, et fin octobre.
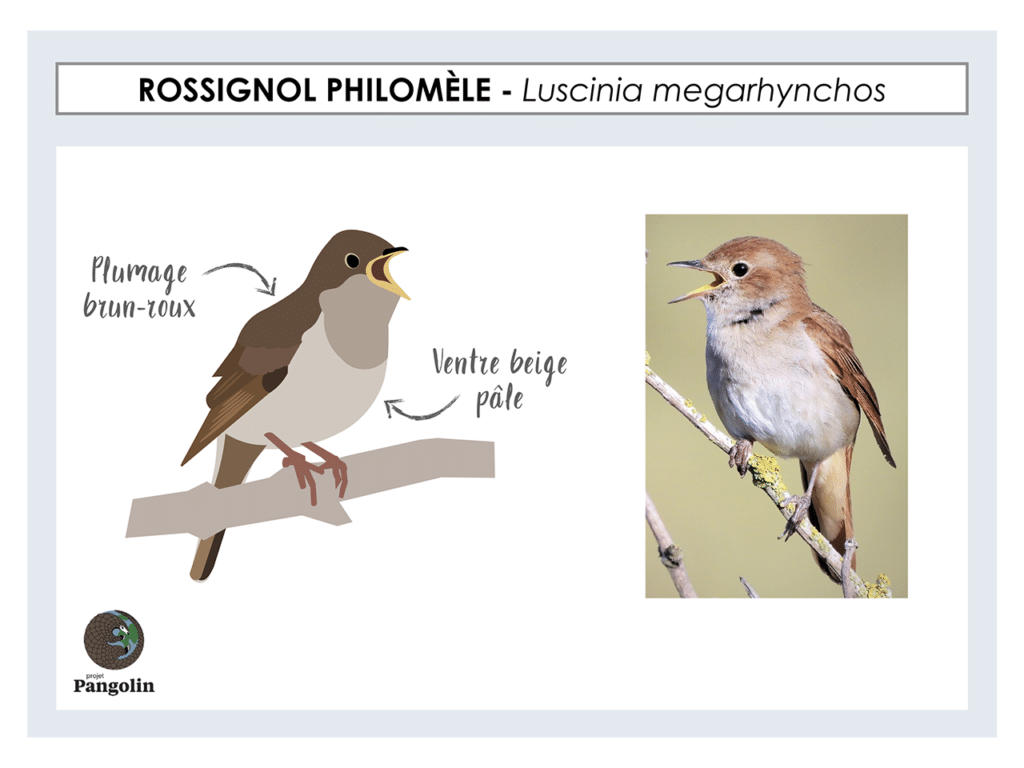
Le rossignol philomèle est trapu, plus grand que le rougegorge dont il a l’allure. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce. Le plumage des parties supérieures est d’un beau brun chaud qui tend vers le brun-roux au niveau du croupion et de la queue. Ce brun-roux est également retrouvé sur la tête et la nuque. Les parties inférieures sont beige pâle, qui tend vers les teintes de sable sur les flancs.
Contrairement à une opinion répandue, le rossignol philomèle ne chante pas seulement la nuit. ll est simplement plus difficile de l'entendre en journée car le chant d'autres passereaux plus "bruyants" viennent souvent étouffer le sien.
Le rougegorge familier (Erithacus rubecula) est un passereau qui appartient aussi à la famille des Muscicapidés.
Il est présent majoritairement en Europe, mais on le retrouve sur une grande partie du continent Eurasien ainsi qu’en Afrique du Nord.
Il vit dans tous les types de forêts (de feuillus, mixtes, de conifères) mais on peut aussi le rencontrer dans de nombreux habitats boisés comme les haies, les taillis, les parcs et les jardins. Il n’est pas difficile ! Il suffit que la végétation soit assez épaisse.
Les rougegorges familiers se nourrissent de petits fruits (baies), d’invertébrés (vers de terre, araignées, escargots) mais aussi de petites graines qu’ils trouvent au sol. Ils sont donc incapables de s’alimenter sur une boule de graisse suspendue.
Bien que les populations vivant le plus au Nord soient migratrices et se déplacent donc en hiver pour rejoindre des zones plus chaudes (comme le pourtour méditerranéen), en France, on peut apercevoir les rougegorges familiers toute l’année.
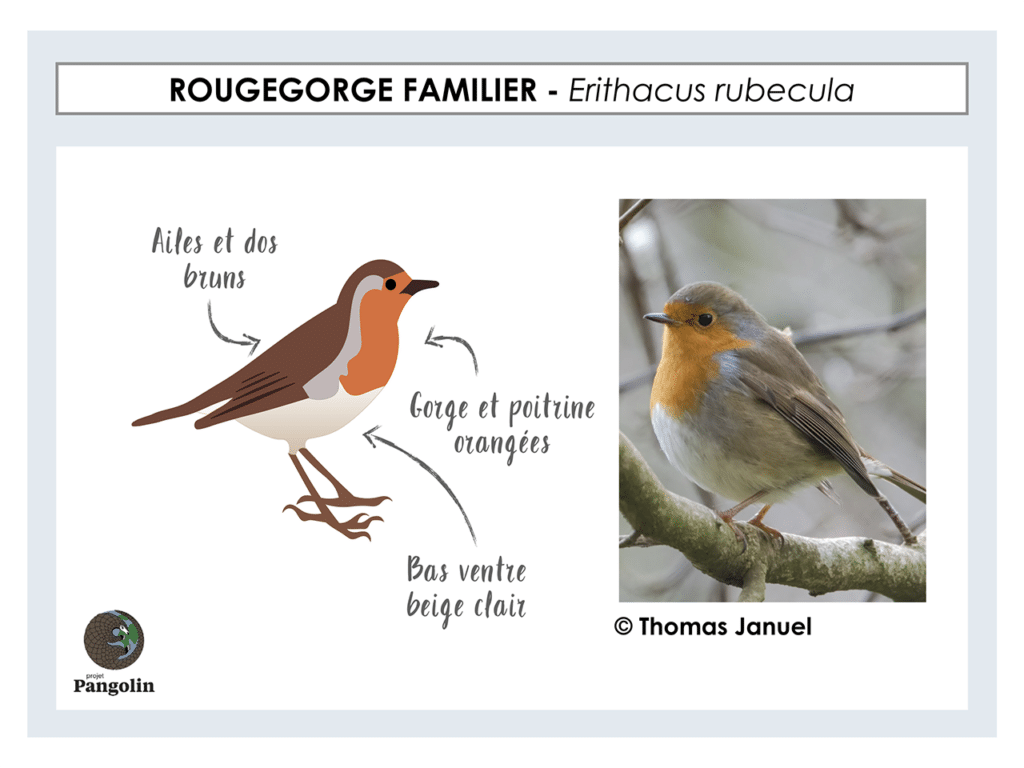
Comme leur nom l’indique, ils sont facilement identifiables grâce à leur grande tache rouge-orangée au niveau de la gorge et de la poitrine. Leurs yeux sont des petites billes entièrement noires. Leurs dos et ailes sont bruns et la jonction entre la poitrine et le dos est de couleur grise. Les mâles et les femelles sont identiques.
Cet oiseau est très peu craintif des humains et il est assez courant d'en attirer sur nos balcons avec des miettes de pain. Malgré son aspect très sympathique, il est considéré comme un oiseau très agressif (en tout cas envers ses congénères). En effet, ce sont es oiseaux territoriaux. Il est donc fréquent de les croiser en conflit, chaque adversaire bombant son plastron rouge et sifflant assez fort.
Les mésanges noires (Periparus ater) sont des passereaux qui appartiennent à la famille des Paridés. On les retrouve sur tout le continent Eurasien et dans quelques régions d’Afrique du Nord.
Elles vivent principalement dans les forêts de conifères (sapins, pins, épicéas, etc). Si elles s’installent dans les forêts mixtes elles chercheront toujours les coins où il y a des conifères, et il en ira de même si elles visitent vos jardins.
En été, les mésanges noires se nourrissent principalement d’insectes divers et variés, mais en hiver elles changent d’alimentation et optent pour des graines de conifères.
C’est une espèce partiellement migratrice, ce qui signifie que certaines migrent vers le sud en hiver, parfois en très grand nombre. D’autres font le choix de s’établir toute l’année sur le même territoire et prennent le risque de manquer de nourriture et d’avoir des difficultés à survivre au froid. Il est fréquent de les apercevoir tout au long de l’année sur le territoire français puisque certaines sont sédentaires.
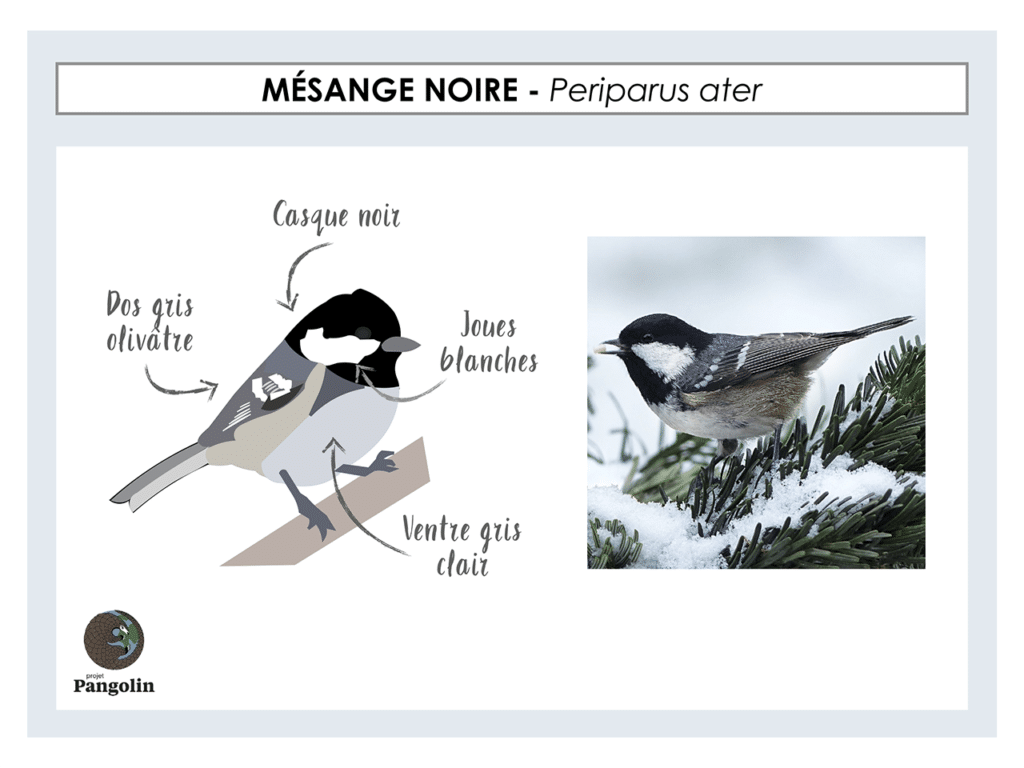
Vous pourrez reconnaître ces oiseaux grâce à leur casque noir et aux taches blanches sur leurs joues. Elles ont une bavette (tache sous le bec) noire, le ventre gris clair/blanc et leur dos est gris olivâtre. On considère que les femelles et les mâles sont identiques, il est donc possible de les différencier uniquement lorsque nous sommes très habitués à les observer.
Les mésanges noires qui se sédentarisent prennent le soin de constituer des réserves de nourriture qu'elles cachent au sommet des arbres. En effet, elles vont dissimuler des graines dans des bourgeons vides ou dans des fissures d'écorce.
Tout comme la mésange noire, la mésange bleue (Cyanistes caerules) est un petit passériforme appartenant à la famille des Paridés. L’espèce se retrouve essentiellement en Eurasie et majoritairement du côté Européen. Sa distribution s’étend jusqu’en Asie mineure et au nord de l’Afrique via une sous-espèce locale.
Cet oiseau vit essentiellement dans les forêts de feuillus, mais également (bien qu’en densité plus faible) dans des forêts mixtes (mélange de conifères et de feuillus). La mésange bleue est également très répandue dans les parcs et en milieu urbain.
Le régime alimentaire de la mésange bleue varie en fonction des saisons. Pendant les beaux jours, elle suit un régime essentiellement insectivore, mais une fois la belle saison achevée, elle devient granivore-frugivore car les insectes ne sont plus disponibles.
L’espèce est sédentaire en France et peut donc être observée toute l’année.
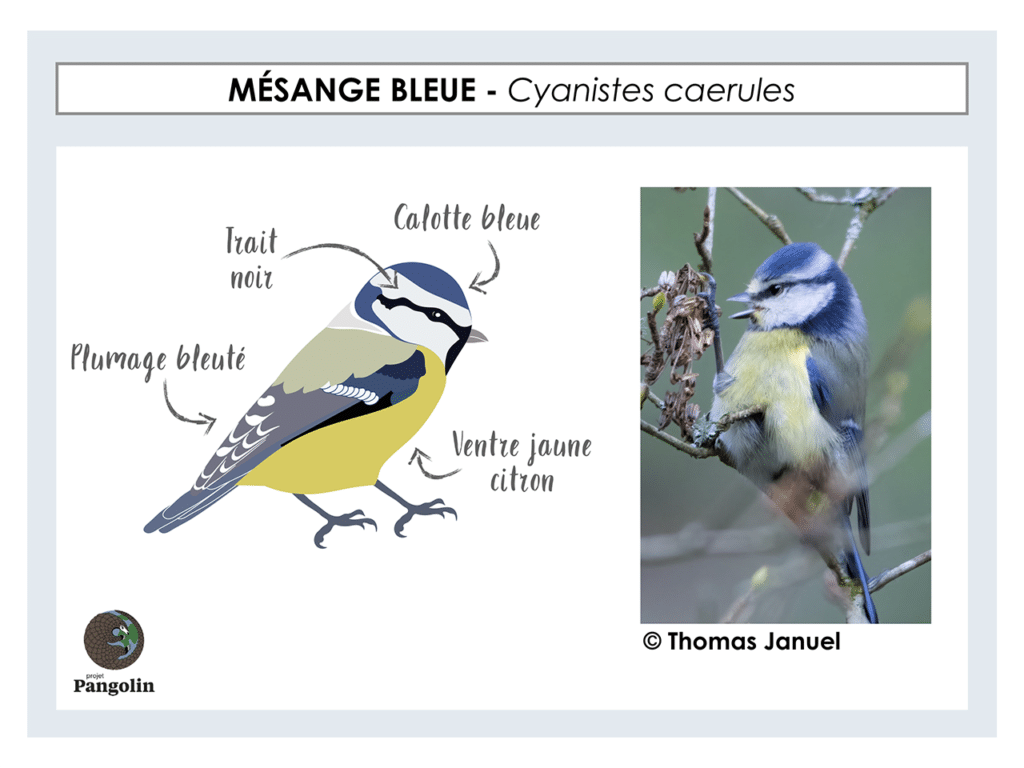
Pour la reconnaître, c’est facile, tout est dans le nom ! Elle arbore un plumage d’une couleur bleutée au niveau de la queue, des ailes et au sommet du crâne (calotte), ainsi qu’un ventre jaune citron. Les joues et le front sont blancs et elle présente un trait sourcilier noir entourant son œil et allant de part et d’autre de la tête. Elle a aussi un autre trait noir le long de la gorge, sous le bec, faisant contraste avec le blanc de la tête. Il est possible de distinguer le mâle et la femelle en comparant la couleur des calottes. Celle du mâle arbore un bleu bien plus marqué que celle des femelles. Attention cependant à ne pas confondre la mésange bleue avec la mésange charbonnière. La mésange charbonnière a une calotte noire et pas de front blanc (il n’y a donc pas de trait sourcilier).
La mésange bleue met des fragments de plantes odorantes dans son nid (comme la lavande ou l'immortelle). Des chercheureuses de l'Université de Montpellier ont montré que cela permettait de réduire la quantité de bactéries présentes dans le nie et donc de protéger les poussins.
Les moineaux domestiques (Passer domesticus) sont eux aussi des passereaux, mais appartenant à la famille des Passéridés.
Ces oiseaux possèdent une aire de répartition impressionnante puisqu’on les retrouve pratiquement sur tous les continents (sauf le Groenland et l’Antarctique) ! 12 sous-espèces sont dispersées sur la surface du globe, dont la majorité ne migre pas. Seules 2 sous-espèces asiatiques sont migratrices.
Le moineau domestique est une espèce dite « anthropopile », c’est-à-dire qu’il vit beaucoup dans les zones occupées par les humains. On le verra donc partout en ville, en campagne dans les villages, hameaux et fermes isolées. Tout ce dont il a besoin c’est de végétation et de présence humaine.
Il consomme généralement beaucoup de graines, de bourgeons et parfois quelques invertébrés. Cependant, il est opportuniste et comme il est très présents en ville ou aux abords des zones occupées par les humains, il sait tirer profit de nos activités (agriculture, détritus…).
On retrouve les moineaux domestiques toute l’année en France. Ils sont très facilement observables, et présents en grande densité. Il y a d’ailleurs de fortes chances pour que vous ne les remarquiez même plus !
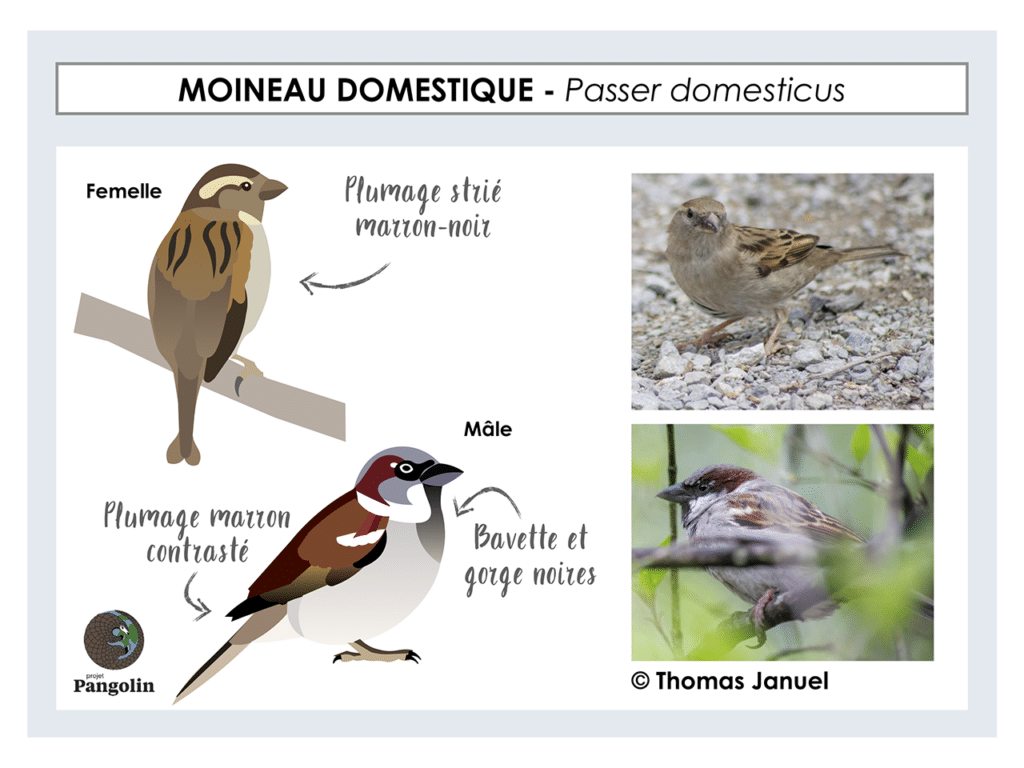
Chez cette espèce, le dimorphisme sexuel est très marqué. La femelle possède des couleurs moins contrastées que le mâle. Ils ont tous deux le dos marron et rayé (noir). La femelle a le bec brun, ainsi que la tête avec un « sourcil » plus clair. Le mâle a le bec noir, la tête grise avec une « bavette/gorge » noire. Attention à ne pas le confondre avec le moineau friquet (Passer montanus) qui lui ressemble beaucoup ! Contrairement au moineau domestique, le moineau friquet vit plutôt dans les champs et en campagne. De plus, ce dernier a une calotte brune et des joues blanches avec une tache noire alors que le domestique a une calotte grise et pas de taches sur les joues. Le moineau friquet a aussi une bavette bien délimitée, qui ne s’étend pas sur le ventre alors que le moineau domestique a une bavette noire plus « diffuse » qui descend jusqu’au ventre.
Au cours d'une même saison de reproduction, cette espèce peut produire jusqu'à 4 nichées de 2 à 8 oeufs ! En effet, le mâle et la femelle couvent ensemble durant une quinzaine de jours puis nourrissent les petits pendant 2 semaines après éclosion. Deux semaines après l'envol, ils peuvent donc se relancer dans une autre nichée. Et ainsi de suite jusqu'à 4 nichées/an.
Les bergeronnettes grises (Motacilla alba) sont aussi des passereaux, mais de la famille des Motacillidés.
Ces oiseaux `sont présents sur tout le continent Eurasiatique, en Amérique du Nord, en Océanie et sur la quasi-totalité du continent Africain. En hiver, les populations établies le plus au Nord migrent vers des climats plus favorables.
On retrouve souvent la bergeronnette grise au bord des cours d’eau. Elle affectionne les zones ouvertes, les grands espaces, qu’ils soient sur les étendues d’eau, en campagne ou plus en milieu urbain comme les friches industrielles. Elle recherche les zones avec peu de végétation ou une végétation rase, les parcs et jardins peuvent donc aussi lui convenir, du moment qu’elle y trouve de quoi se nourrir.
Elle se nourrit d’insectes (au sens large, tout ce qui lui passe sous le bec !) et pratique différentes méthodes de chasse. Elle peut ainsi chasser les diptères (e.g. les mouches, les moustiques), les coléoptères ou encore les fourmis, que ce soit au sol, sur de la végétation flottante ou en vol.
Étant une espèce partiellement migratrice, on retrouve la bergeronnette grise partout en France en été mais en hiver, elle ira plus au sud dans le pourtour Méditerranéen et en Afrique (jusqu’en Afrique centrale). Les plus chanceux d’entre nous pourrons néanmoins observer quelques individus dans l’ouest du pays.
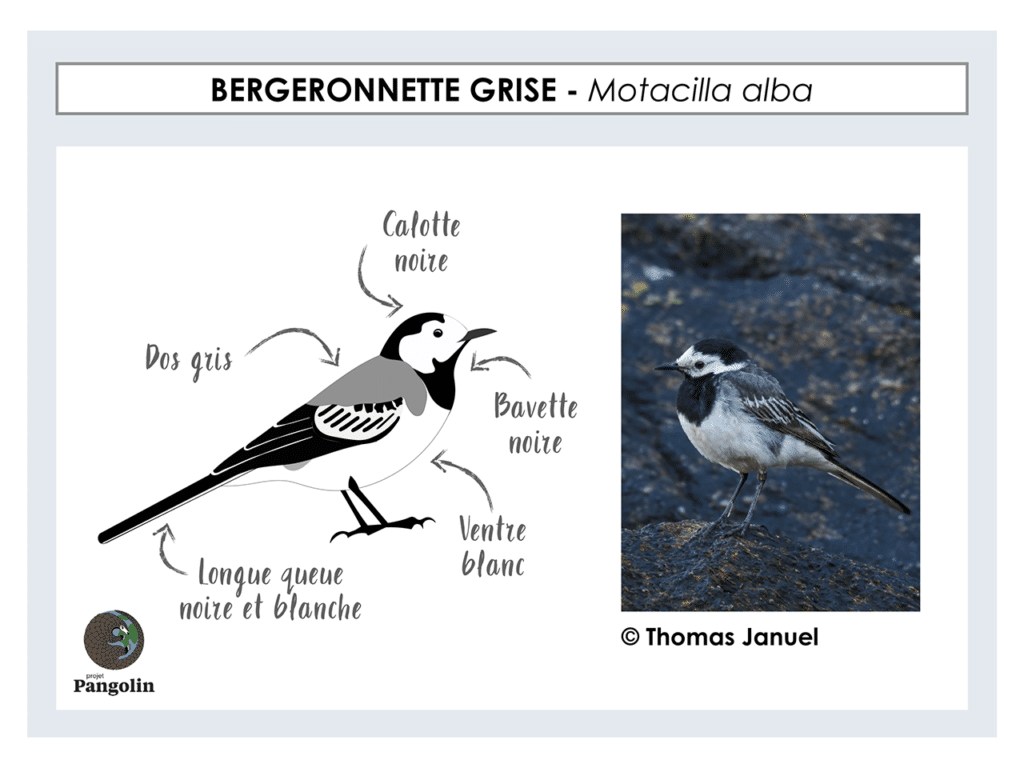
Pour la reconnaître, il faut regarder sa queue. En effet, les bergeronnettes se distinguent principalement par une longue queue noire et blanche qu’elles agitent de bas en haut fréquemment. Elles ont le dos gris, les ailes rayées noire et blanche, le ventre blanc et une bavette noire. Le haut de leur tête (la calotte) est noir et un bandeau blanc habille leur face.
Il est fréquent d'observer les bergeronnettes en groupe, elles sont très sociales sauf pendant les périodes de reproduction. Elles deviennent territoriales et se mettent donc à défendre ardemment leur zone de nidification.
Le merle noir (Turdus merula) appartient à la famille des Turdidés. Il est présent dans toute l’Eurasie et au nord de l’Afrique.
On peut le trouver dans divers milieux : forêts, bois, jardins, parcs et bocages. Il préfère la présence d’arbres feuillus mais on le retrouve parfois dans les forêts mixtes et de conifères. Il vit aussi bien en ville qu’à la campagne, et même à la montagne jusqu’à 1600 m d’altitude.
Le merle noir est omnivore et s’alimente essentiellement au sol. Son régime alimentaire est composé en majorité de vers de terre (de nombreuses espèces différentes) mais aussi d’insectes et larves d’insectes, et de beaucoup de fruits lorsque ceux-ci sont mûrs sur les arbres et arbustes.
C’est un migrateur partiel, s’il est sédentaire (et donc présent en continu) dans l’ouest de l’Europe (et donc en France où vous le verrez toute l’année) et au nord de l’Afrique, on le trouve en Biélorussie, Ukraine et Russie seulement en été. Il en va de même pour la Scandinavie. Les populations de ces pays migrent dans l’ouest de l’Europe pour hiverner (de septembre à avril).
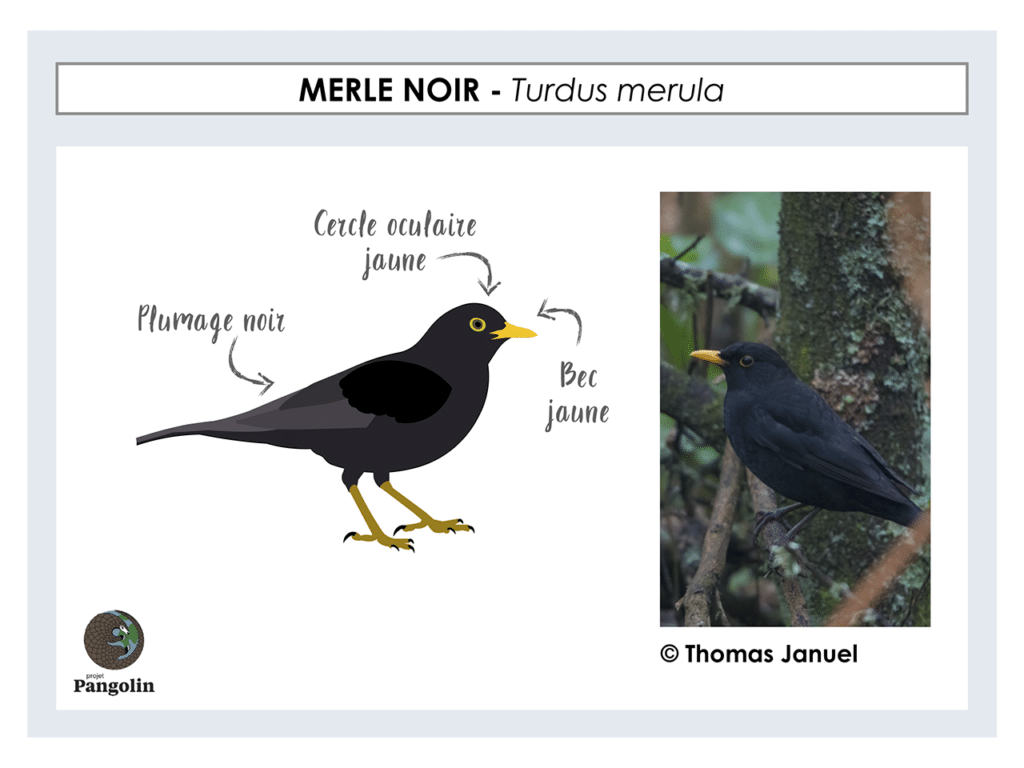
Le merle noir est… noir, oui, mais seulement le mâle ! Au printemps et en été (pour la reproduction) il a un bec et un cercle oculaire jaunes. Il peut être confondu avec l’étourneau mais ces deux espèces diffèrent par leur comportement : le merle est solitaire alors que l’étourneau est grégaire. Le merle a aussi une longue queue qu’il lève et abaisse lentement, et a un moyen de se déplacer singulier : il sautille à pattes jointes lorsqu’il est au sol cherchant sa nourriture. La femelle est brune et a un plumage tacheté. Son bec est foncé.
Le saviez-vous ?
Il est possible d'observer des merles noirs blancs. Ces individus, atteints de leucisme (une anomalie génétique responsable de troubles de production de mélanine), peuvent être tout blanc ou bien partiellement blanc. Il semblerait que cela soit plus fréquent en ville qu'à la campagne (Izquierdo et al. 2019)
Maintenant que vous connaissez les oiseaux de vos jardins, vous souhaitez les aider à passer un meilleur hiver ? Vous pouvez ! Par exemple, en leur proposant de la nourriture. En effet, le manque de nourriture est la première cause de mortalité des oiseaux pendant l'hiver. Mais attention, il y a quelques règles à respecter et quelques recommandations à connaître. On vous dit tout dans la suite !
Il est conseillé de nourrir les oiseaux uniquement durant la mauvaise saison (de mi-novembre à mars), et ce particulièrement lors des épisodes de grands froids (ou de couvert neigeux prolongé). C’est en effet durant cette saison qu’une grande partie des espèces adopte un régime alimentaire plutôt granivore et/ou frugivore en raison du peu d’insectes disponibles. Mais graines et fruits ne sont pas abondants non plus durant l’hiver qui est une période particulièrement rude pour les oiseaux qui doivent dépenser beaucoup d’énergie pour se réchauffer. Un petit coup de pouce pour les aider à trouver de quoi manger favorise donc grandement leur survie.
Il est essentiel d’avoir à l’esprit que si l’on commence à nourrir pendant un épisode de froid, il ne faut surtout pas s’arrêter en cours de route. Il faut également veiller à ce que la nourriture soit présente en quantité suffisante. Vous devez donc nourrir tout l’hiver, et être particulièrement vigilant quant à la quantité de ressources que vous leur fournissez pendant les épisodes neigeux et/ou de grand froid.
À l’inverse, il est inutile et déconseillé de nourrir pendant la belle saison (printemps-été) puisque la majorité des oiseaux retournent à leur régime alimentaire insectivore. Ce régime riche en protéines est très important pour eux et leurs oisillons (notamment pour leur croissance). Il ne faut donc pas les détourner de ce régime alimentaire en leur mettant graines et fruits à disposition.
Il ne faudra pas non plus leur donner d’insectes puisque c’est également durant cette période que les oisillons apprennent à se nourrir par eux-mêmes. Vous pouvez (et il est même conseillé de le faire), en revanche, donner de l’eau fraîche aux oiseaux toute l’année, particulièrement l’été mais aussi en hiver quand il gèle car l’eau liquide est alors difficilement disponible dans la nature.
En fonction des espèces, différents types de mangeoires peuvent être utilisées. Le format le plus répandu est sans aucun doute le filet suspendu. Très simple, comme son nom l’indique, il s’agit d’un filet suspendu contenant graines et/ou boules de graisse. Il sera uniquement utilisé par les espèces les plus agiles telles que les mésanges. Ceci dit, ce type de support n’est pas idéal, voire même déconseillé, car les oiseaux peuvent rapidement s’emmêler et se retrouver bloqués dans le filet.
Une alternative est le plateau. Placé en hauteur, il est ouvert à la grande majorité des espèces (attention à bien ajouter un toit afin de protéger la nourriture). Vous pouvez aussi utiliser une mangeoire trémie : il s’agit d’un dispositif simple avec une réserve de nourriture qui s’écoule au fur et à mesure que les oiseaux se nourrissent (comme les distributeurs de croquettes pour chats !). Enfin, vous pouvez aussi nourrir au sol. À ce moment-là, il faudra quand même privilégier l’usage d’un plateau (sauf pour les fruits) afin d’éviter que les graines ne restent en contact avec le sol humide.
Il faut être vigilant, car en cas de forts rassemblements, les mangeoires peuvent ainsi devenir des lieux de propagation de maladies. Il est donc nécessaire de suivre quelques règles essentielles afin de ne pas rendre nuisible l’action de nourrissage hivernal :
- placer la mangeoire dans une zone ouverte pour éviter les possibilités d’accès ou de cachettes pour les prédateurs naturels tels que les chats ou les fouines,
- utiliser des mangeoires spécifiquement conçues pour cette activité qui permettent de réguler “le trafic” et ainsi de limiter le nombre d’oiseaux présents simultanément
- protéger la nourriture de l’humidité et du gel, avec un toit par exemple
- nettoyer régulièrement la mangeoire et ses environs
- si un abreuvoir est ajouté (attention, maximum 10 cm de profondeur pour éviter le risque de noyade), le nettoyer et renouveler l’eau régulièrement.
Les mangeoires n’attirent que quelques espèces d’oiseaux. On retrouvera majoritairement des passereaux (mésanges, moineaux, pinsons …). En fonction des sources de nourriture apportées, d’autres familles moins communes telles que les turdidés (grives, merles) ou des corvidés (geai, pie, corneille) pourront se joindre à la fête. Vous pouvez retrouver une liste (non exhaustive) sur oiseauxdesjardins.net.
Il existe trois grands types de nourriture que l’on peut distribuer aux oiseaux durant l’hiver :
Privilégier les graines de tournesol dans les mangeoires pour les mésanges, pinsons ou verdiers ; de blé ou d’orge pour les espèces se nourrissant au sol tels que les moineaux ou les bruants. On peut également réaliser des mélanges de graines afin de varier l’alimentation et d’attirer plusieurs espèces simultanément (exemple : 1/3 de tournesol noir, 1/3 de cacahuètes, 1/3 de maïs concassé). Attention, il faut toujours utiliser des graines non grillées et non salées ! Ce n’est pas l’apéro du dimanche 😉 Vous pouvez trouver un récapitulatif très complet ici.
Certaines espèces sont majoritairement frugivores (grives et merles par exemple), dans ce cas, on peut disposer directement au sol des fruits bien mûrs (pommes, poires, raisins). Ils seront consommés rapidement, avant même de commencer à moisir.
Les pains de graisse sont également des sources nutritives de premier choix, surtout lors des périodes de grand froid. Il convient alors d’utiliser au maximum des graisses végétales (hors huile de palme). Il est également possible de proposer des graisses animales (suif de bœuf ou lard de porc) mais en veillant bien à utiliser des produits non salés. En plus, vous pouvez fabriquer les pains de graisse à la maison, c’est très simple, amusant et utile ! Voir tuto juste en dessous !
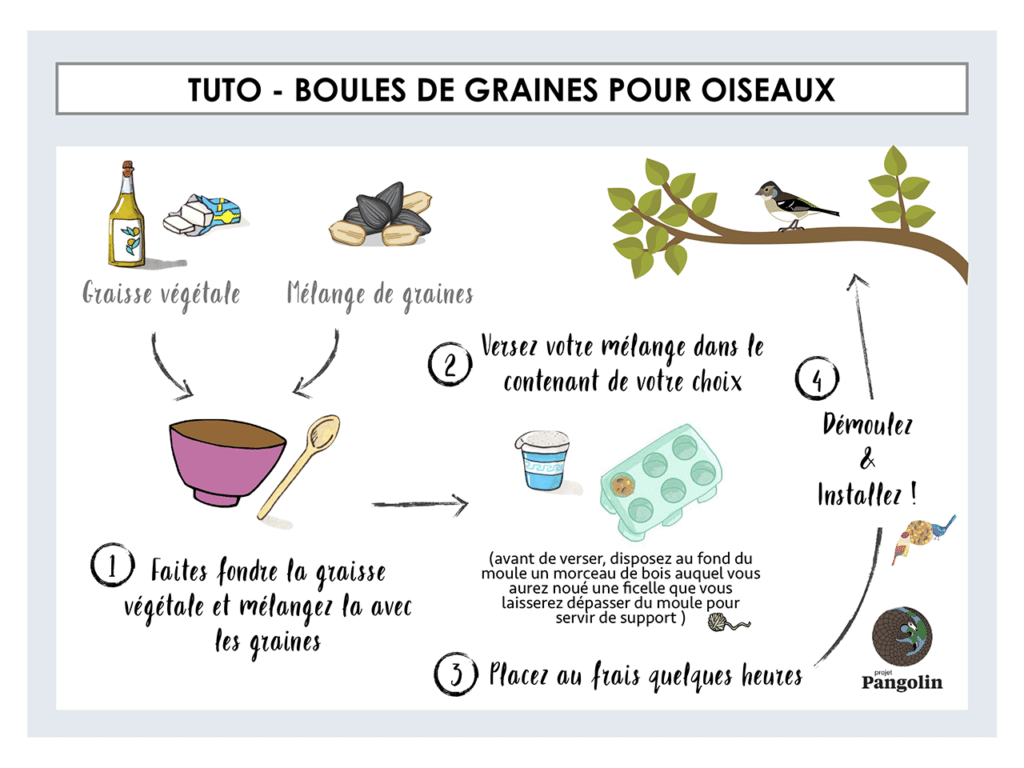
Les sites de nidification disponibles pour les oiseaux (cavités dans les arbres, trous et fentes dans les murs, buissons épais, etc) se font de plus en plus rares, et ce aussi bien en ville qu’à la campagne. Nos activités anthropiques, à travers nos constructions nombreuses (bâtiments, réseaux routiers, etc) viennent fragmenter l’habitat des oiseaux et tendent à faire disparaître bon nombre des lieux utilisables par ces derniers pour se loger et donc se reproduire. Pour les aider, nous pouvons venir reconnecter leur habitat et leur offrir des sites de nidification adaptés à leurs besoins en installant des nichoirs dans nos jardins et parcs.
Pour permettre aux oiseaux de venir occuper le nichoir que vous leur aurez installé, il est important de respecter quelques grands principes, aussi bien au niveau de la construction, que de l’installation.
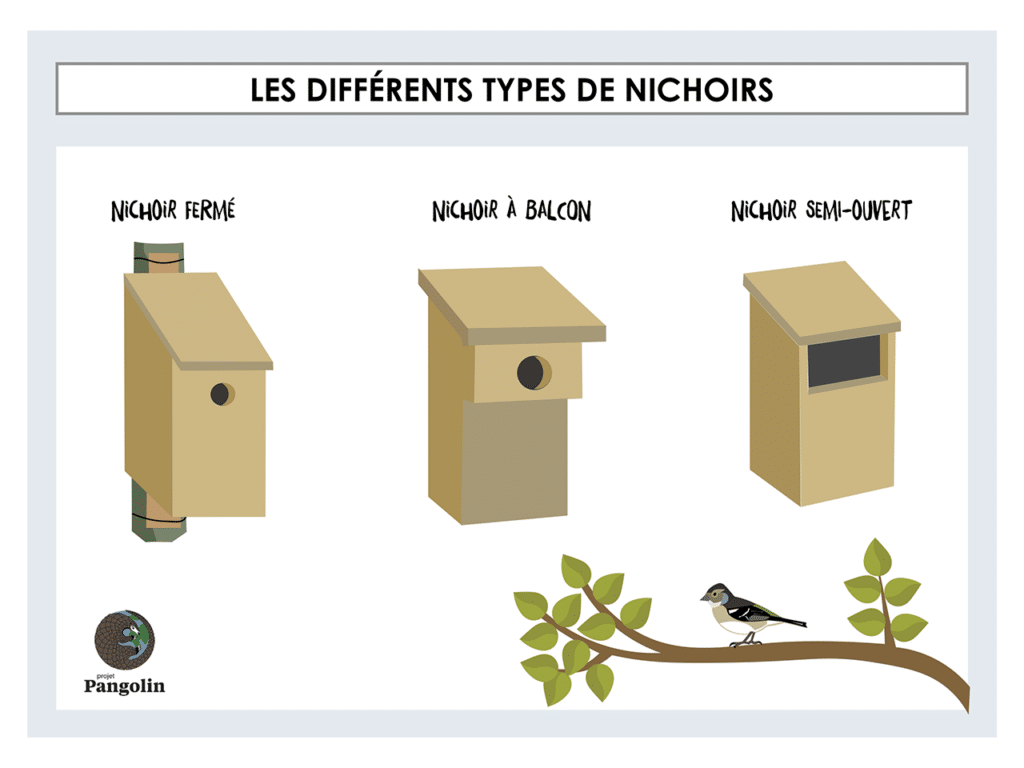
Sachez enfin qu’il existe 3 principaux types de nichoirs :
Retrouvez toutes ces bonnes pratiques, ainsi qu’un guide complet pour savoir quel type de nichoir proposer aux espèces d’oiseaux communs que nous vous avons présenté dans cet article, juste ici :
Nous espérons que ce premier guide du naturaliste vous invitera à vous intéresser de plus près aux espèces qui vous entourent. La biodiversité ordinaire est importante pour nos écosystèmes et notre santé (comme le dit Enric Sala). Se familiariser avec elle nous rend plus sensible à sa protection. Il est de notre devoir à tous de renouer un lien fort et durable avec ces organismes. Vous retrouverez d’autres guides du naturaliste prochainement sur notre site web. D’ici là, on vous souhaite de rester curieux pour comprendre le monde afin de devenir acteur de sa préservation !